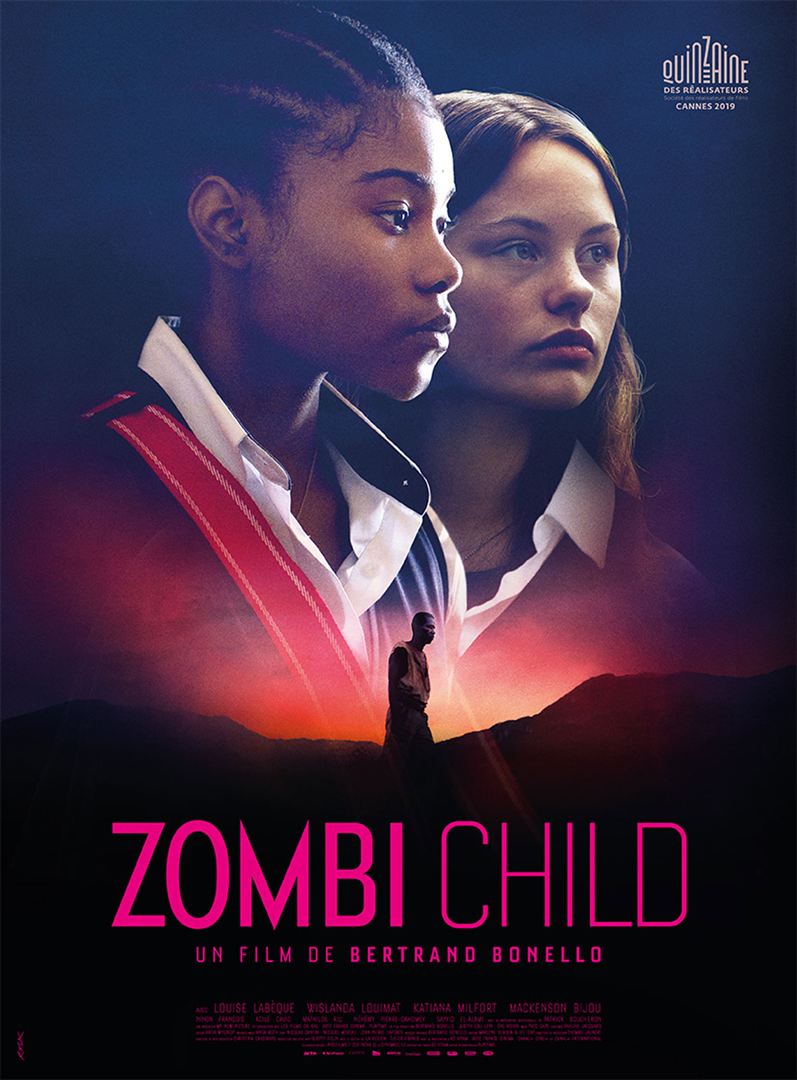Rudolf Noureev (Oleg Ivenko) est la star du ballet du Kirov en tournée en Europe en 1961. Accueilli à bras ouverts par le danseur Pierre Lacotte (Raphaël Personnaz), par la belle-fille d’André Malraux, Eva Saint (Adèle Exarchopoulos), le jeune danseur est vite fasciné par la vie parisienne. Mais le KGB, qui ne le quitte pas d’un chausson, voit d’un mauvais œil ses fréquentations.
J’ai couru voir le soir de sa sortie ce biopic, dont la bande-annonce fiévreuse tournait en boucle depuis quelques semaines. Tout m’y faisait envie : la Guerre froide racontée à travers l’histoire du plus célèbre danseur russe depuis Nijinsky, la reconstitution aussi soignée qu’élégante du Paris du début des années soixante, la si sensuelle Adèle Exarchopoulos, le toujours parfait Ralph Fiennes…
Hélas tout sonne faux dans ce pensum de plus de deux heures qui transpire l’ennui. Il tisse trois fils narratifs. Le premier, couleur sépia, est l’enfance misérable de Noureev dans l’hiver permanent d’Oufa, au cœur des monts Oural. Le deuxième est sa formation à Leningrad auprès du célèbre maître de ballet Alexandre Pouchkine, interprété par un Ralph Fiennes neurasthénique. Le troisième, le plus intéressant, celui sur lequel on nous vend le film, et celui qui hélas n’en constitue qu’un (gros) tiers se passe dans un Paris d’opérette, acrobatiquement cadré pour éviter qu’on en voie la tour Montparnasse ou le centre Pompidou. Le film est construit autour d’un faux suspense qui peine à tenir en haleine ceux, sans doute nombreux, qui connaissent déjà la destinée de Noureev.
On pardonnera Oleg Ivenko de mal jouer. C’est un danseur professionnel, catastrophique dès qu’il a une ligne de texte, sublime dès qu’il s’élance sur le plateau. En revanche, Noureev réussit à vider Adèle Exarchopoulos de toute sensualité. Et ça, c’est impardonnable.


 Le monteur français Denis Parrot est allé sur Youtube glaner des vidéos de coming out postées entre 2012 et 2018. On y voit des garçons et des filles du monde entier y annoncer leur homosexualité ou leur décision de changer de sexe.
Le monteur français Denis Parrot est allé sur Youtube glaner des vidéos de coming out postées entre 2012 et 2018. On y voit des garçons et des filles du monde entier y annoncer leur homosexualité ou leur décision de changer de sexe.