 Après que la Terre est devenue inhabitable, ses habitants ont migré dans une autre planète, After Blue. Seules les femmes survivent à cet exode et s’organisent en micro-communautés autosuffisantes.
Après que la Terre est devenue inhabitable, ses habitants ont migré dans une autre planète, After Blue. Seules les femmes survivent à cet exode et s’organisent en micro-communautés autosuffisantes.
La jeune Roxy (Paula Luna) est une adolescente renfermée qui un jour, sur une plage, sauve Kate Bush (Agata Buzek), une femme condamnée à être enterrée vivante. Roxy et sa mère (Elina Löwensohn) sont tenues pour responsables de l’élargissement de cette criminelle et sommées de la retrouver et de la liquider malgré leur manque d’expérience des armes. C’est le début pour elles d’une longue quête ponctuée de nombreuses rencontres.
Il y a quatre ans sortait Les Garçons sauvages, le premier long métrage de Bertrand Mandico. Je l’avais détesté. J’en faisais à l’époque une critique assassine, tout en reconnaissant l’originalité du cinéma de ce cinéaste transgressif venu du court et du moyen métrage.
Je pourrais presque la recopier au mot près. Avec une circonstance aggravante. Cette fois-ci, Mandico n’a pas le privilège de l’originalité. Il bégaie le même cinéma que celui que Les Garçons sauvages nous avait fait découvrir. La même esthétique kitsch filmée à grands coups de fumigènes où l’on retrouve la même créature monstrueuse que dans Ultra pulpe. Le même métissage de science-fiction, de fantasy, de roman d’aventures cette fois-ci mâtiné de western. Le même féminisme radical et, en même temps, malaisant : rassembler un casting exclusivement féminin et filmer ses actrices à poil (Le Monde, qui fait rarement preuve d’un tel humour, titre sur « La Planète des seins ») est-il la marque d’un féministe engagé ou d’un vieux voyeur libidineux ? Les mêmes provocations gratuites (des seins éjaculent) qui lui valent une interdiction aux moins de douze ans. Les mêmes actrices (Elina Löwensohn, la compagne de Mandico à la ville, Vimala Pons, Nathalie Richard) aux voix postsynchronisées. Les mêmes dialogues bâclés. Un scénario tout aussi indigent dont on comprend vite qu’il n’est qu’un prétexte à une succession de saynètes.
Comme dans Les Garçons sauvages, Mandico nous propose de nous emmener dans un trip hypnotique qui n’appartient qu’à lui. Heureux ceux qui s’y laissent embarquer. Au vu des spectateurs qui ont quitté le film en cours de séance, étouffant un fou rire ou une injure rageuse, il est à craindre que soient plus nombreux ceux qui, comme moi, seront restés sur le bord du chemin.

 Philippe Lemesle (Vincent Lindon) est un quinquagénaire fatigué qui tente vaillamment de soigner sa forme physique en enchaînant les runnings en salle de sport. Le couple harmonieux qu’il formait avec Anne (Sandrine Kiberlain) son épouse, qui lui avait sacrifié sa vie professionnelle pour élever leurs deux enfants, est en train d’exploser. Leur fille aînée a quitté le nid familial pour l’autre rive de l’Atlantique. Leur fils cadet (Anthony Bajon), victime d’un burn-out pendant ses études, doit être interné en HP.
Philippe Lemesle (Vincent Lindon) est un quinquagénaire fatigué qui tente vaillamment de soigner sa forme physique en enchaînant les runnings en salle de sport. Le couple harmonieux qu’il formait avec Anne (Sandrine Kiberlain) son épouse, qui lui avait sacrifié sa vie professionnelle pour élever leurs deux enfants, est en train d’exploser. Leur fille aînée a quitté le nid familial pour l’autre rive de l’Atlantique. Leur fils cadet (Anthony Bajon), victime d’un burn-out pendant ses études, doit être interné en HP.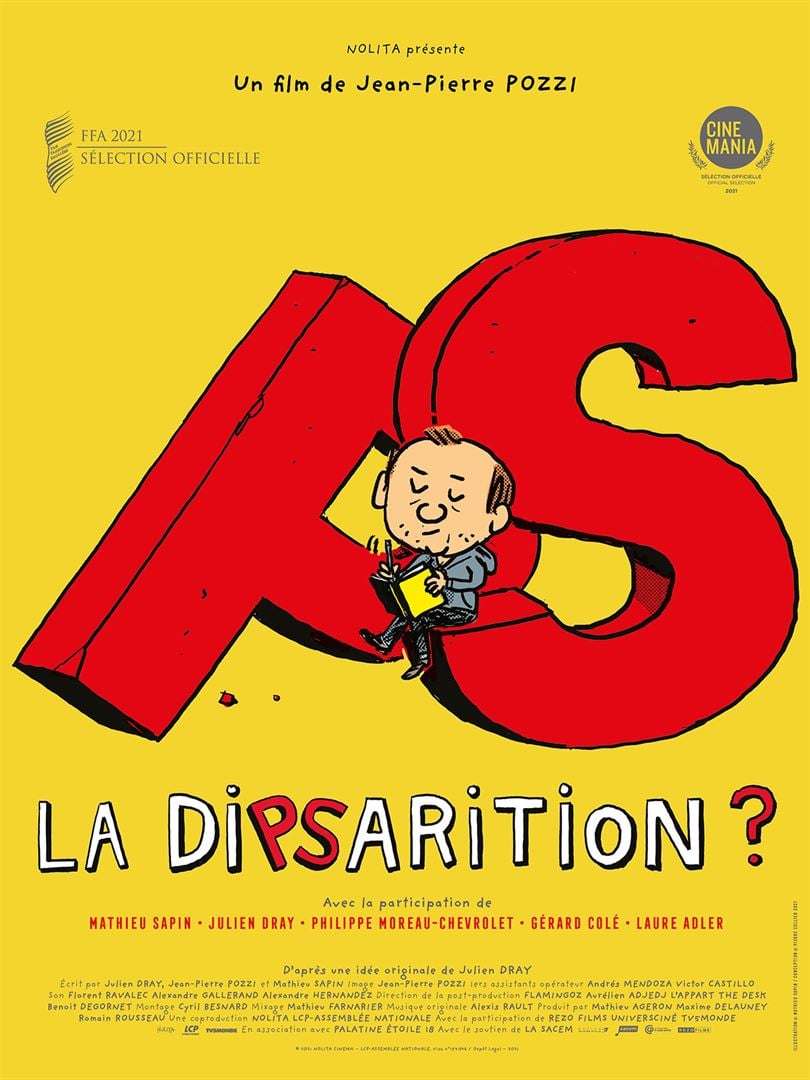 À l’occasion du quarantième anniversaire de l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en mai 1981, le bédéiste Mathieu Sapin (sans lien de parenté avec l’ancien ministre socialiste) décroche de Libération une commande : raconter ces quarante années de socialisme. Son ami, le réalisateur Jean-Pierre Pozzi, le filme dans les rendez-vous qu’il prend avec quelques grands témoins pour lui raconter cette histoire.
À l’occasion du quarantième anniversaire de l’arrivée au pouvoir de François Mitterrand en mai 1981, le bédéiste Mathieu Sapin (sans lien de parenté avec l’ancien ministre socialiste) décroche de Libération une commande : raconter ces quarante années de socialisme. Son ami, le réalisateur Jean-Pierre Pozzi, le filme dans les rendez-vous qu’il prend avec quelques grands témoins pour lui raconter cette histoire. Ida a neuf ans, une grande sœur autiste et deux parents aimants qui veillent à donner à chacune de leurs filles l’attention qu’elles exigent. Ida et sa famille profitent de l’été nordique pour déménager. Ils s’installent dans une barre HLM où Ida espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre bientôt Ben, un garçonnet qui lui dit posséder des dons étonnants de télékinésie. Anna sa sœur se lie avec Aisha qui semble parvenir à communiquer avec elle par la pensée.
Ida a neuf ans, une grande sœur autiste et deux parents aimants qui veillent à donner à chacune de leurs filles l’attention qu’elles exigent. Ida et sa famille profitent de l’été nordique pour déménager. Ils s’installent dans une barre HLM où Ida espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre bientôt Ben, un garçonnet qui lui dit posséder des dons étonnants de télékinésie. Anna sa sœur se lie avec Aisha qui semble parvenir à communiquer avec elle par la pensée. Max, huit ans, Léo, cinq ans, et leur mère quittent le Mexique pour les Etats-Unis. Sans ressources, sans amis pour les accueillir, ils s’installent à Albuquerque dans un appartement miteux loué par un couple de vieux chinois acariâtres. Pendant que leur mère va chercher du travail, Max et Leo restent seuls dans l’appartement avec l’interdiction d’en sortir.
Max, huit ans, Léo, cinq ans, et leur mère quittent le Mexique pour les Etats-Unis. Sans ressources, sans amis pour les accueillir, ils s’installent à Albuquerque dans un appartement miteux loué par un couple de vieux chinois acariâtres. Pendant que leur mère va chercher du travail, Max et Leo restent seuls dans l’appartement avec l’interdiction d’en sortir. Simon Doyle (Armie Hammer rattrapé depuis par de troublantes accusations de viol et de … cannibalisme) et sa richissime fiancée, Linnet Ridgeway (Gal Gadot dont le seul nom au générique suffit à faire interdire la sortie du film au Koweït) sont en lune de miel en Égypte. Ils ont affrété un luxueux bateau qui remonte le Nil d’Assouan à Abou Simbel. Ils ont rassemblé autour d’eux leurs amis les plus proches ainsi que le célèbre détective belge Hercule Poirot (Kenneth Branagh) rencontré par hasard au pied des Pyramides. La croisière semble commencer sous les meilleurs auspices ; mais le crime rode…
Simon Doyle (Armie Hammer rattrapé depuis par de troublantes accusations de viol et de … cannibalisme) et sa richissime fiancée, Linnet Ridgeway (Gal Gadot dont le seul nom au générique suffit à faire interdire la sortie du film au Koweït) sont en lune de miel en Égypte. Ils ont affrété un luxueux bateau qui remonte le Nil d’Assouan à Abou Simbel. Ils ont rassemblé autour d’eux leurs amis les plus proches ainsi que le célèbre détective belge Hercule Poirot (Kenneth Branagh) rencontré par hasard au pied des Pyramides. La croisière semble commencer sous les meilleurs auspices ; mais le crime rode…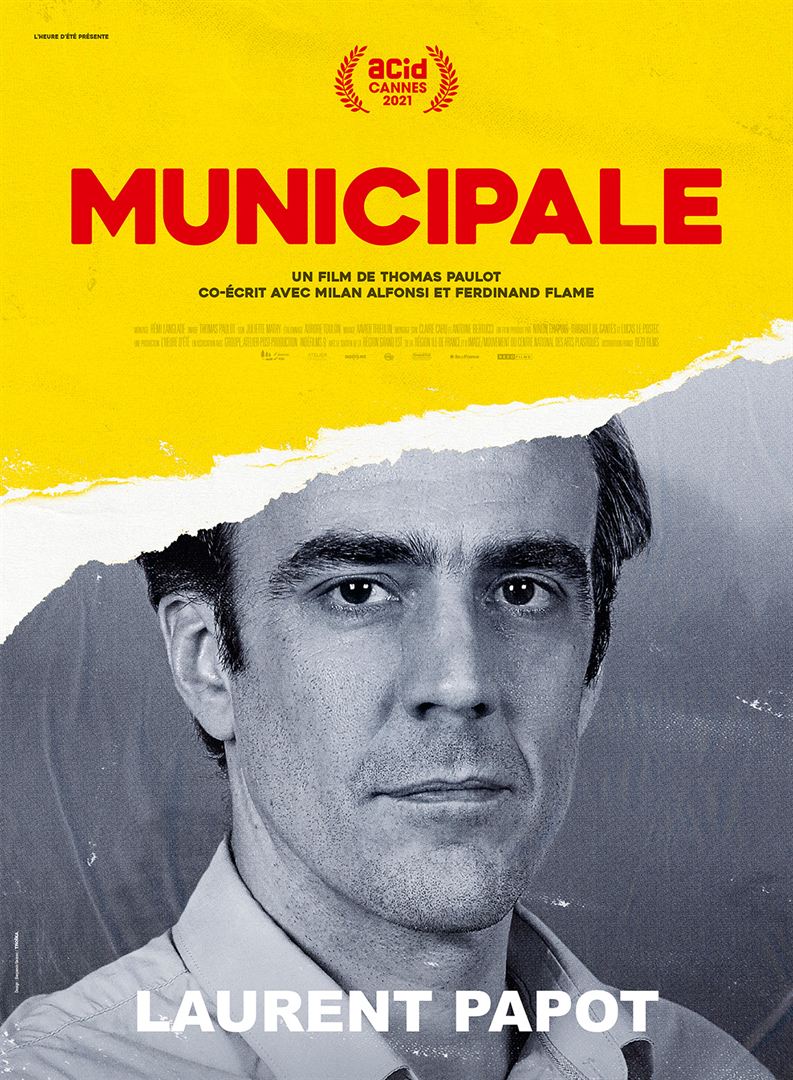 À quelques mois des élections municipales, Laurent Papot, un acteur parisien, arrive à Revin, une petite cité ardennaise frappée par la désindustrialisation. Il a été recruté par les deux réalisateurs de Municipale pour endosser le costume d’un candidat aux prochaines élections. Le documentaire qu’ils s’apprêtent à filmer sera l’occasion d’une plongée dans la vie politique en province et d’une radioscopie d’une cité en crise.
À quelques mois des élections municipales, Laurent Papot, un acteur parisien, arrive à Revin, une petite cité ardennaise frappée par la désindustrialisation. Il a été recruté par les deux réalisateurs de Municipale pour endosser le costume d’un candidat aux prochaines élections. Le documentaire qu’ils s’apprêtent à filmer sera l’occasion d’une plongée dans la vie politique en province et d’une radioscopie d’une cité en crise. Gilles (Nahuel Perez Biscayart), le fils d’un rabbin anversois, est arrêté en France en 1942 alors qu’il tentait de quitter l’Europe. Il ne doit la vie sauve qu’à un réflexe désespéré : au moment d’être exécuté, il a brandi l’exemplaire d’un livre rare échangé à un autre prisonnier et a affirmé être persan. Il est aussitôt conduit dans un camp de concentration chez Klaus Koch, un officier nazi (Lars Eidinger) qui rêve d’ouvrir à Téhéran un restaurant après la guerre. En échange d’un poste en cuisine, Koch exige de Gilles qu’il lui apprenne le farsi. Comment diable le prisonnier réussira-t-il à enseigner à son bourreau une langue dont il ne connaît pas un traitre mot ?
Gilles (Nahuel Perez Biscayart), le fils d’un rabbin anversois, est arrêté en France en 1942 alors qu’il tentait de quitter l’Europe. Il ne doit la vie sauve qu’à un réflexe désespéré : au moment d’être exécuté, il a brandi l’exemplaire d’un livre rare échangé à un autre prisonnier et a affirmé être persan. Il est aussitôt conduit dans un camp de concentration chez Klaus Koch, un officier nazi (Lars Eidinger) qui rêve d’ouvrir à Téhéran un restaurant après la guerre. En échange d’un poste en cuisine, Koch exige de Gilles qu’il lui apprenne le farsi. Comment diable le prisonnier réussira-t-il à enseigner à son bourreau une langue dont il ne connaît pas un traitre mot ? Gérard (Darmon) se meurt d’un méchant cancer du poumon. Ses amis, Ary (Bittan) et Philippe (Lellouche), souhaitent adoucir ses derniers moments en lui offrant une ultime histoire d’amour. Ils contactent Sandrine (Bonnaire), la patronne d’une agence d’escorts qui, n’écoutant que son cœur, décide de s’atteler en personne à la tâche.
Gérard (Darmon) se meurt d’un méchant cancer du poumon. Ses amis, Ary (Bittan) et Philippe (Lellouche), souhaitent adoucir ses derniers moments en lui offrant une ultime histoire d’amour. Ils contactent Sandrine (Bonnaire), la patronne d’une agence d’escorts qui, n’écoutant que son cœur, décide de s’atteler en personne à la tâche. À la tête de l’OCRTIS, l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, le commissaire Jacques Billard (Vincent Lindon) entend déployer une stratégie novatrice. Plutôt que de procéder à des saisies soi-disant record, sans effet de long terme sur les trafics, il entend pister les cargaisons, identifier tous les trafiquants et procéder à des interpellations massives pour décapiter les cartels.
À la tête de l’OCRTIS, l’office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants, le commissaire Jacques Billard (Vincent Lindon) entend déployer une stratégie novatrice. Plutôt que de procéder à des saisies soi-disant record, sans effet de long terme sur les trafics, il entend pister les cargaisons, identifier tous les trafiquants et procéder à des interpellations massives pour décapiter les cartels.