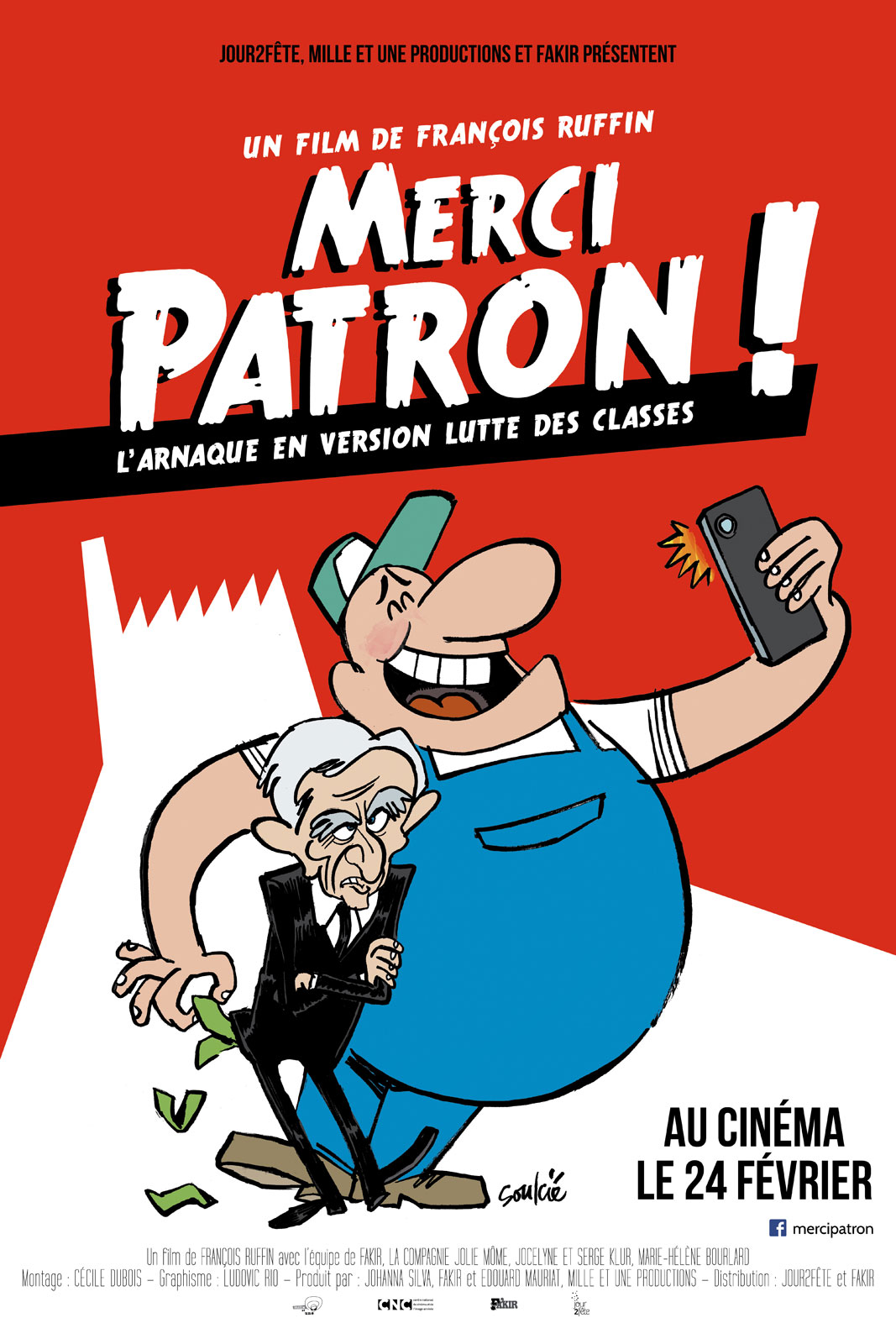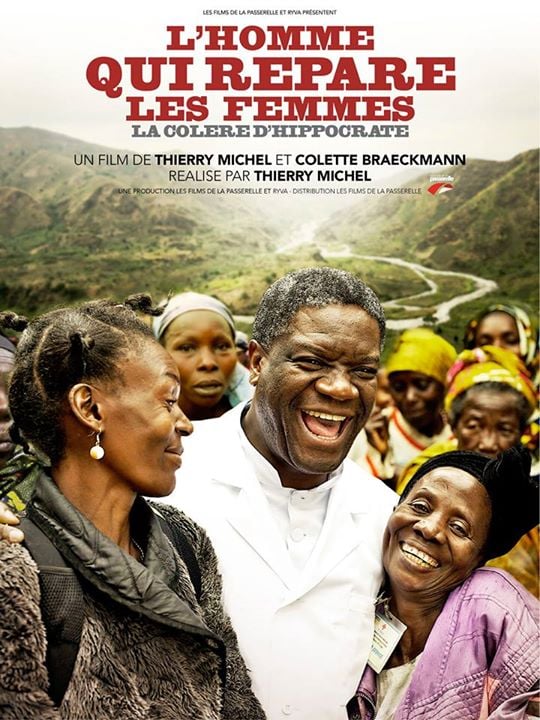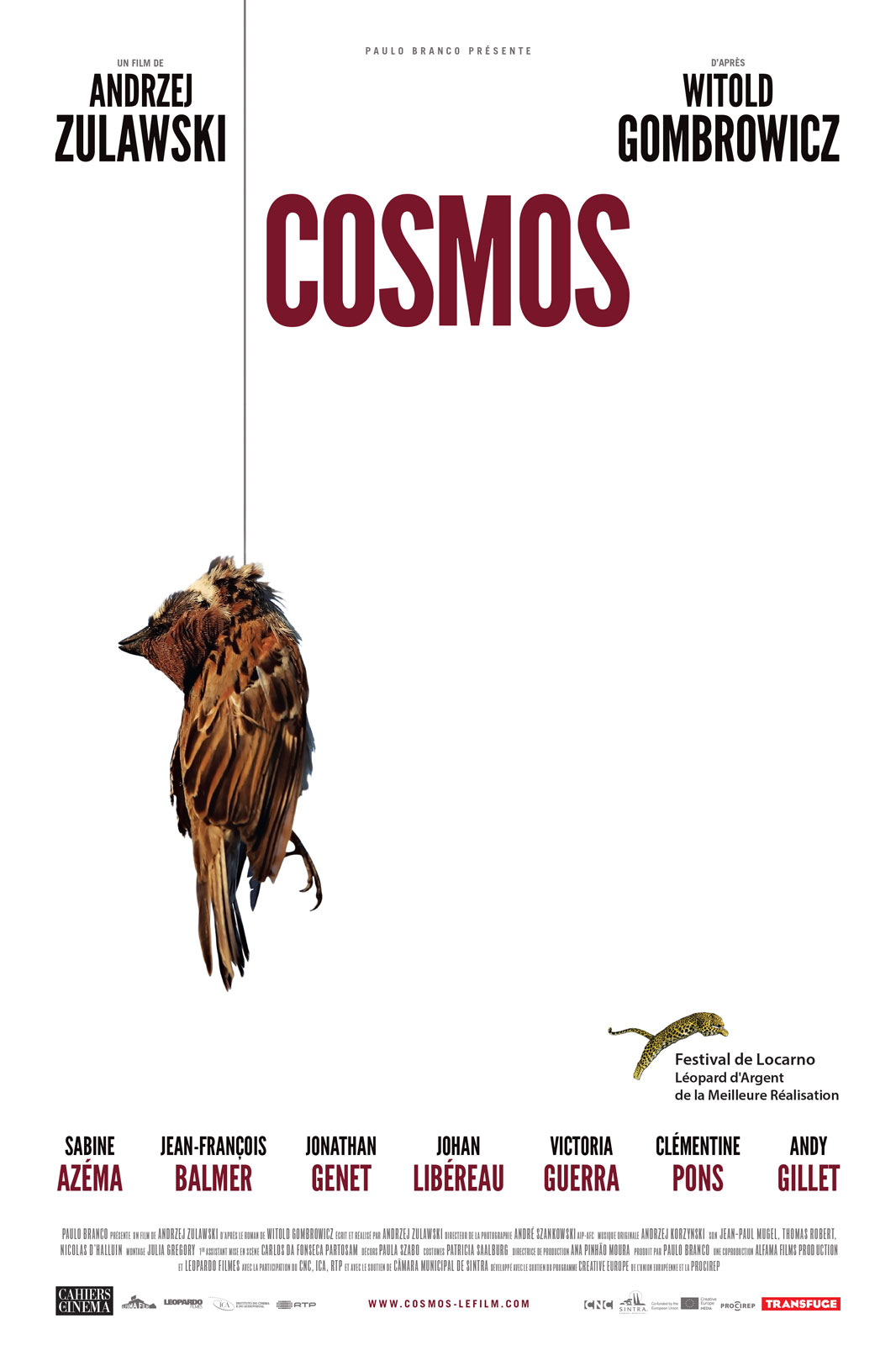J’avais beaucoup aimé les précédents films de Félix Van Groeningen – qui, comme son nom l’indique, n’est ni italien ni portugais. La Merditude des choses et Alabama Monroe, une comédie dramatique et un drame non dépourvu d’humour qui avaient tous les deux la truculence et la générosité d’un potjevleesch flamingant.
J’avais beaucoup aimé les précédents films de Félix Van Groeningen – qui, comme son nom l’indique, n’est ni italien ni portugais. La Merditude des choses et Alabama Monroe, une comédie dramatique et un drame non dépourvu d’humour qui avaient tous les deux la truculence et la générosité d’un potjevleesch flamingant.
J’ai été du coup d’autant plus déçu par Belgica qui s’annonçait dans la continuité prometteuse de ces deux premiers films.
L’action se passe à Gand, dans le café où le jeune Félix a grandi. Deux frères décident de transformer ce rade minable en bar branché. Ils y mettent toute leur -communicative – folie et connaissent vite le succès. Mais la réalité a tôt fait de rattraper leur rêve.
Oui, Belgica est un film survolté, euphorisant, énergisant. Oui, l’anarchie de la fête, son bruit, sa sueur, son hébétement, son euphorie aussi, ont rarement été aussi bien filmés – et je sais de quoi je parle moi qui passe mes nuits en boîte ! Oui, les deux héros, avec leurs brisures et leur grand cœur, sont attachants. Oui, la musique est géniale.
Pour autant, le film fait du surplace. Son seul moteur est la rivalité, aux motifs pas très lisibles, qui grandit entre les deux frères. Aucune surprise, aucune émotion non plus – si ce n’est peut-être dans certains rôles secondaires (l’épouse délaissée, la maîtresse moins cruche qu’il ny paraît…) trop vite sacrifiés. Belgica aurait pu sans préjudice faire trente minutes de moins. Un poil trop racoleur, un brin trop vulgaire pour convaincre.