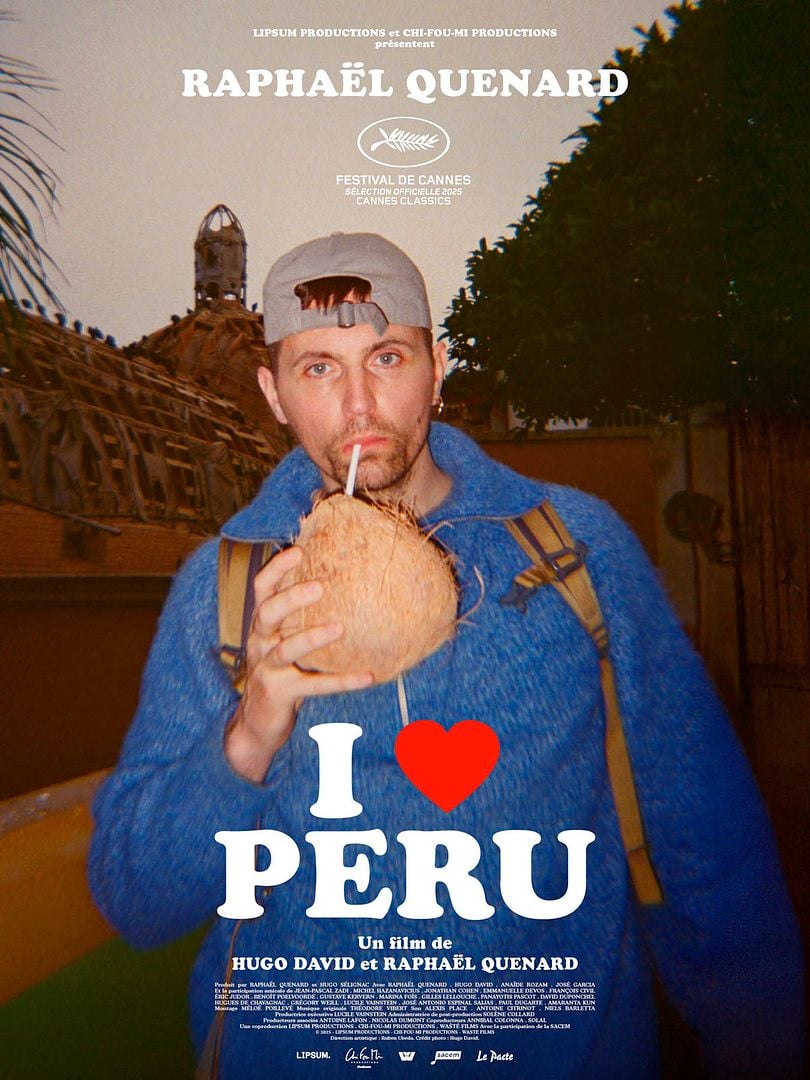Marseille l’été. Omar et ses potes ont grandi dans le même quartier. Gamins, ils ont fréquenté le centre aéré qu’ils gèrent aujourd’hui eux-mêmes en essayant de ne pas mouiller dans les trafics louches qui enrichissent les petits caïds. Omar est en couple avec Yasmine. Mais le retour de Carmen, une amie d’enfance, tombée dans la prostitution après la mort de son père, sème la zizanie.
Prïncia Cair anime une troupe de théâtre amateur à Marseille depuis huit ans. Avec sa co-scénariste Léna Mardi et sa productrice Johanna Nahon, elle a choisi de tourner un long métrage en laissant la part belle à sa troupe d’acteurs, étroitement associés à l’écriture.
Le résultat s’en ressent. Pour le meilleur et pour le pire. On sent dans cette troupe circuler une énergie aussi radieuse que le soleil qui brûle Marseille et la Méditerranée. Les Filles désir filme un collectif d’où émergent des individualités talentueuses : Omar s’est attribué le rôle du chef de bande, tour à tour protecteur et autoritaire, Yasmine, tout en silences, peine à trouver sa place sous la coupe d’Omar et dans ce groupe exclusivement féminin, Carmen, belle comme la tentation, est l’élément corrupteur et révélateur du groupe, comme l’était le personnage anonyme interprété par Terence Stamp dans Théorème. Les Filles désir propose une réflexion stimulante sur le statut de la femme dans ces bandes hypervirilistes de cacous marseillais, qui essaie d’échapper à l’assignation binaire maman ou putain.
Les Filles désir rappelle Shéhérazade. Il partage avec le succès surprise de 2018 (trois Césars : celui du meilleur premier film et des meilleures révélations masculine et féminine) une même lumière, une même sonorité – qui aurait nécessité l’insert de sous-titres tant l’argot marseillais est parfois difficile à comprendre – et une même vitalité. Aura-t-il le même succès ? Hélas, il est à craindre que non. Car le film, mal distribué, risque de passer inaperçu et de disparaître vite.
Il souffre aussi d’un handicap : la fin de son scénario et son dernier quart d’heure qui, quittant la bande de copains, se focalise sur Yasmine et Carmen, dans un duo qui rappelle à la fois celui de Divines et de Thelma et Louise.