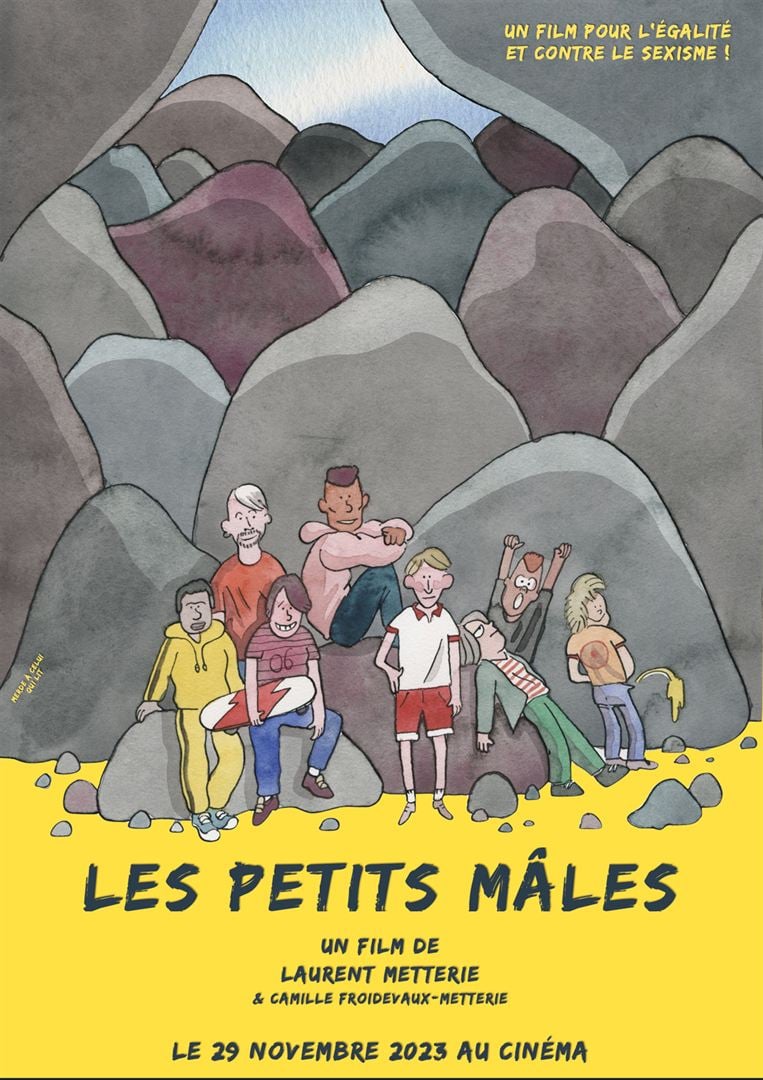 Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.
Le documentariste Laurent Metterie, épaulé par sa femme, Camille Froidevaux-Metterie, philosophe spécialiste du féminisme, est allé interviewer une trentaine de garçons, entre sept et dix-huit ans. Il les a interrogés sur les sujets qui sont aujourd’hui au centre des grands débats féministes : les assignations de genre, l’amitié et l’amour, la sexualité, les violences sexistes et sexuelles, le harcèlement, la fluidité des genres, le droit des LGTBQI… Il a également interviewé une demi-douzaine de femmes du quatrième âge, qui témoignent de la condition féminine qu’elles ont vécue au siècle dernier et qu’elles ont vu lentement évoluer. Entre ces interviews face caméra sont intercalées des images muettes tournées en VHS dans les 70ies du réalisateur, alors enfant, de ses parents et de leurs amis.
Le résultat est très académique. Il n’a aucune dimension cinématographique et n’en a d’ailleurs pas la prétention. Ramené à cinquante-deux minutes, il ferait un parfait documentaire de télévision.
Les « petits mâles » qui y sont interviewés ne sont pas, comme son titre pouvait le laisser augurer, des condensés de machisme. Leurs réactions sont très diverses. Les plus jeunes sont les plus spontanés et les plus touchants, même si certaines de leurs saillies sont scandaleuses. Plus leur âge avance, plus leur discours s’uniformise sans qu’on puisse avec certitude se convaincre, lorsqu’ils évoquent le respect nécessaire dû aux femmes, le refus de toute inégalité, l’attachement à la liberté de choisir sa sexualité, qu’il s’agisse de leurs convictions intimes ou de la régurgitation plus ou moins fidèle du discours qu’on leur a rabâché.
Je ne suis pas convaincu par la démarche de ce documentaire en dépit de son objectif stimulant. Il échoue à nous montrer ce que les jeunes garçons pensent réellement de ces sujets-là. Son protocole trop contraint, qui n’ose pas pousser les jeunes dans leurs retranchements, le condamne à nous montrer ce qu’ils nous resservent, pensant que ce discours-là est celui que nous adultes attendons d’eux.

 Ce documentaire québécois traite d’un sujet d’une brûlante actualité hélas : la misogynie en ligne. Il prend l’exemple du cyberharcèlement subi par quatre femmes : une étudiante canadienne victime d’un camarade de classe, une élue locale du Vermont afro-américaine violemment prise à partie par des internautes suprémacistes blancs, une bloggeuse française féministe et la présidente de la Chambre des députés d’Italie.
Ce documentaire québécois traite d’un sujet d’une brûlante actualité hélas : la misogynie en ligne. Il prend l’exemple du cyberharcèlement subi par quatre femmes : une étudiante canadienne victime d’un camarade de classe, une élue locale du Vermont afro-américaine violemment prise à partie par des internautes suprémacistes blancs, une bloggeuse française féministe et la présidente de la Chambre des députés d’Italie.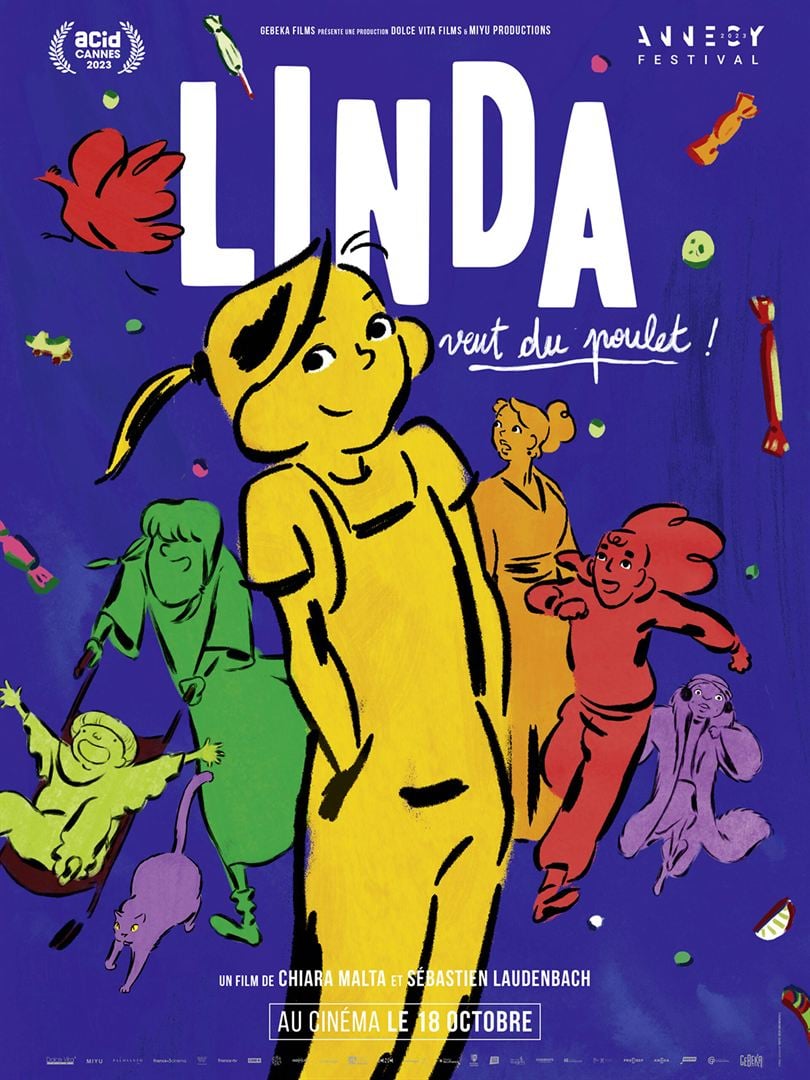 Linda a huit ans. Depuis la mort de son père, Paulette, sa mère, l’élève seule. Injustement punie par elle qui, pour se faire pardonner, lui promet de lui passer tous ses désirs, Linda réclame un poulet aux poivrons, souvenir nostalgique de la cuisine que lui mitonnait son père. Mais c’est la grève générale et tous les magasins sont fermés. Pour trouver un poulet, Paulette et Linda se lancent dans une folle odyssée.
Linda a huit ans. Depuis la mort de son père, Paulette, sa mère, l’élève seule. Injustement punie par elle qui, pour se faire pardonner, lui promet de lui passer tous ses désirs, Linda réclame un poulet aux poivrons, souvenir nostalgique de la cuisine que lui mitonnait son père. Mais c’est la grève générale et tous les magasins sont fermés. Pour trouver un poulet, Paulette et Linda se lancent dans une folle odyssée. Laetitia Colombani, qui avait déjà signé plusieurs films, avant de prendre la plume, a elle-même adapté son premier roman. Publié en 2017, La Tresse a remporté un immense succès. Son adaptation, retardée par le Covid, lui est très fidèle. Elle se déroule sur trois continents et entrelace, comme le faisait déjà le roman, l’histoire de trois femmes.
Laetitia Colombani, qui avait déjà signé plusieurs films, avant de prendre la plume, a elle-même adapté son premier roman. Publié en 2017, La Tresse a remporté un immense succès. Son adaptation, retardée par le Covid, lui est très fidèle. Elle se déroule sur trois continents et entrelace, comme le faisait déjà le roman, l’histoire de trois femmes.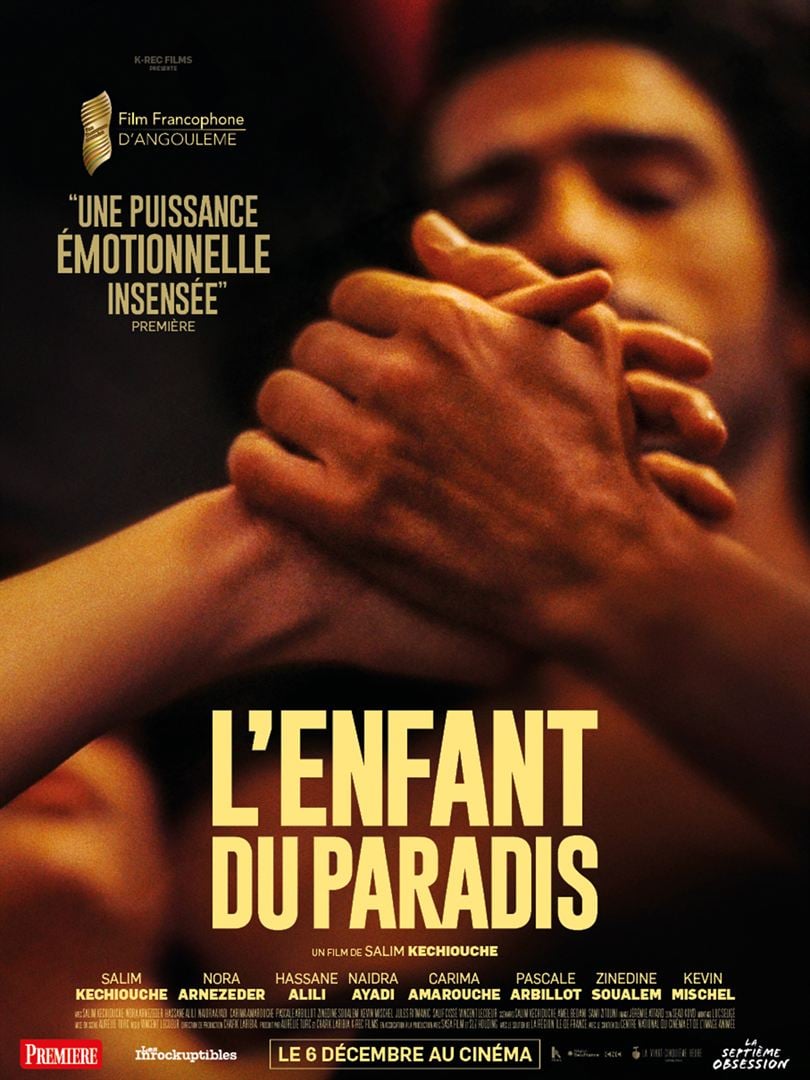 La petite quarantaine, Yazid est un acteur qui a décroché quelques rôles avant de sombrer dans l’alcool et dans la drogue. Son couple s’y est fracassé. Mais Yazid est en train de remonter la pente, de renouer avec son fils désormais adolescent, de construire une relation stable avec Garance, une actrice comme lui, avant de retrouver la scène.
La petite quarantaine, Yazid est un acteur qui a décroché quelques rôles avant de sombrer dans l’alcool et dans la drogue. Son couple s’y est fracassé. Mais Yazid est en train de remonter la pente, de renouer avec son fils désormais adolescent, de construire une relation stable avec Garance, une actrice comme lui, avant de retrouver la scène. Oury Milshtein est inconnu du grand public. Il est pourtant une personnalité importante du cinéma français qui a produit depuis quarante ans plusieurs dizaines de films aux côtés d’Agnès Varda, de Jacques Doillon, d’Arnaud Desplechin ou d’Alex Lutz. Marié à la fille d’Enrico Macias, divorcé, remarié, il a eu de ces deux unions cinq enfants, avant de vivre quelques années avec Kate Barry, la fille de Jane Birkin dramatiquement disparue en 2013. Sa vie, qui pourrait ressembler à celle, joyeusement neurasthénique, de n’importe quel Juif ashkénaze français, a été marquée par un drame dont il est resté inconsolable.
Oury Milshtein est inconnu du grand public. Il est pourtant une personnalité importante du cinéma français qui a produit depuis quarante ans plusieurs dizaines de films aux côtés d’Agnès Varda, de Jacques Doillon, d’Arnaud Desplechin ou d’Alex Lutz. Marié à la fille d’Enrico Macias, divorcé, remarié, il a eu de ces deux unions cinq enfants, avant de vivre quelques années avec Kate Barry, la fille de Jane Birkin dramatiquement disparue en 2013. Sa vie, qui pourrait ressembler à celle, joyeusement neurasthénique, de n’importe quel Juif ashkénaze français, a été marquée par un drame dont il est resté inconsolable. En 1492, trois marins profitent d’une escale aux Canaries de la flotte conduite par Christophe Colomb vers les Indes pour fausser compagnie à l’équipage. Au même moment, en Galice, dans le nord de l’Espagne, une femme tente de sauver sa sœur plongée dans le coma après une tentative de suicide.
En 1492, trois marins profitent d’une escale aux Canaries de la flotte conduite par Christophe Colomb vers les Indes pour fausser compagnie à l’équipage. Au même moment, en Galice, dans le nord de l’Espagne, une femme tente de sauver sa sœur plongée dans le coma après une tentative de suicide. Orpheline de mère, longtemps étouffée par un père et un frère possessifs, Ethero a désormais près de cinquante ans. Elle tient seule une petite épicerie dans un village reculé de la Colchide géorgienne. Après un accident en montagne, qui manque l’emporter, sa vie change du tout au tout. Restée vierge jusqu’alors, elle se donne sans préavis à Mourmane, le routier qui livre chaque semaine son magasin, et connaît dans ses bras ses premiers émois amoureux.
Orpheline de mère, longtemps étouffée par un père et un frère possessifs, Ethero a désormais près de cinquante ans. Elle tient seule une petite épicerie dans un village reculé de la Colchide géorgienne. Après un accident en montagne, qui manque l’emporter, sa vie change du tout au tout. Restée vierge jusqu’alors, elle se donne sans préavis à Mourmane, le routier qui livre chaque semaine son magasin, et connaît dans ses bras ses premiers émois amoureux. Paul Matthews (Nicolas Cage) est un scientifique raté qui végète dans une petite université où il enseigne sans passion la biologie. Sa vie bascule du jour au lendemain suite à un phénomène étrange qui lui attire une gloire soudaine. Une foule d’individus, plus ou moins proches de lui, le voient apparaître dans leurs rêves.
Paul Matthews (Nicolas Cage) est un scientifique raté qui végète dans une petite université où il enseigne sans passion la biologie. Sa vie bascule du jour au lendemain suite à un phénomène étrange qui lui attire une gloire soudaine. Une foule d’individus, plus ou moins proches de lui, le voient apparaître dans leurs rêves.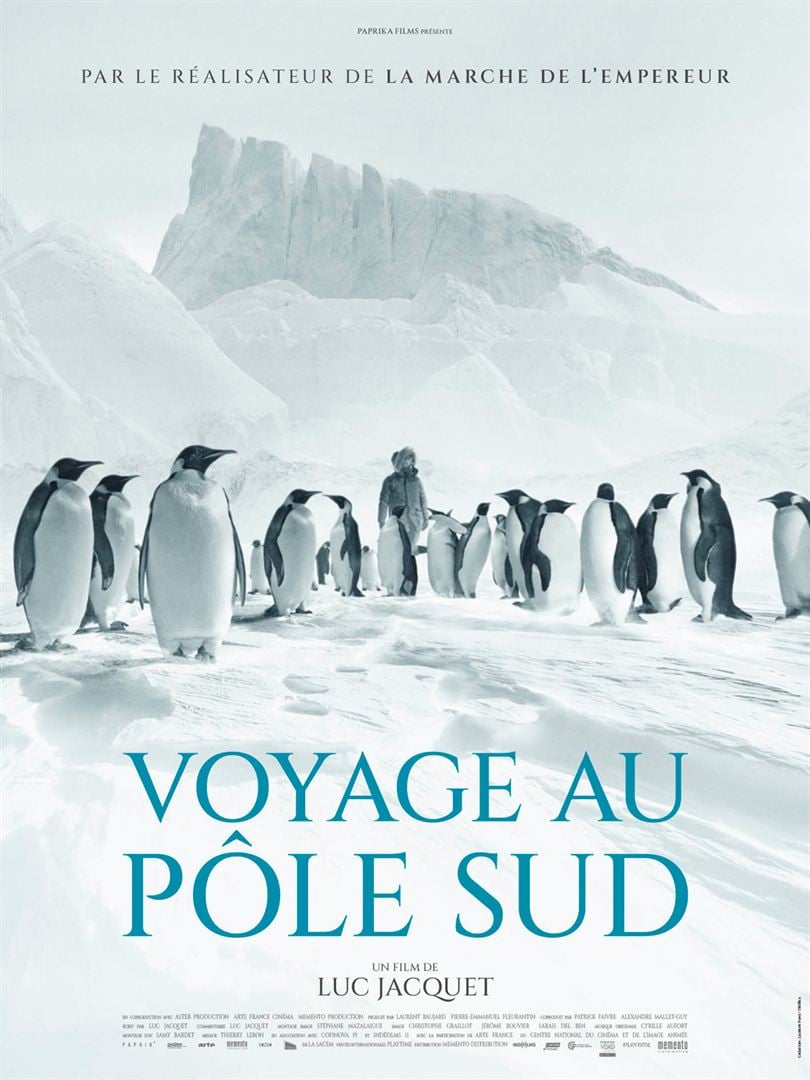 Écologue de formation, Luc Jacquet est un documentariste français qui a acquis une renommée mondiale grâce à son tout premier film, La Marche de l’empereur, sorti en 2005.
Écologue de formation, Luc Jacquet est un documentariste français qui a acquis une renommée mondiale grâce à son tout premier film, La Marche de l’empereur, sorti en 2005.