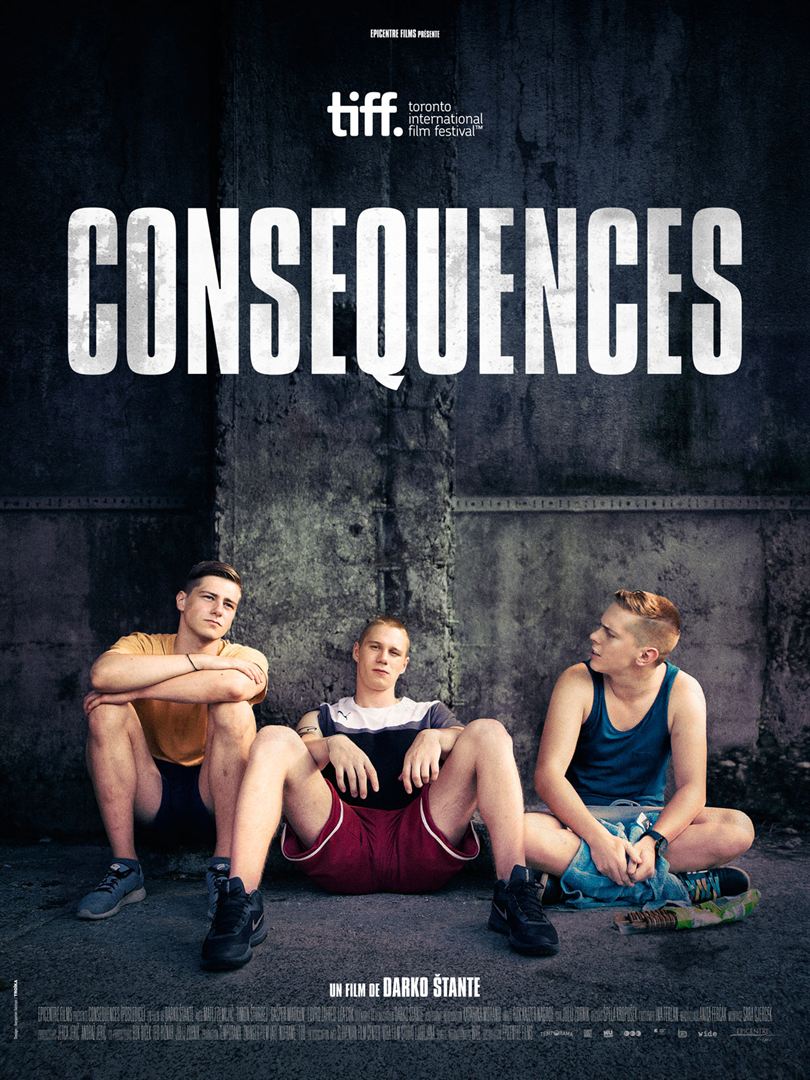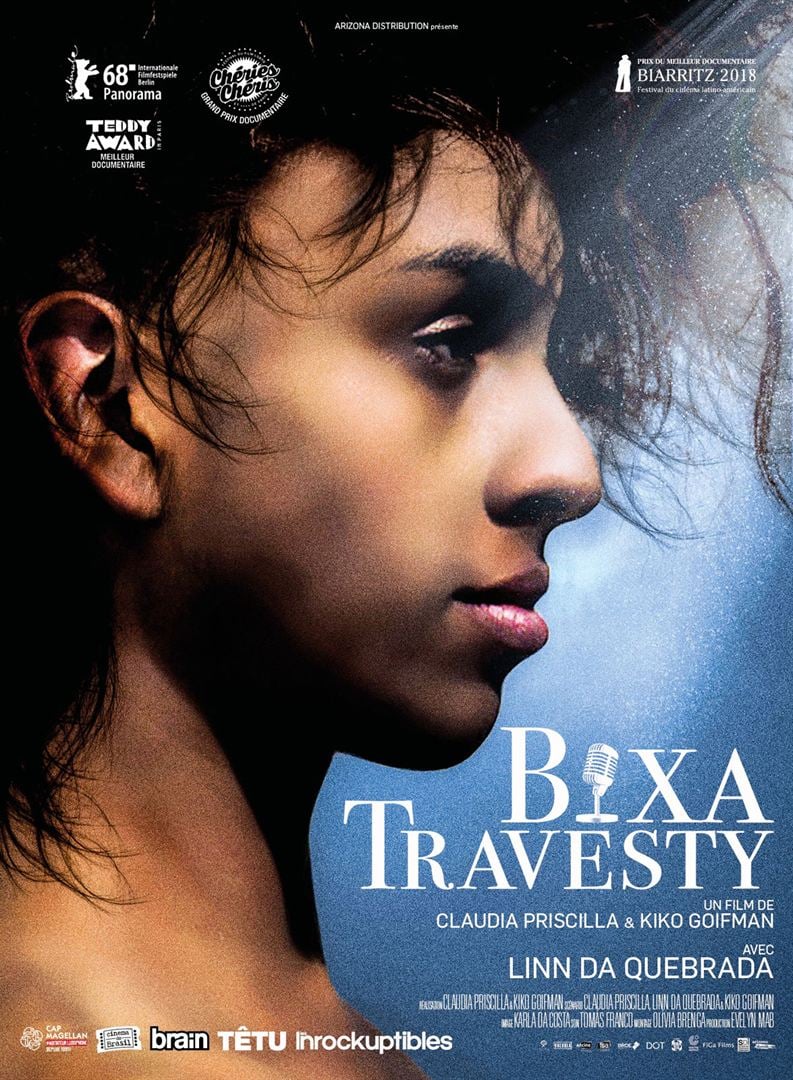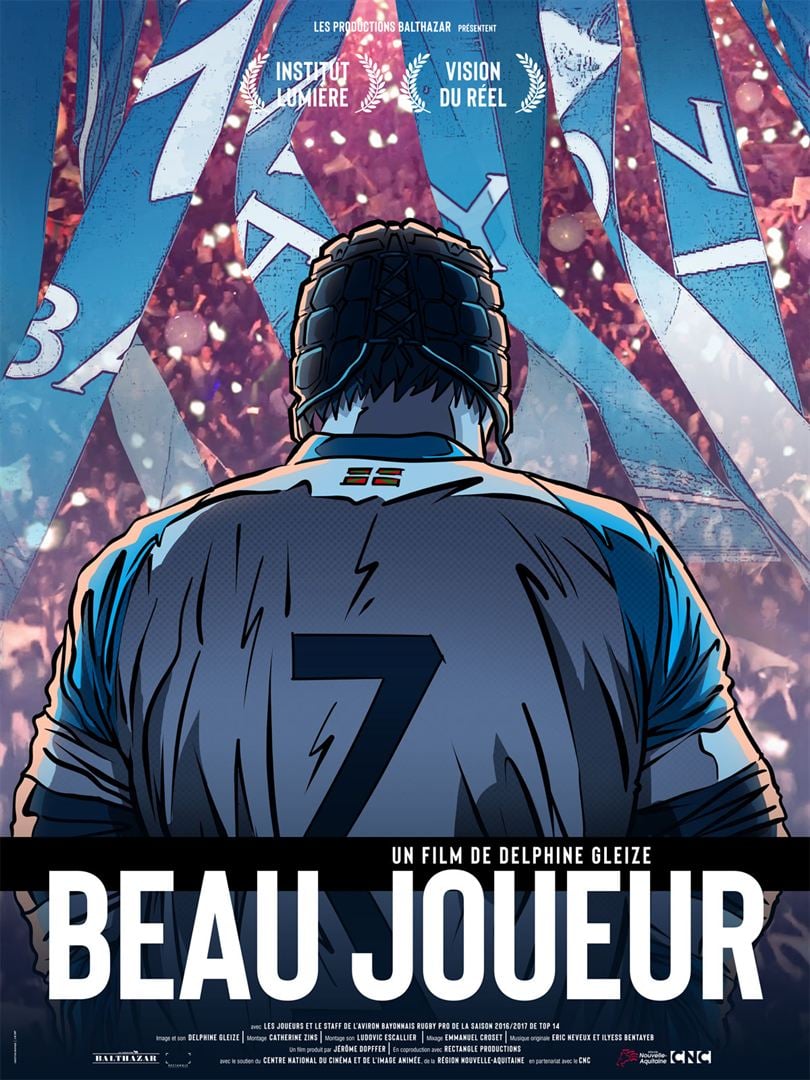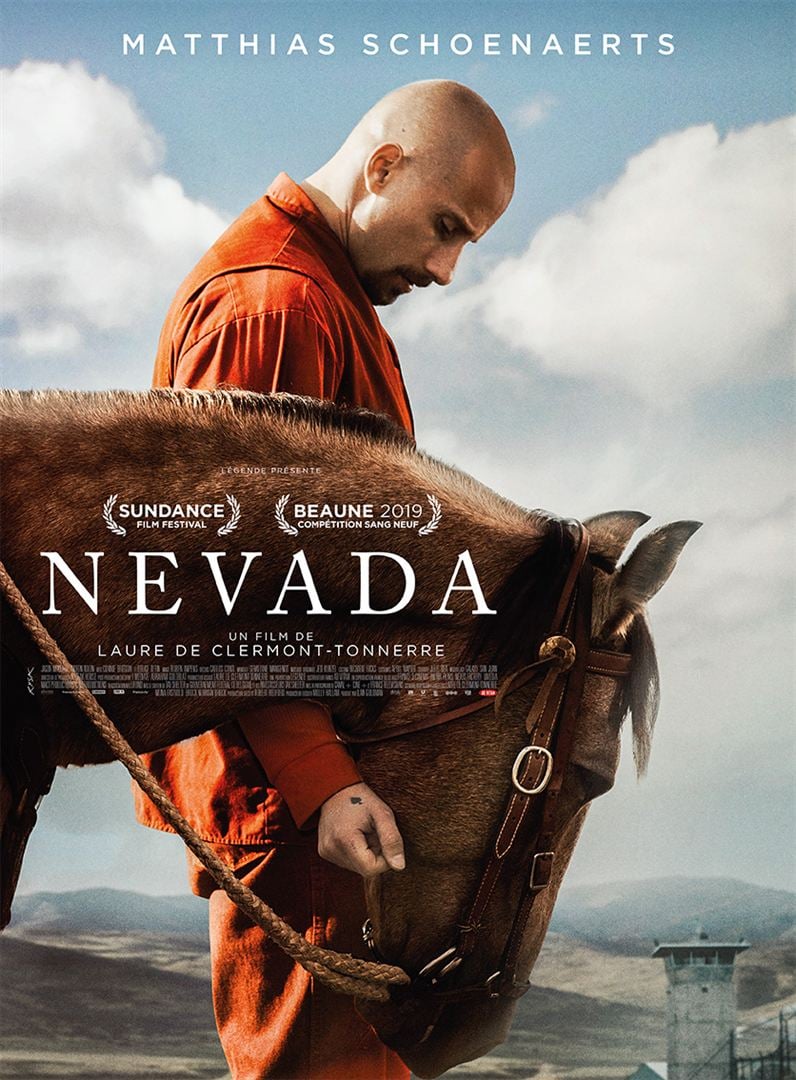Au début des années soixante-dix, dans le quartier chaud de Sankt-Pauli à Hambourg, Fritz Honka assassina au moins quatre prostituées, les dépeça et en dissimula les restes dans les soupentes de son appartement. Le réalisateur turco-allemand Fatih Akin reconstitue les faits avec un grand souci de réalisme.
J’ai découvert Fatih Akin au début des années 2000 en regardant lors d’un festival du film européen au Kenya son deuxième film, inédit en France, Im Juli. Je n’avais pas prêté attention au nom du réalisateur ; mais il m’est revenu à la mémoire trois ans plus tard à la sortie de Head On, une histoire d’amour tragique. Et, en 2007, ce fut le choc De l’autre côté : un scénario complexe, primé à Cannes, filmé avec une fluidité magistrale, qui auscultait le rapport entre la Turquie et l’Allemagne.
Depuis hélas, Fatih Akin s’était perdu. Soul Kitchen était une comédie brouillonne, The Cut une fresque historique laborieuse sur le génocide arménien. J’avoue ne pas être allé voir In the Fade, l’histoire d’une femme qui peine à se reconstruire après la mort de son mari, malgré le battage publicitaire fait autour de Diane Kruger. Le parfum de scandale qui entoure ce Golden Glove m’a incité à donner une dernière chance à Fatih Akin.
Bien m’en a pris. Car son dernier film ne laisse pas indifférent.
Interdit aux moins de seize ans en France (et aux moins de dix-huit en Allemagne), il décrit sans en rien cacher les violences sordides infligées par Honka à ses victimes, les coups, les insultes, les meurtres puis le démembrement de leurs dépouilles – façon Le père Noël est une ordure – et leur dissimulation. Il réussit à nous faire sentir l’odeur putride des corps en décomposition dans laquelle baigne la mansarde crasseuse qui lui sert d’appartement.
Voûté, édenté, affublé de lunettes monstrueuses, Jonas Dassler (aperçu l’an passé dans La Révolution silencieuse et qu’on retrouve dans le nouveau film de Florian Henckel von Donnersmarck L’Œuvre sans auteur) est méconnaissable. La reconstitution du rade minable où Honka avait ses habitudes, « Der goldene Handschuh » (littéralement « Le Gant d’or », en anglais « Golden Glove ») donne l’occasion de scènes tout droit sorties de Fassbinder. Dans les tons marronnasses sans lesquels il n’est pas de reconstitution des années soixante-dix défile la lie de la terre : poivrots bavards, prostituées syphilitiques, ancien soldat SS borgne…
Derrière le portrait d’un homme, pointe, comme chez Fassbinder, l’ambition de faire le procès d’un pays et d’une époque : l’Allemagne d’après-guerre à la peine avec son passé. C’est peut-être beaucoup pour un film dont le sujet se suffit à lui-même.
Ce n’est pas la première fois que le cinéma se coltine à la figure du serial killer : Henry Portrait of a serial killer (1986), Bad Boy Bubby (1993), American Psycho (2000), The House That Jack Built (2018)… À chaque fois l’expérience est éprouvante. La reconstitution des meurtres barbares dont ces assassins se sont rendus coupables en constitue un passage obligé qui retourne l’estomac. Certains s’essaient à la psychologie, essayant de comprendre les motifs de ces assassins. D’autres en restent au pur naturalisme de leurs faits.
Golden Glove ne dit rien du passé de Fritz Honka, si ce n’est qu’il avait une grande fratrie dont on n’aperçoit un frère aîné à peine plus équilibré que lui et aussi porté sur la bibine. Il nous fait partager son quotidien sordide jusqu’au haut-le-cœur. L’expérience est écœurante. Et fascinante. Welcome back Herr Akin!
La bande-annonce