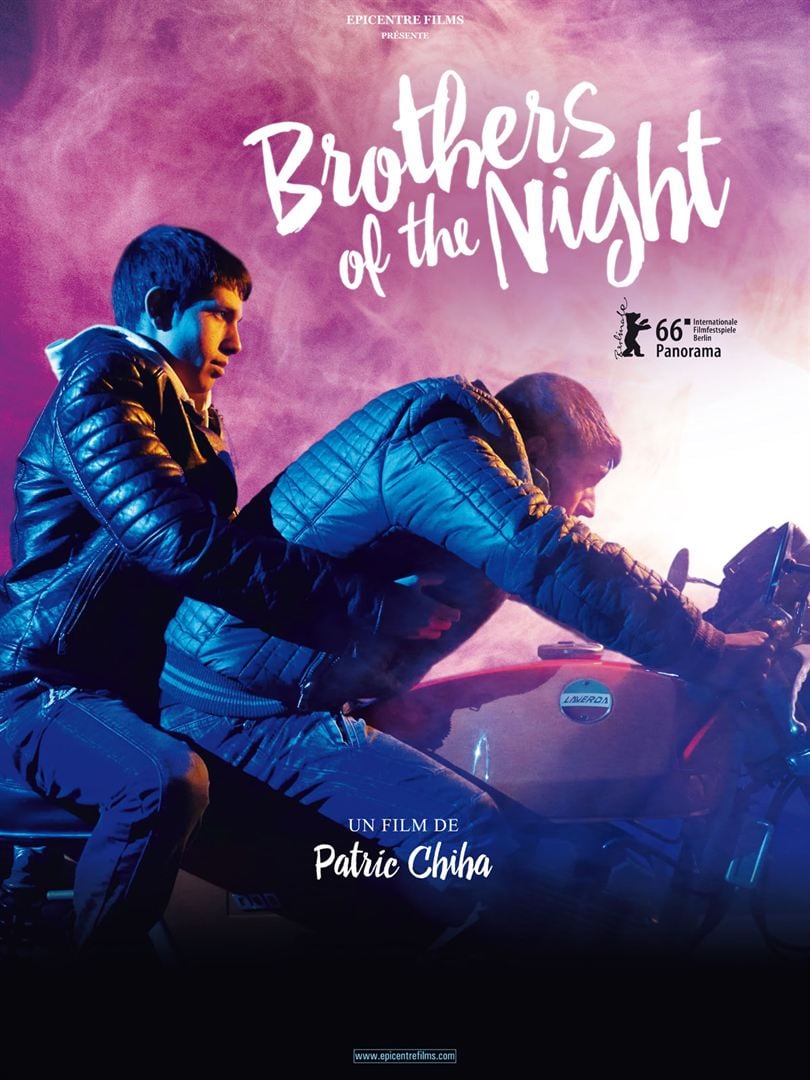 L’affiche hyperstylisée laisse augurer un film esthétisant sinon fétichiste louchant du côté de Rainer Fassbinder ou de Gregg Araki. Pourtant « Brothers of the Night » (bizarre titre français traduit de l’autrichien »Brüder der Nacht ») est un documentaire qui n’a rien de poétique. Il a pour sujet un groupe de Roms d’origine bulgare qui appâtent les clients du Rüdiger, un bar gay du centre de Vienne.
L’affiche hyperstylisée laisse augurer un film esthétisant sinon fétichiste louchant du côté de Rainer Fassbinder ou de Gregg Araki. Pourtant « Brothers of the Night » (bizarre titre français traduit de l’autrichien »Brüder der Nacht ») est un documentaire qui n’a rien de poétique. Il a pour sujet un groupe de Roms d’origine bulgare qui appâtent les clients du Rüdiger, un bar gay du centre de Vienne.
Rien ne prédisposait ces jeunes machos hypervirils, mariés et pères de famille, à ce « business ». Sinon l’extrême misère qui les a poussés hors de leur pays vers l’Occident et ses richesses fantasmées. Yonko, Stefan, Vassili, Asen n’ont que mépris pour les « pédés ». Le film explore ce paradoxe : comment des hétérosexuels pur jus peuvent-ils être conduits à devenir des gitons ?
Le sujet est glauque. Hélas il le reste. Car le documentaliste Patric Chiha prend le partie de ne pas s’échapper du cercle réduit de ces jeunes garçons. On ne verra jamais leurs clients pas plus qu’on ne verra leurs familles restées au pays. Du coup, le matériau se réduit aux témoignages, suscitées ou spontanées, de ces travailleurs du sexe qui racontent leur parcours, leur arrivée à Vienne avec l’espoir d’un travail et d’un salaire, leur découverte du Rüdiger et de son sale « business », leur dégoût, puis leur lente accoutumance.
Qu’entend-on ? Des histoires tristement répétitives dominées par la quête obsessionnelle de l’argent : l’argent qu’il faut extorquer au client, l’argent qu’il faut envoyer au pays. Qu’en retenir ? Que ces garçons sont des victimes ? Ils exercent ce « business » de leur plein gré et ne font partie d’aucune filière. Que ce sont des monstres froids et sans morale ? Leur procès n’est instruit ni à charge ni à décharge (si on ose dire). Que leur machisme est une posture fragile sous laquelle transperce une sexualité plus ambigüe qu’ils ne le pensent ? Ce serait donner plus de signification qu’elles n’en ont à certaines manifestations d’une simple amitié masculine.
À force de maintenir son sujet à distance, à force de s’interdire toute empathie, « Brothers of the Night » glace et lasse.

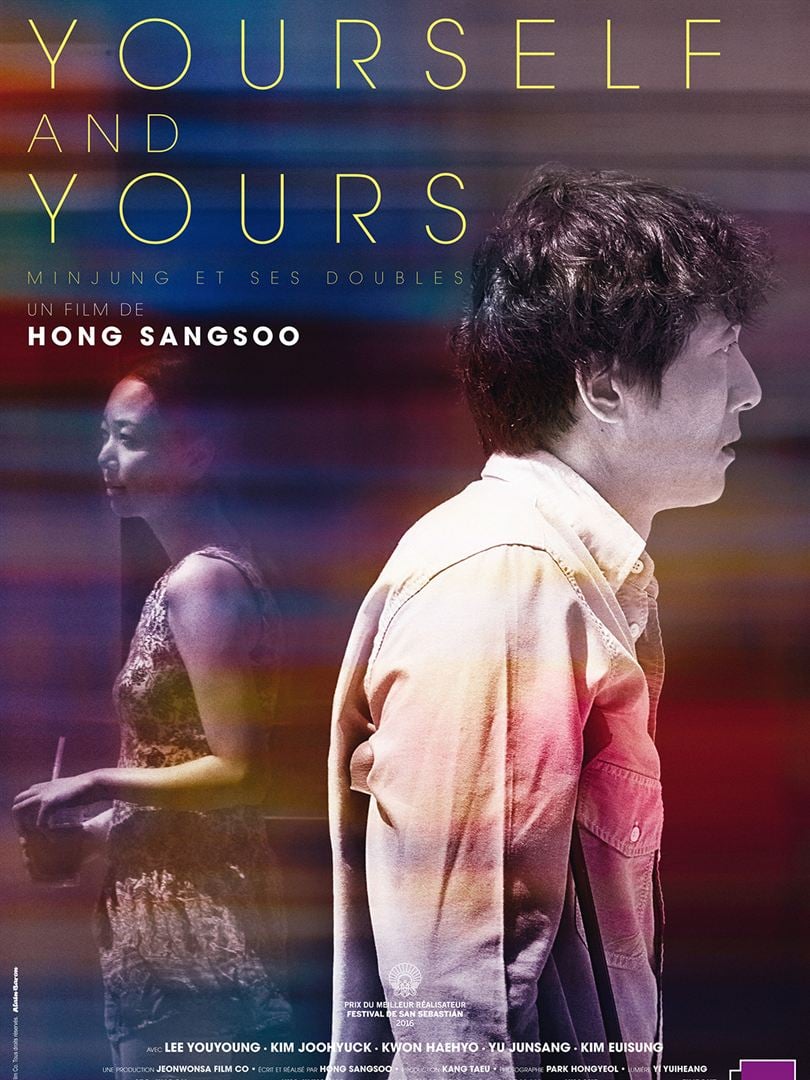 Comme tous les films du réalisateur coréen Hong Sangsoo, le scénario de celui-ci pourrait tenir sur un timbre poste. Un homme et une femme. Une rupture. D’impossibles retrouvailles.
Comme tous les films du réalisateur coréen Hong Sangsoo, le scénario de celui-ci pourrait tenir sur un timbre poste. Un homme et une femme. Une rupture. D’impossibles retrouvailles. La documentariste Claire Simon, l’auteur de
La documentariste Claire Simon, l’auteur de  Horacia vient de passer trente ans en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis. Pendant sa captivité, son mari est décédé, son fils a disparu, sa fille s’est éloignée d’elle. Horacia décide de se venger de l’homme à l’origine de son incarcération.
Horacia vient de passer trente ans en prison pour un crime qu’elle n’a pas commis. Pendant sa captivité, son mari est décédé, son fils a disparu, sa fille s’est éloignée d’elle. Horacia décide de se venger de l’homme à l’origine de son incarcération. On a tous en mémoire quelques images de Jackie Kennedy en novembre 1963 : tentant de s’extraire de la Lincoln Continental décapotable où son mari vient d’être abattu à Dallas, hagarde derrière Lyndon Johnson au moment où il prête serment dans l’avion qui les ramène à Washington, entourée de ses enfants lors des funérailles du président assassiné.
On a tous en mémoire quelques images de Jackie Kennedy en novembre 1963 : tentant de s’extraire de la Lincoln Continental décapotable où son mari vient d’être abattu à Dallas, hagarde derrière Lyndon Johnson au moment où il prête serment dans l’avion qui les ramène à Washington, entourée de ses enfants lors des funérailles du président assassiné.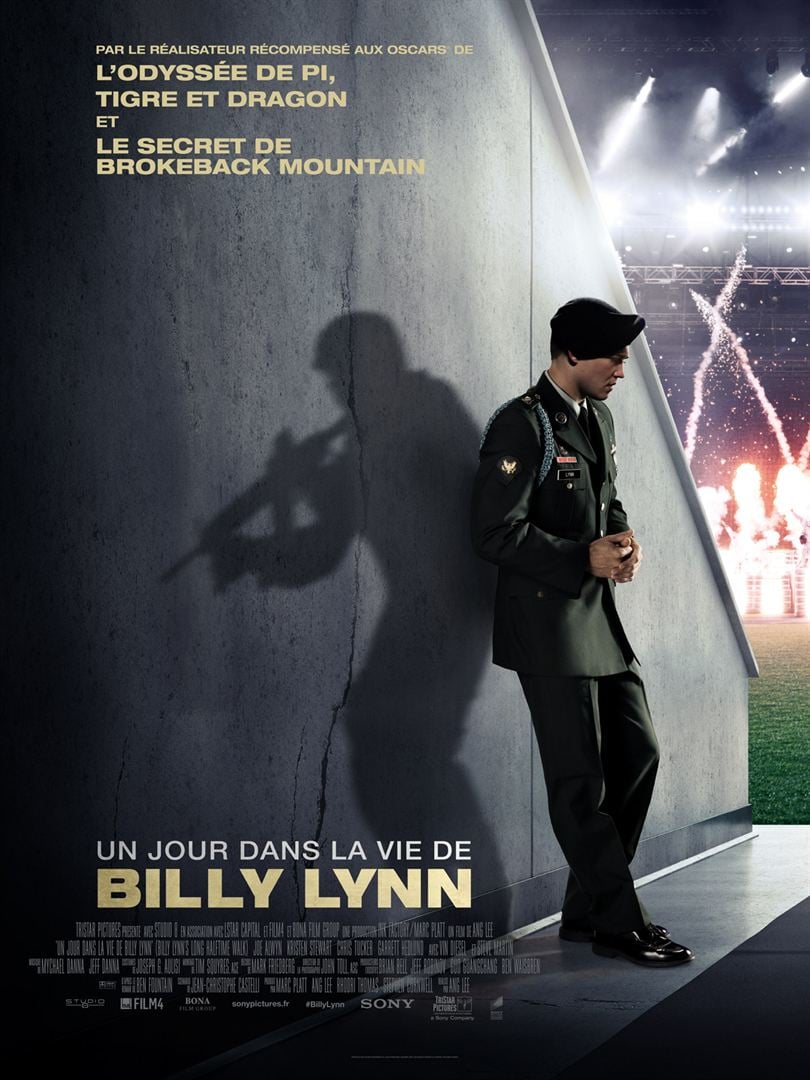 Billy Lynn et son unité d’infanterie connaissent une soudaine gloire médiatique pour avoir survécu à une embuscade en Irak. Au Texas, en 2004, ils sont invités à parader lors de la finale du Super Bowl.
Billy Lynn et son unité d’infanterie connaissent une soudaine gloire médiatique pour avoir survécu à une embuscade en Irak. Au Texas, en 2004, ils sont invités à parader lors de la finale du Super Bowl. Chiron a une dizaine d’années. Il vit à Miami dans le ghetto noir. Il est la tête de turc de ses camarades qui l’ont surnommé « Little ». Sa mère, qui se drogue et se prostitue, ne s’occupe guère de lui. Chiron s’est trouvé un père de substitution en Juan, un chef de gang.
Chiron a une dizaine d’années. Il vit à Miami dans le ghetto noir. Il est la tête de turc de ses camarades qui l’ont surnommé « Little ». Sa mère, qui se drogue et se prostitue, ne s’occupe guère de lui. Chiron s’est trouvé un père de substitution en Juan, un chef de gang.