
La cinquantaine bien entamée, Daniel Blake est un charpentier en arrêt de travail suite à l’infarctus dont il a été la victime. Il se bat pour obtenir une pension d’invalidité ou, à défaut, une indemnité de chômage. Il rencontre au « job center » Katie, une mère célibataire dans la même situation de précarité que lui.
Que celui qui n’aura pas été ému aux larmes par « Moi, Daniel Blake » se dénonce sur le champ. Ce film bouleversant ferait pleurer les pierres. Ken Loach y décrit, non sans ironie, un système anonyme et humiliant, prisonnier d’une logique de rentabilité, qui écrase ceux qu’il est censé secourir. Ce système ubuesque et déshumanisé, organisé avec des Call centers et des Printemps de Vivaldi, nous l’avons tous connu, qu’il s’agisse de s’inscrire à Pôle Emploi ou de changer le forfait de son abonnement Internet. Sa critique nous est immédiatement sympathique. Face à lui, des Daniel et des Katie tentent tant bien que mal de survivre et de conserver leur dignité. Leurs efforts et leurs échecs nous brisent le cœur.
Ken Loach n’a pas usurpé la Palme d’or qui lui a été décernée à Cannes. Elle a couronné un film autant qu’une œuvre toute entière dédiée à la dénonciation des injustices faites aux plus vulnérables. Pour autant, si l’on refuse, à rebours de toute correction politique, de se laisser kidnapper par la charge lourdement lacrymale que charrie « Moi, Daniel Blake », on osera deux critiques. Elles visent tant le dernier film de Ken Loach, que ses réalisations précédentes voire qu’un nombre significatif de films britanniques, tous d’ailleurs excellents, qui s’inscrivent dans la même veine (on pense par exemple à « Hector » sorti en décembre 2015 dont j’ai dit ici tout le bien que je pensais).
Ces films se répètent. Ils dénoncent l’inhumanité d’un système capitaliste qui broie les individus et insulte leur dignité. Déjà en 1993, Ken Loach m’avait ému aux larmes avec « Raining Stones ». C’était il y a près d’un quart de siècle. On pourrait lui reprocher de faire du surplace. Il répondrait peut-être que son indignation est toujours légitime car la situation des plus pauvres ne s’est pas améliorée, voire s’est aggravée.
Mais un autre malaise peut être pointé. Il vise une gauche bobo – à laquelle je m’identifie volontiers – qui se délecte des films de Ken Loach – ou de ceux des frères Dardenne ou de Philippe Lioret. Cette gauche bobo adore ces films marqués au fer du réalisme social qui prennent fait et cause pour les plus marginaux. En témoigne l’an passé le succès, mérité, de « Fatima » de Philippe Faucon ou de « La Loi du marché » de Stéphane Brizé. Elle les applaudit le samedi soir à l’UGC Danton ou au MK2 Beaubourg. Et puis, elle va dîner dans un restaurant japonais du 5ème et rentre dormir dans l’appartement parisien confortable dont les salaires d’une vie de smicard ne suffiraient pas à acheter la place de parking en sous-sol.

 Je place les frères Dardenne au sommet. Au sommet de mon palmarès personnel : « Rosetta », « Le Silence de Lorna », « Le Gamin au vélo » figurent parmi mes films préférés. Au sommet, je crois aussi, de la cinématographie de ce début de siècle. Je prends le pari que, dans un siècle, leurs noms seront cités parmi la dizaine de réalisateurs marquants de notre temps.
Je place les frères Dardenne au sommet. Au sommet de mon palmarès personnel : « Rosetta », « Le Silence de Lorna », « Le Gamin au vélo » figurent parmi mes films préférés. Au sommet, je crois aussi, de la cinématographie de ce début de siècle. Je prends le pari que, dans un siècle, leurs noms seront cités parmi la dizaine de réalisateurs marquants de notre temps.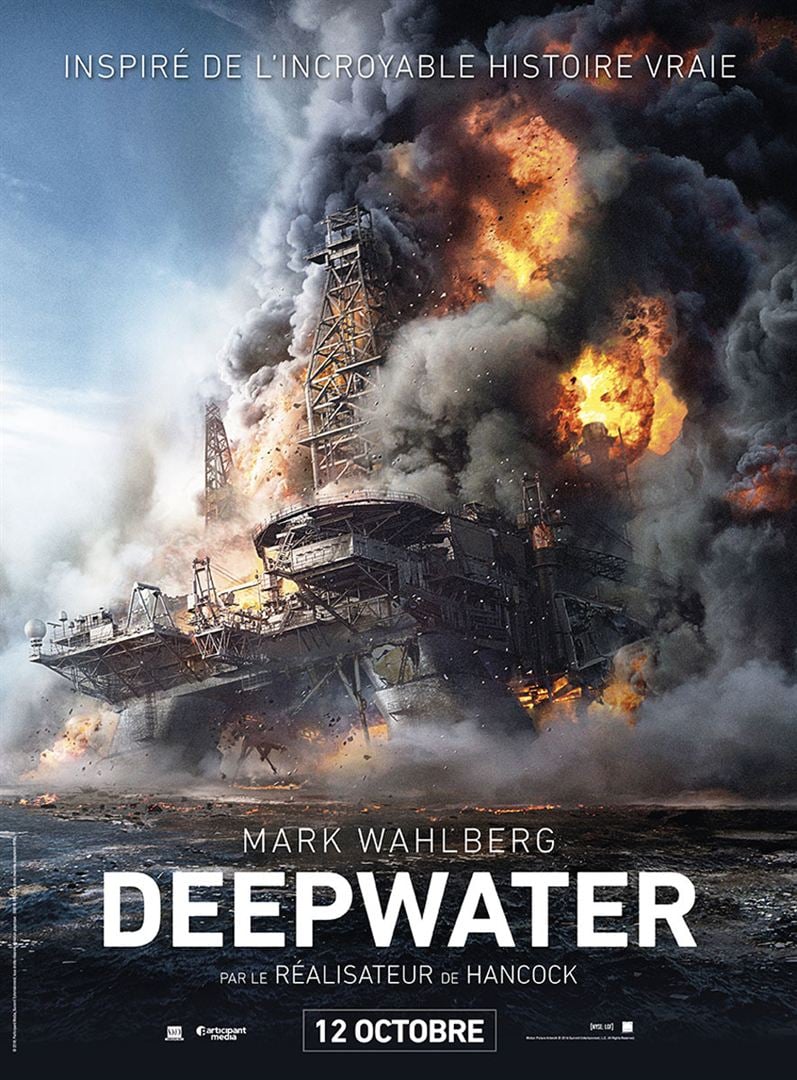
 Coup de cœur pour « L’Odyssée » bien mal servi par une critique assassine (celle du Monde gagne la Palme de la méchanceté vipérine) mais qui rencontre depuis mercredi un succès public mérité.
Coup de cœur pour « L’Odyssée » bien mal servi par une critique assassine (celle du Monde gagne la Palme de la méchanceté vipérine) mais qui rencontre depuis mercredi un succès public mérité.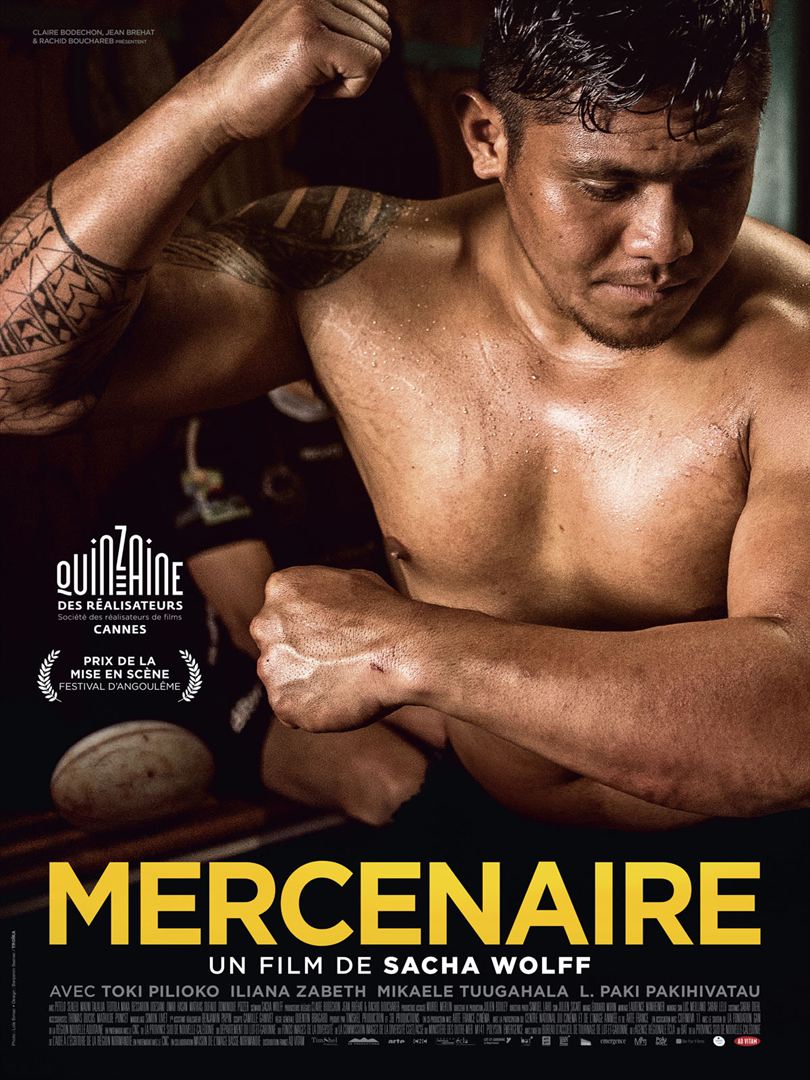
 Les Dossiers de l’Écran présentent : « Radicalisation : Des clés pour comprendre » avec un film de Marie-Castille Mention-Schaar qui raconte en parallèle l’histoire – vraie sinon vraisemblable – de Mélanie qui se radicalise et de Sonia qui se deradicalise.
Les Dossiers de l’Écran présentent : « Radicalisation : Des clés pour comprendre » avec un film de Marie-Castille Mention-Schaar qui raconte en parallèle l’histoire – vraie sinon vraisemblable – de Mélanie qui se radicalise et de Sonia qui se deradicalise.