 La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.
La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.
Trois ans plus tard, dans un autre État américain, plusieurs viols sont commis selon le même modus operandi. Deux inspectrices tenaces n’ont de cesse d’en découvrir l’auteur. L’enquête permettra ainsi de rendre justice à la jeune Marie dont la parole n’avait pas été écoutée.
Les agressions sexuelles, les femmes qui en sont victimes, leurs difficultés à faire entendre leur témoignage : le sujet est d’une brûlante actualité. Unbelievable s’en empare à bras-le-corps, à commencer par son titre, d’une intelligente polysémie : impossible à croire, le témoignage de cette victime ? impossible à croire les épreuves qu’elle a dû traverser jusqu’à ce que la vérité éclate ?
Unbelievable a une immense qualité : le scénario, inspiré d’une histoire vraie qui s’est déroulée entre 2008 et 2011 et qui a fait l’objet d’une longue enquête journalistique couronnée par le Prix Pulitzer, ne sombre jamais dans le manichéisme. Si la violence systémique subie par Marie est clairement dénoncée, elle s’exprime à travers des personnages qui, tous, de sa mère adoptive qui comprend d’autant moins la réaction de la jeune fille qu’elle a elle-même été violée vingt ans plus tôt, aux deux inspecteurs qui remettent en cause son témoignage, se comportent avec elle avec une douceur melliflue.
Unbelievable a une autre qualité : sa durée. La mini-série de huit épisodes dure au total près de sept heures, ce qui laisse à la narration le temps de prendre son temps, le temps par exemple de nous entraîner sur une fausse piste là où un film de deux heures ne saurait se le permettre.
Mais Unbelievable a pour autant un défaut. Son titre, son pitch nous laissent augurer une histoire qui aurait pu se suffire à elle-même : celle d’une femme violée dont le témoignage n’est pas cru. Mieux, elle aurait pu laisser planer un suspense : Marie a-t-elle été vraiment victime du viol qu’elle déclare avoir subi ? Mais la série ne prend pas cette direction-là. Dès les premières images, aucun doute n’est permis : le viol a bien eu lieu.
La série prend une autre direction. Elle nous entraîne au Colorado, dans une enquête policière sur les traces du violeur en série dont on comprend bien vite qu’il a attaqué Marie trois ans plus tôt à près de deux milles kilomètres de là.
Certes, la traque par Toni Collette et Merritt Wever de ce violeur suffit à nous tenir en haleine pendant les sept derniers épisodes. Mais on y perd malheureusement de vue ce qui aurait dû rester au centre de la série. Si j’avais eu mon stylo rouge, j’aurais écrit : « très bien, mais attention au Hors sujet ».

 1986. Gorbachev est arrivé au pouvoir en URSS et fait souffler un vent nouveau dans le Bloc de l’Est. La RDA prend l’eau. Acculée à la faillite, elle doit trouver à tout prix des capitaux, quitte à renier ses idéaux. La rentabilité financière des opérations qu’il mène est devenue le mètre-étalon du HVA, le service d’espionnage est-allemand où Annett Schneider (Sonja Gehrardt) travaille désormais avec l’enthousiasme des néophytes.
1986. Gorbachev est arrivé au pouvoir en URSS et fait souffler un vent nouveau dans le Bloc de l’Est. La RDA prend l’eau. Acculée à la faillite, elle doit trouver à tout prix des capitaux, quitte à renier ses idéaux. La rentabilité financière des opérations qu’il mène est devenue le mètre-étalon du HVA, le service d’espionnage est-allemand où Annett Schneider (Sonja Gehrardt) travaille désormais avec l’enthousiasme des néophytes.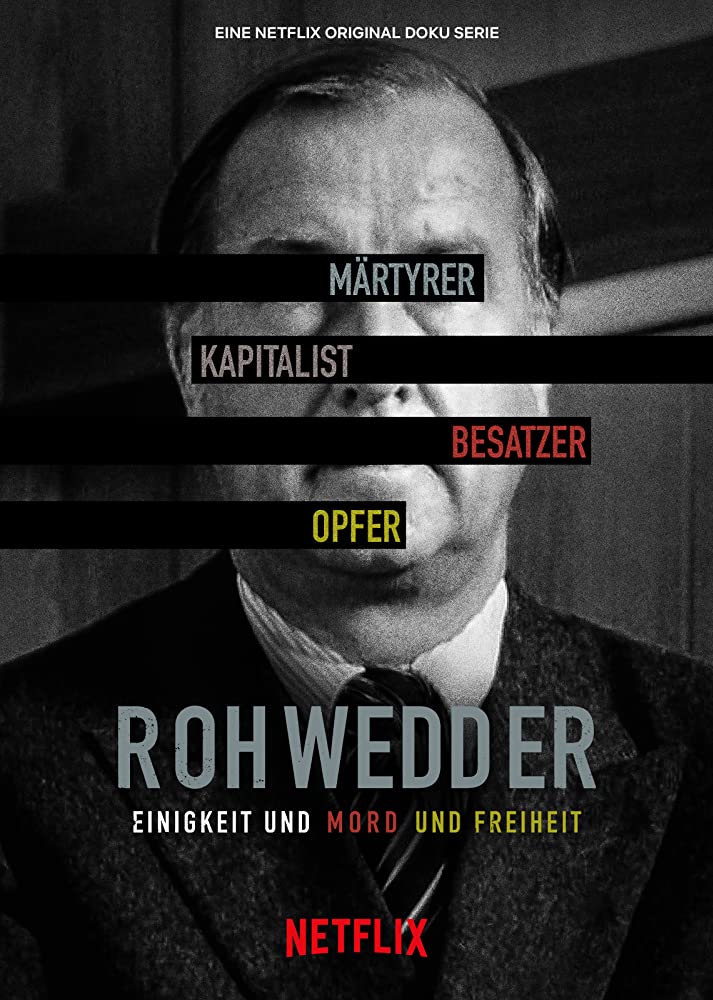 Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux.
Qui a assassiné à Düsseldorf le 1er avril 1991 Detlev Rohwedder, le patron de la Treuhandanstalt, la structure de défaisance créée pour vendre les actifs industriels de l’Allemagne de l’est récemment réunifiée ? Des combattants de la troisième génération de la Fraction armée rouge (RAF) en croisade contre le capitalisme et ses patrons qui l’incarnent ? Des mercenaires de la Stasi en rupture de ban après leur brutale mise à pied ? Ou une organisation para-étatique secrète ? Le crime n’a jamais été élucidé. Une mini-série allemande distribuée par Netflix en septembre 2020 reprend en quatre épisodes l’enquête sur ce meurtre mystérieux.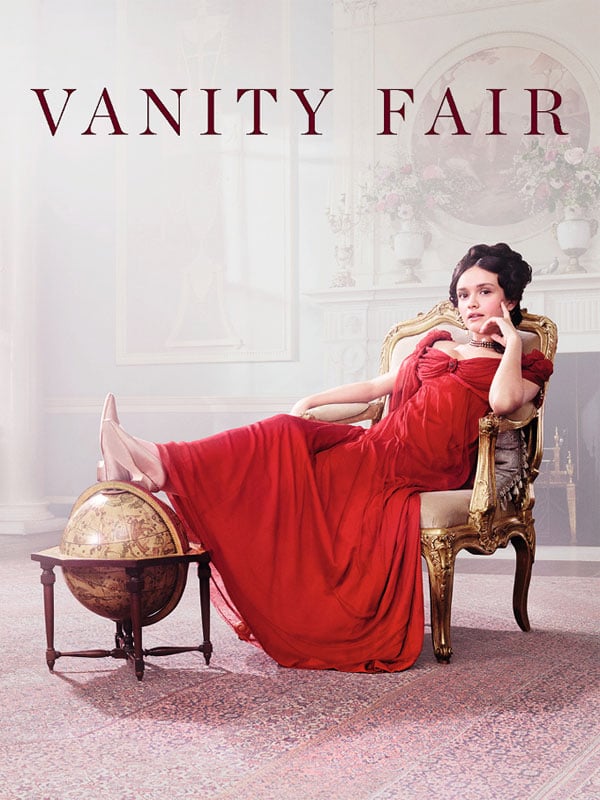 Rebecca Sharp (Olivia Cooke, brunette piquante qu’on avait remarquée dans
Rebecca Sharp (Olivia Cooke, brunette piquante qu’on avait remarquée dans  Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois commandos terroristes sèment la terreur à Paris : le premier aux abords du Stade de France où trois assaillants essaient de pénétrer pendant le match France-Allemagne, le deuxième dans les rues de l’Est parisien en rafalant les badauds en terrasse de plusieurs établissements, le troisième à l’intérieur du Bataclan.
Dans la nuit du 13 novembre 2015, trois commandos terroristes sèment la terreur à Paris : le premier aux abords du Stade de France où trois assaillants essaient de pénétrer pendant le match France-Allemagne, le deuxième dans les rues de l’Est parisien en rafalant les badauds en terrasse de plusieurs établissements, le troisième à l’intérieur du Bataclan.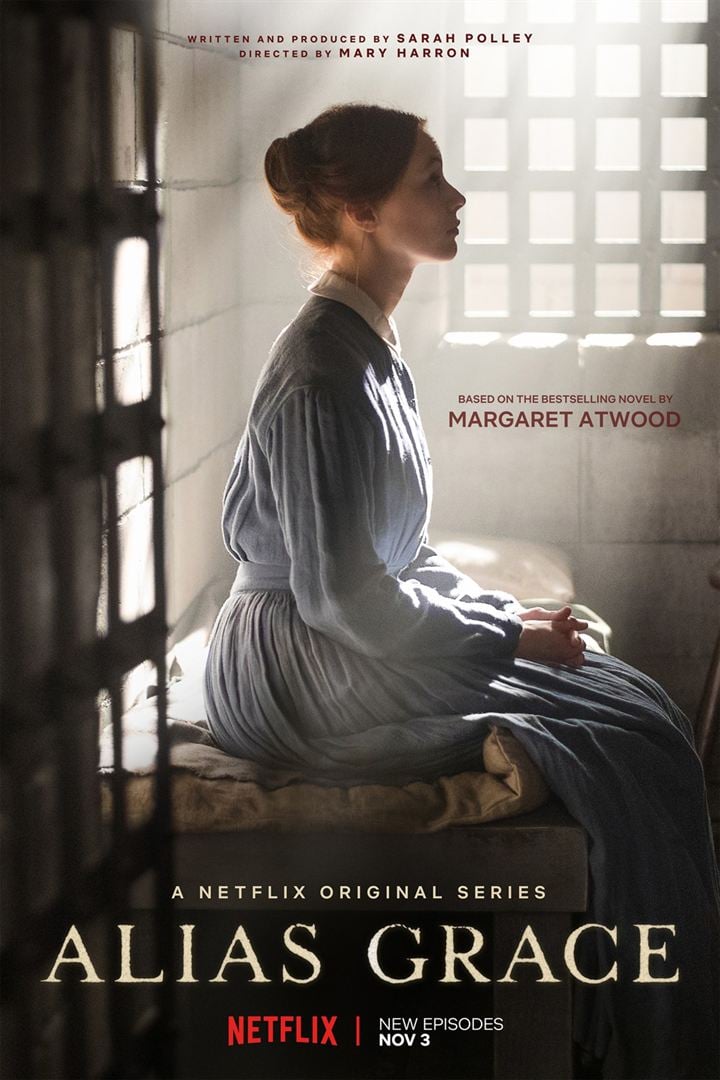 Au milieu du dix-neuvième siècle, au Canada, dans la province de l’Ontario, Grace Marks et James McDermott furent accusés du double meurtre de leur employeur, Thomas Kinnear, et de sa gouvernante, Nancy Montgomery. Si McDermott fut pendu, la peine de Grace Marks fut commuée en prison à vie. Quelques années après son procès, un jeune psychiatre obtient le droit de l’interroger. Captive raconte leur face-à-face.
Au milieu du dix-neuvième siècle, au Canada, dans la province de l’Ontario, Grace Marks et James McDermott furent accusés du double meurtre de leur employeur, Thomas Kinnear, et de sa gouvernante, Nancy Montgomery. Si McDermott fut pendu, la peine de Grace Marks fut commuée en prison à vie. Quelques années après son procès, un jeune psychiatre obtient le droit de l’interroger. Captive raconte leur face-à-face. Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak.
Move est une mini-série documentaire Netflix en cinq épisodes. Elle nous propose un tour de monde de la danse contemporaine à travers les portraits qu’elle dessine de cinq des plus grands chorégraphes au monde : Jon Boogz et Lil Buck aux Etats-Unis, Ohad Naharin en Israël, Israel Galvan en Espagne, Kimiko Versatile à la Jamaïque, Akram Khan au Royaume-Uni. Chacun a inventé un langage chorégraphique bien à lui tel la méthode Gaga ou exploré, développé, modernisé révolutionné, un style déjà ancien tel le flamenco ou le kathak. Cap sur le Congrès (Knock Down the House) suit la campagne électorale de quatre femmes dans le Nevada, le Missouri, la Virginie-Occidentale et l’Etat de New York. Repérées et soutenues par les associations Brand New Congress et Justice Congress, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush and Paula Jean Swearengin participent aux élections primaires qui doivent désigner le candidat démocrate aux élections de mi-mandat 2018 à la Chambre des Représentants et au Sénat. Chacune affronte des hommes politiques élus de longue date, solidement installés et soutenus par l’Establishment.
Cap sur le Congrès (Knock Down the House) suit la campagne électorale de quatre femmes dans le Nevada, le Missouri, la Virginie-Occidentale et l’Etat de New York. Repérées et soutenues par les associations Brand New Congress et Justice Congress, Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Vilela, Cori Bush and Paula Jean Swearengin participent aux élections primaires qui doivent désigner le candidat démocrate aux élections de mi-mandat 2018 à la Chambre des Représentants et au Sénat. Chacune affronte des hommes politiques élus de longue date, solidement installés et soutenus par l’Establishment. Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père.
Assane Diop (Omar Sy) est orphelin. Vingt ans plus tôt, son père est mort en prison, dans d’obscures circonstances, après avoir été injustement soupçonné du vol du Collier de la reine, propriété de ses patrons, M. et Mme Pellegrini. Assane a grandi solitairement. Fan d’Arsène Lupin dont il a lu toutes les Aventures, il utilise ses dons pour la cambriole pour commettre, toujours avec élégance, mille larcins. Quand on annonce que le Collier de la reine a été retrouvé et qu’il sera bientôt mis en vente, Assane n’a plus qu’une idée en tête : le dérober afin de laver l’honneur de son père. The Crown est de retour. Un an après
The Crown est de retour. Un an après