 Au tournant du XIVème siècle, l’Angleterre d’Edouard Ier, profitant d’une crise de succession à la tête du royaume d’Écosse, a progressivement mis la main sur son voisin septentrional. Mais le joug de Londres est mal ressenti par ce peuple viscéralement attaché à son indépendance.
Au tournant du XIVème siècle, l’Angleterre d’Edouard Ier, profitant d’une crise de succession à la tête du royaume d’Écosse, a progressivement mis la main sur son voisin septentrional. Mais le joug de Londres est mal ressenti par ce peuple viscéralement attaché à son indépendance.
Robert Bruce (Chris Pine) a dû faire allégeance au roi d’Angleterre. Mais dès 1306, il se met hors-la-loi en assassinant son rival John Comyn et en se faisant couronner roi d’Écosse. Edouard Ier vieillissant envoie son fils, le futur Edouard II (Billy Howle), mater la rébellion écossaise.
Outlaw King commence quasiment au moment de l’histoire d’Écosse où Braveheart, le film de 1995 de Mel Gibson (avec Sophie Marceau !) se terminait. On peut d’ailleurs le suspecter d’avoir voulu chasser sur les mêmes terres son succès public et critique en en reproduisant les mêmes ingrédients : une coûteuse reconstitution de l’Écosse médiévale, de la violence des combats qui l’opposa à l’Angleterre des Plantagenêts, de son irréductible nationalisme.
Le film produit par Netflix a coûté cent vingt millions de dollars. Et cet argent se voit. Le spectateur en prend plein les yeux devant la majestueuse beauté des paysages écossais et la sombre mêlée des armées en guerre. Son seul regret : ne pas pouvoir jouir du spectacle devant un grand écran.
Mais Outlaw King souffre de son académisme guindé. Rien ne dépasse dans sa reconstitution scrupuleuse du combat mené par Robert Bruce et sa poignée de desperados pour défendre son pays. Sans doute ce combat prend-il une résonnance particulière au lendemain du Brexit et du succès du SNP, le parti nationaliste favorable à un référendum qui, après celui de 2014 perdu d’un cheveu, pourrait ouvrir la voie de l’indépendance. Mais cette dimension-là ne suffit pas à elle seule à donner suffisamment d’intérêt à ce spectacle trop convenu.

 Rachel et Nick sont chinois. Elle est née aux États-Unis, lui à Singapour.
Rachel et Nick sont chinois. Elle est née aux États-Unis, lui à Singapour. Harry Rawlins (Liam Neeson) et ses trois complices disparaissent dans un braquage qui tourne mal. Leur butin part en fumée. Problème : ces deux millions de dollars appartenaient à Jamal Manning, un parrain de la mafia qui les réclame illico à Veronica Rawlins.
Harry Rawlins (Liam Neeson) et ses trois complices disparaissent dans un braquage qui tourne mal. Leur butin part en fumée. Problème : ces deux millions de dollars appartenaient à Jamal Manning, un parrain de la mafia qui les réclame illico à Veronica Rawlins. Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats.
Tout se délite autour de Chela, une grande bourgeoise déshéritée. Pour éponger ses dettes, son argenterie est mise à l’encan. Mais cela n’évitera pas à Carmela, sa compagne de longue date, d’aller passer quelques mois en prison pour fraude, ainsi que la loi paraguayenne le prévoit pour les payeurs indélicats.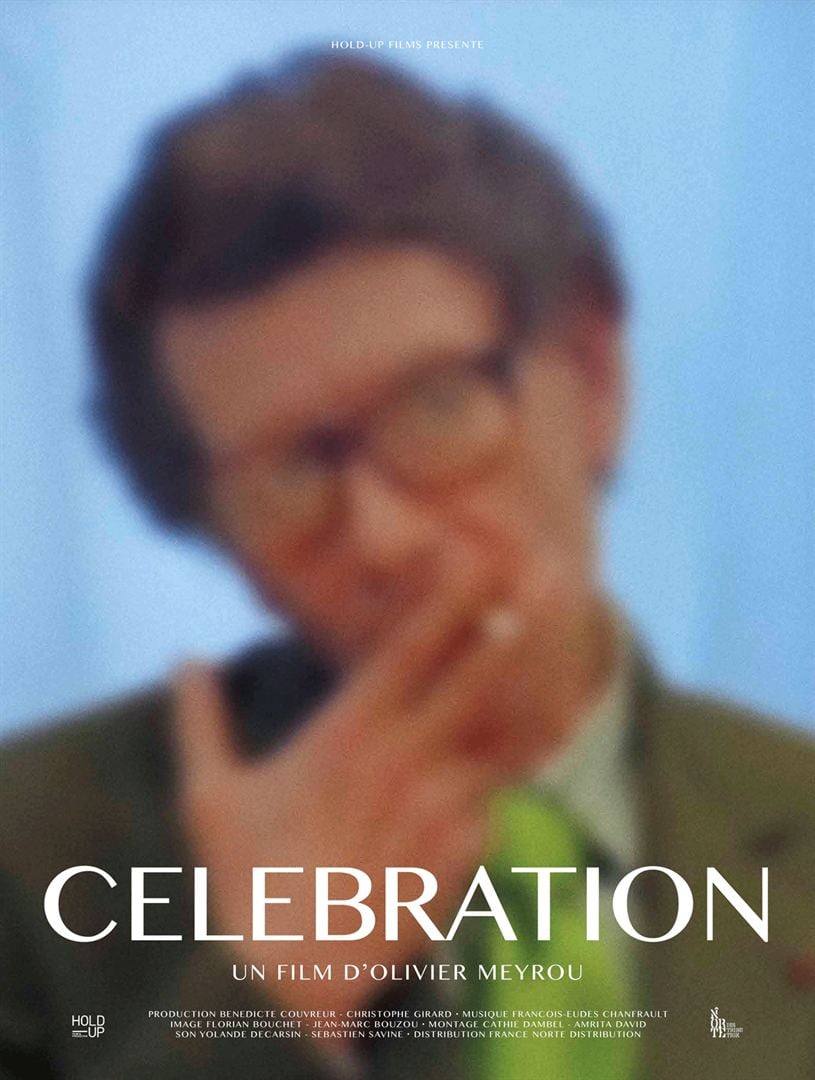 De 2000 à 2002 Olivier Meyrou a été autorisé par Pierre Bergé à filmer les coulisses de la maison Yves Saint-Laurent : les essayages avec Laetitia Casta, la remise d’un prix à new York, les préparations des grands défilés…
De 2000 à 2002 Olivier Meyrou a été autorisé par Pierre Bergé à filmer les coulisses de la maison Yves Saint-Laurent : les essayages avec Laetitia Casta, la remise d’un prix à new York, les préparations des grands défilés…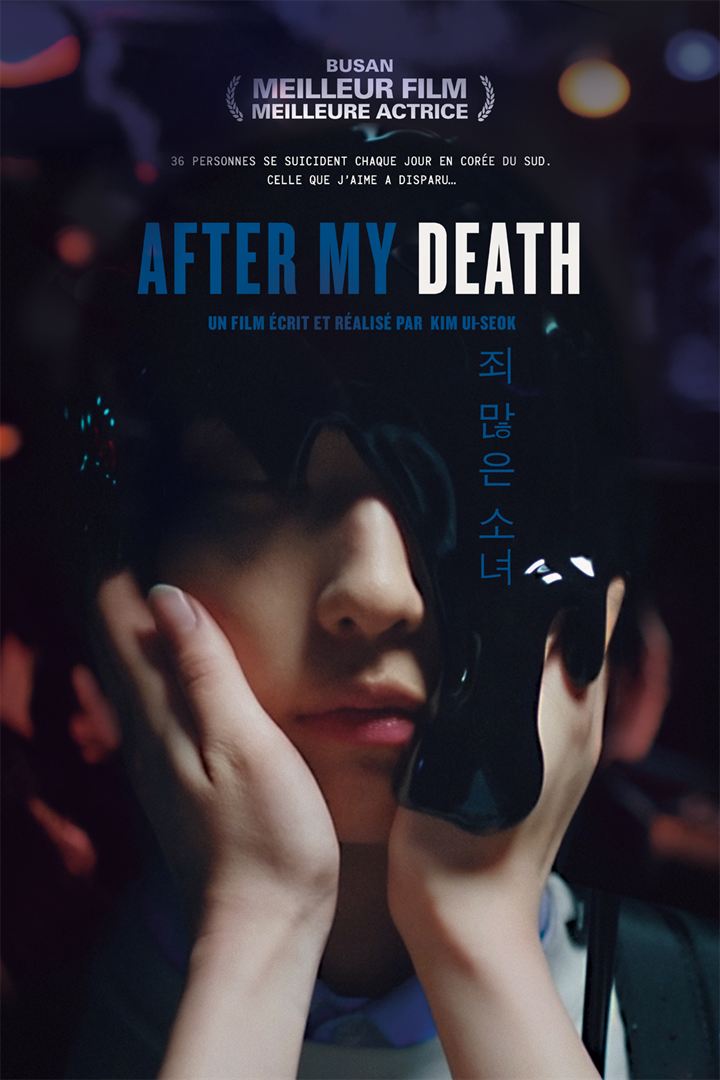 Kyung-min, une jeune lycéenne, disparaît mystérieusement. La police suspecte un suicide. Young-hee, une camarade, est la dernière à l’avoir vue vivante. La police, la mère de la disparue, ses amies d’école l’accablent de reproches.
Kyung-min, une jeune lycéenne, disparaît mystérieusement. La police suspecte un suicide. Young-hee, une camarade, est la dernière à l’avoir vue vivante. La police, la mère de la disparue, ses amies d’école l’accablent de reproches.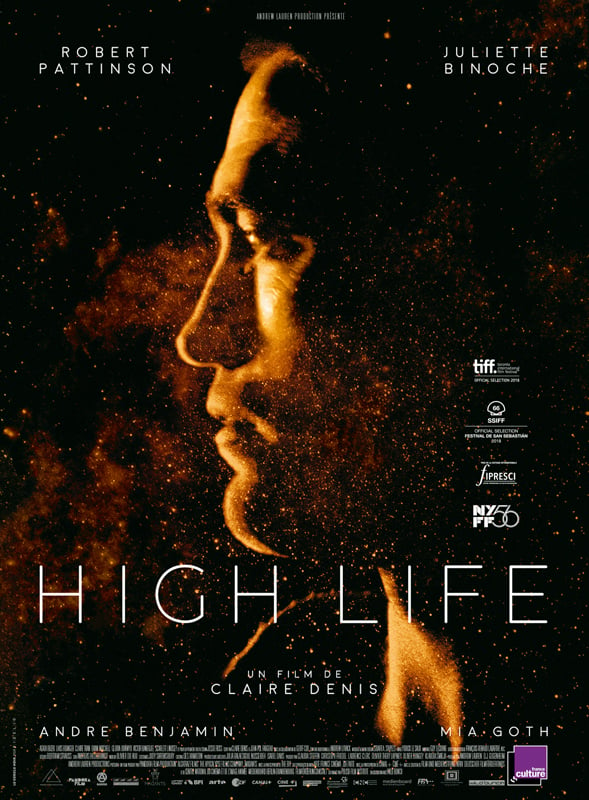 L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine.
L’action de High Life se déroule dans une navette spatiale projetée aux marges de notre univers. On comprend que son équipage a été constitué de repris de justice dont la condamnation à mort a été commuée pour participer à cette mission probablement sans retour. Ils sont accompagnés d’une doctoresse (Juliette Binoche) qui travaille sur la reproduction humaine.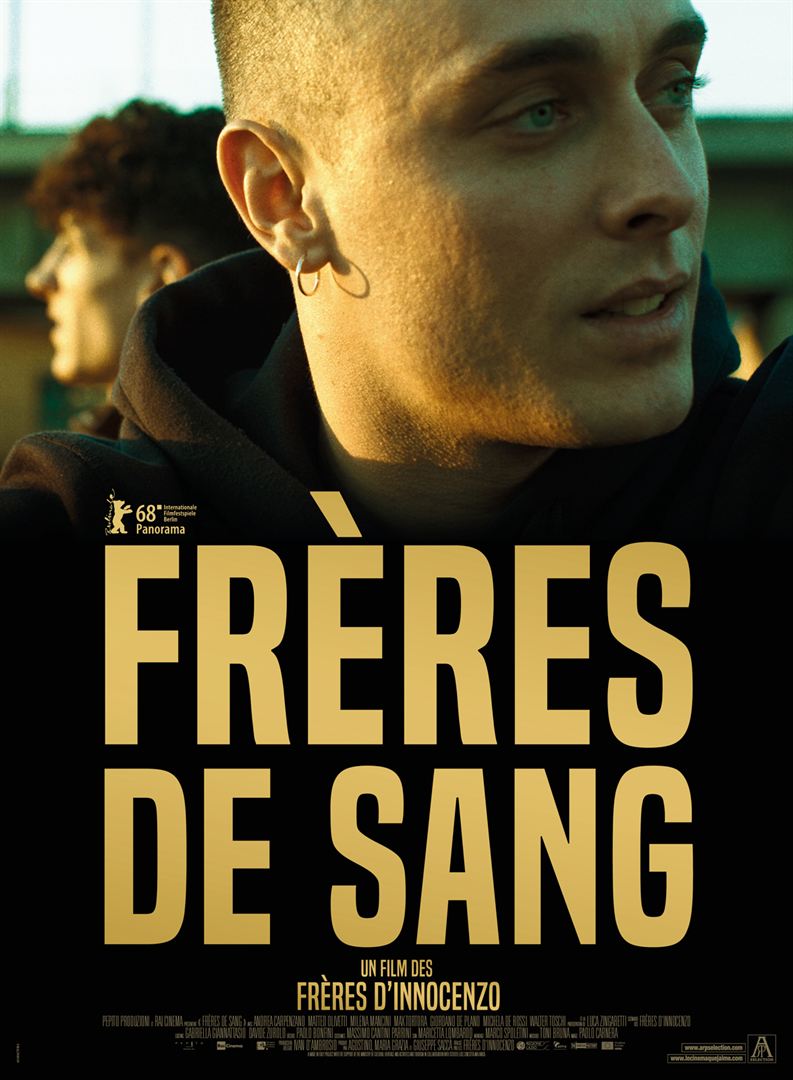 Manolo et Mirko ne savent pas que faire de leurs vingt ans. Vaguement inscrits dans un lycée hôtelier, ils tuent le temps en discutant et en roulant dans la banlieue de Rome. Mais une nuit, alors qu’ils ont bu plus que de raison, ils fauchent un piéton et le laissent pour mort.
Manolo et Mirko ne savent pas que faire de leurs vingt ans. Vaguement inscrits dans un lycée hôtelier, ils tuent le temps en discutant et en roulant dans la banlieue de Rome. Mais une nuit, alors qu’ils ont bu plus que de raison, ils fauchent un piéton et le laissent pour mort. Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige.
Élisa est à l’âge de tous les commencements. Elle est sur le point de quitter la maison familiale, une ferme perdue dans les montagnes du Vercors, pour poursuivre ses études à Montpellier en colocation avec sa meilleure amie. Mais Élisa a une sœur aînée, Manon, lourdement handicapée. Et quand leur mère abandonne le foyer, Élisa se sent obligée de seconder son père dans l’attention de chaque instant que Manon exige. À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.
À Tunis de nos jours. Sami est fils unique. Il prépare son bac. Il est l’enfant chéri de Riad et de Sazli, un couple déjà âgé dont on comprend qu’il a eu Sami sur le tard.