 L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.
L’industrie du porno sur Internet est florissante. Elle suscite chaque année des milliards de clics. Les spectateurs nourrissent le fantasme de la « girl next door », la fille d’à côté, simple et naturelle. Ils le réalisent avec des modèles toujours plus jeunes et plus nombreuses qui, attirées par l’argent facile, passent devant la caméra au risque d’y détruire leur réputation, leur santé et leur équilibre.
Ce documentaire, diffusé à Sundance début 2015 avant d’être mis en ligne par Netflix, suit quelques unes de ces jeunes filles en Floride à Miami – où la météo autant que la législation (qui n’oblige pas les acteurs porno à utiliser de préservatif) attirent les tournages. Elles ont répondu à une petite annonce de Riley Reynolds, qui se présente comme un agent d’actrice et donne plutôt l’image d’un maquereau bas-du-front. C’est lui qui héberge les jeunes filles, veille sur elles avec la bonhomie d’un grand frère, négocie leurs contrats avec les producteurs de films et empoche 10 % de leurs revenus.
Hot Girls Wanted est un documentaire marquant qui dévoile les dessous d’un business glauque. Sa principale qualité est d’éviter les deux écueils qui le menaçaient. D’un côté le voyeurisme glamour du porno. De l’autre sa condamnation pudibonde sur fond de moralisme.
Hot Girls Wanted montre la réalité telle qu’elle est, ni plus, ni moins sordide qu’elle est. Il montre des jeunes filles plus ou moins jolies, plus ou moins à l’aise avec leurs corps encore poupins, loin de l’image photoshopée de reines du sexe hyper-maquillées que le porno sublime. Ces filles sont souvent en rupture avec leurs familles, en échec scolaire, même si on ne verse pas dans le misérabilisme dickensien. L’argent facile est leur principale motivation : elles gagnent en une séquence cent fois ce qu’une heure de travail à la caisse enregistreuse d’un Walmart leur permettrait d’empocher. Mais elle n’est pas la seule. Il y a, chez elles, une excitation encore adolescente à quitter leur famille et à s’assumer, une découverte joyeuse de la sororité avec les autres actrices avec lesquelles elles cohabitent dans une ambiance étonnamment apaisée sans les disputes et les jalousies qu’on aurait volontiers imaginées, une vanité narcissique à voir leur nombre de followers augmenter en flèche à chaque nouvelle publication d’une photo un peu plus osée.
Hot Girls Wanted montre sans en rien édulcorer, sans sombrer non plus dans le voyeurisme, la réalité d’un industrie où le corps des femmes est une simple marchandise. On ne voit guère de tournage. Mais ce qu’on en voit donne froid dans le dos : les scénarios y sont d’une stupidité rance, les acteurs masculins, vieux et gorgés d’amphétamines, affichent un machisme satisfait – même si, étonnamment, les actrices vantent leur douceur et leur gentillesse – la misogynie et les stéréotypes racistes sont de mise. Les jeunes filles opposent une résistance crâne aux humiliations et aux maladies, affirmant qu’il s’agit d’un métier comme un autre et qu’il faut être prêtes à en accepter les servitudes. Mais on les sent fragiles, prêtes à rompre.
La caméra de Jill Bauer et de Ronna Gradus a particulièrement suivi l’une d’entre elles, Tressa Silguero aka Stella May . Sa filmographie est éloquente : Cum Fiesta, Accidentally Lesbian, Real Slute Party, Babes…. On la voit chez ses parents, au Texas, auprès de sa mère qui apprend avec angoisse son nouveau travail, de son père auquel la jeune fille n’ose rien dire, de son petit copain qui l’incite à décrocher. C’est une jeune fille ordinaire, un peu boulotte, le visage couvert d’acné, à peine sortie de l’adolescence. Aucune tragédie familiale, aucune maltraitance ne semble expliquer son choix et le rend d’autant plus incompréhensible. [attention spoiler] Elle finira par décrocher et reprendre une vie « normale ». Mais d’autres filles l’ont remplacée à Miami chez Riley Reynolds dont le business n’a jamais été aussi florissant.

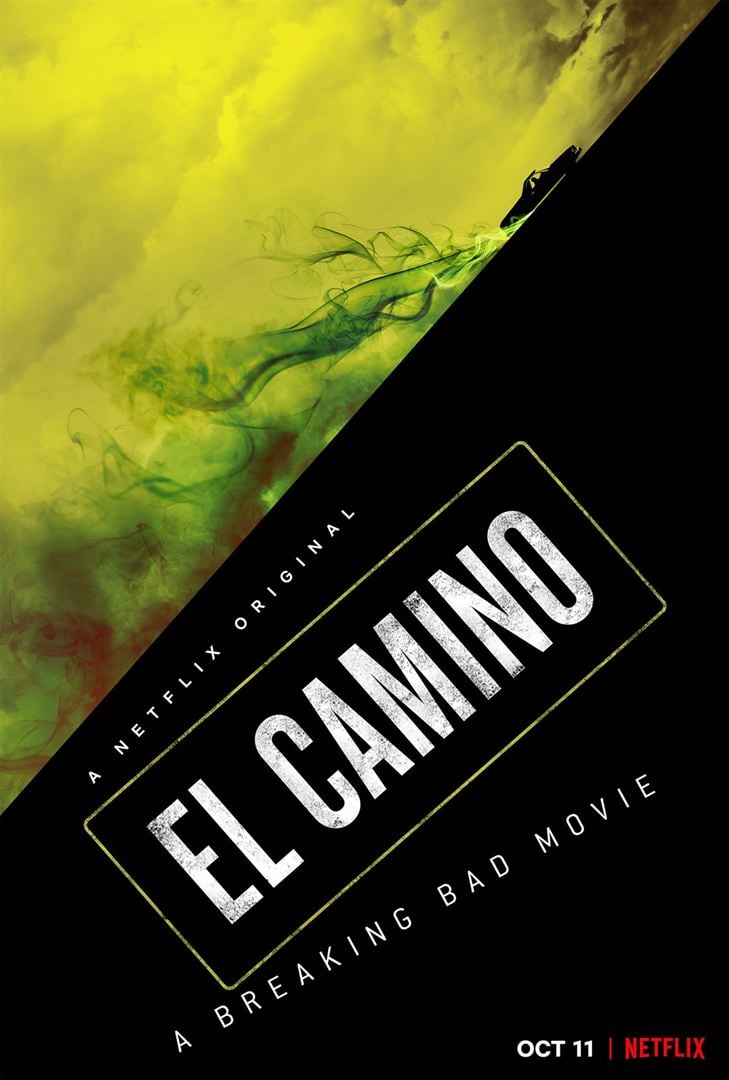 Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine.
Qu’est-il arrivé à Jesse Pinkman (Aaron Paul) après l’ultime et épique épisode de Breaking Bad ? Tel est l’objet de ce film de deux heures qui se présente comme une suite – ou comme un épilogue – de la série de soixante-deux épisodes qui, pendant cinq saisons, de 2008 à 2013, nous tint en haleine.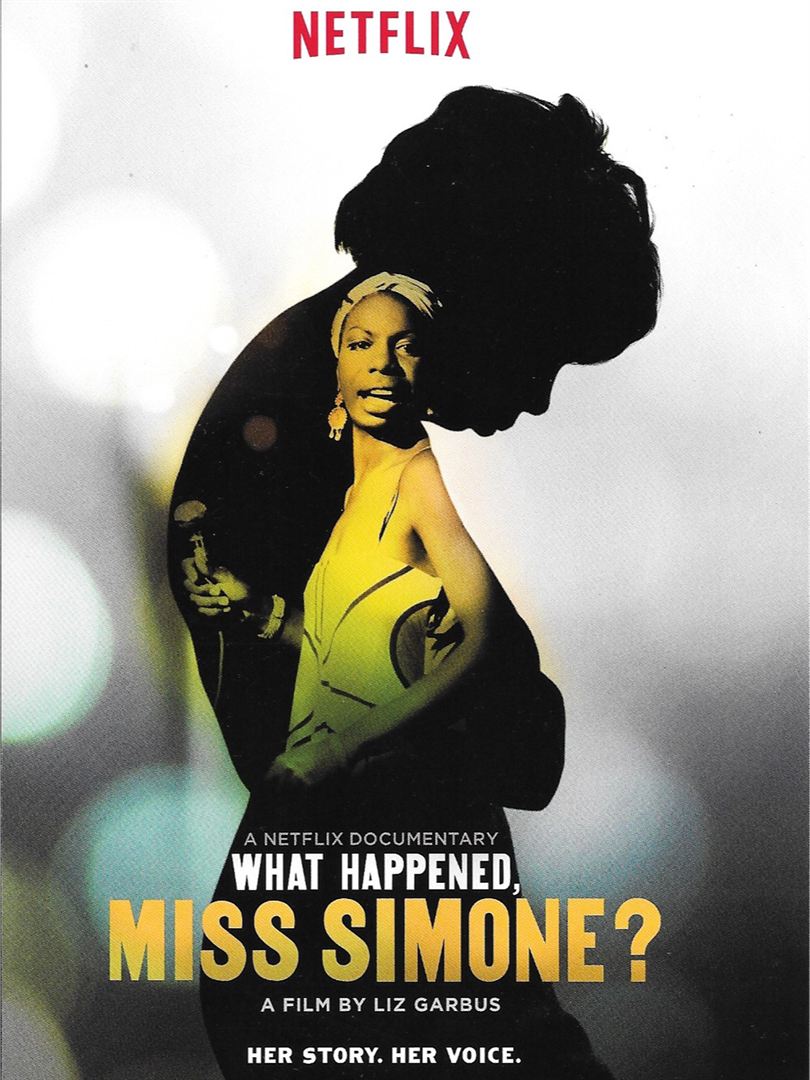 Nina Simone fut sans doute l’une des plus grandes chanteuses de jazz. On lui doit quelques uns des standards les plus connus du siècle dernier : My Baby Just Cares for Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put a Spell on You… Mais ce fut aussi une rebelle, victime du racisme et des violences conjugales, atteinte de troubles bipolaires tardivement diagnostiqués, qui s’engagea sans retenue dans la lutte contre les discriminations au risque de compromettre sa carrière.
Nina Simone fut sans doute l’une des plus grandes chanteuses de jazz. On lui doit quelques uns des standards les plus connus du siècle dernier : My Baby Just Cares for Me, Don’t Let Me Be Misunderstood, I Put a Spell on You… Mais ce fut aussi une rebelle, victime du racisme et des violences conjugales, atteinte de troubles bipolaires tardivement diagnostiqués, qui s’engagea sans retenue dans la lutte contre les discriminations au risque de compromettre sa carrière. Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure.
Radha Blank est en pleine crise de la quarantaine. Voilà plus de dix ans qu’elle n’a pas réussi à concrétiser les espoirs que ses premières œuvres théâtrales avaient fait naître malgré les efforts que déploie son agent et ami d’enfance. Célibataire, en surpoids, elle vit à Harlem dans un appartement exigu et peine à faire le deuil de sa mère qui vient de mourir. La production de sa prochaine pièce l’oblige à des compromis auxquels elle se refuse. En attendant, elle vivote en donnant des cours de théâtre dans un lycée dont les élèves lui mènent la vie dure.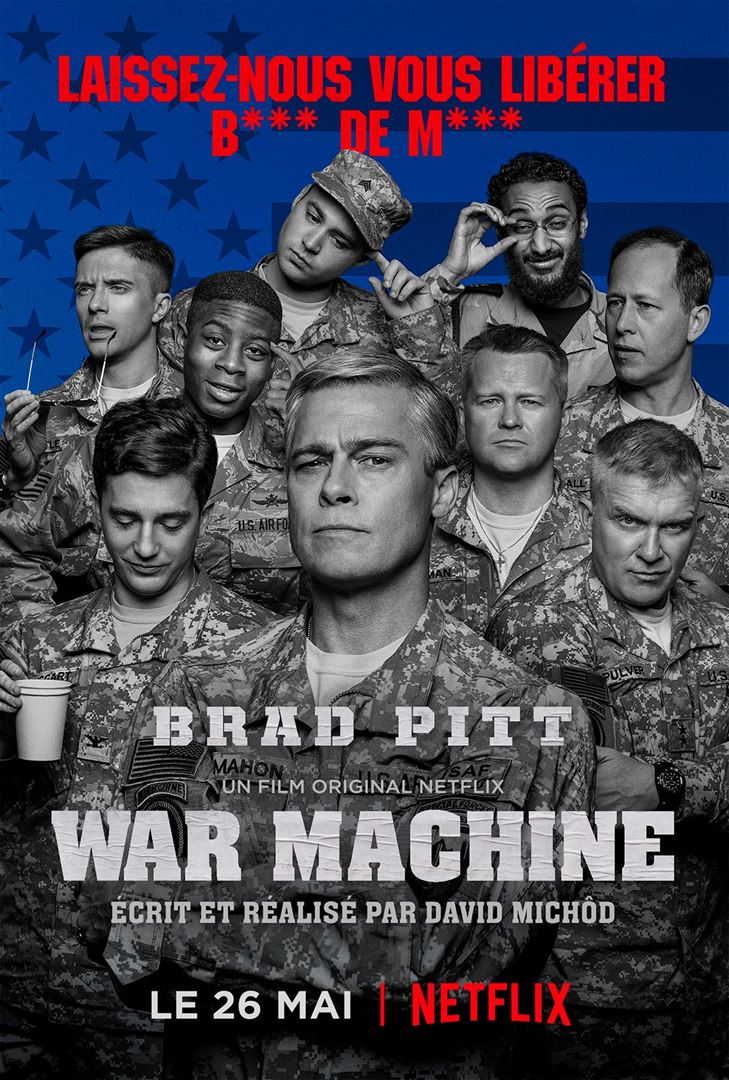 Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix.
Quand le général McChrystal est nommé en 2009 à la tête de l’ISAF, la coalition des forces armées en Afghanistan, la guerre y dure depuis déjà huit ans sans perspective réaliste d’une issue victorieuse. Certes, les talibans ont été chassés de Kaboul et se terrent à la frontière pakistanaise. Mais le pays, lesté par ses traditions, foncièrement hostile aux forces d’occupation, peine à se reconstruire. L’armée américaine et celles de ses alliés, taillées pour gagner la guerre, peinent à gagner la paix. Un jeune homme anonyme (Tom Holland) tombe amoureux sur les bancs du lycée d’Emily (Ciara Bravo). Dévasté de chagrin après sa rupture, il décide de s’engager dans l’armée. Mais le couple se reforme et les deux amoureux se marient juste avant ses classes et son départ pour l’Iraq. Il y servira comme infirmier et y verra mourir sous ses yeux plusieurs de ses frères d’armes.
Un jeune homme anonyme (Tom Holland) tombe amoureux sur les bancs du lycée d’Emily (Ciara Bravo). Dévasté de chagrin après sa rupture, il décide de s’engager dans l’armée. Mais le couple se reforme et les deux amoureux se marient juste avant ses classes et son départ pour l’Iraq. Il y servira comme infirmier et y verra mourir sous ses yeux plusieurs de ses frères d’armes. La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.
La jeune Marie Adler n’a pas eu une enfance facile. Maltraitée par ses parents, déplacée d’une famille d’accueil à une autre, elle est à dix-huit ans violée, chez elle, par un inconnu menaçant. Sa réaction déconcertante et les incohérences de son témoignage conduisent la police à mettre en doute sa parole. Sous la pression, Marie retire sa plainte. Elle est bientôt poursuivie pour faux témoignage et son nom est jeté en pâture à la presse.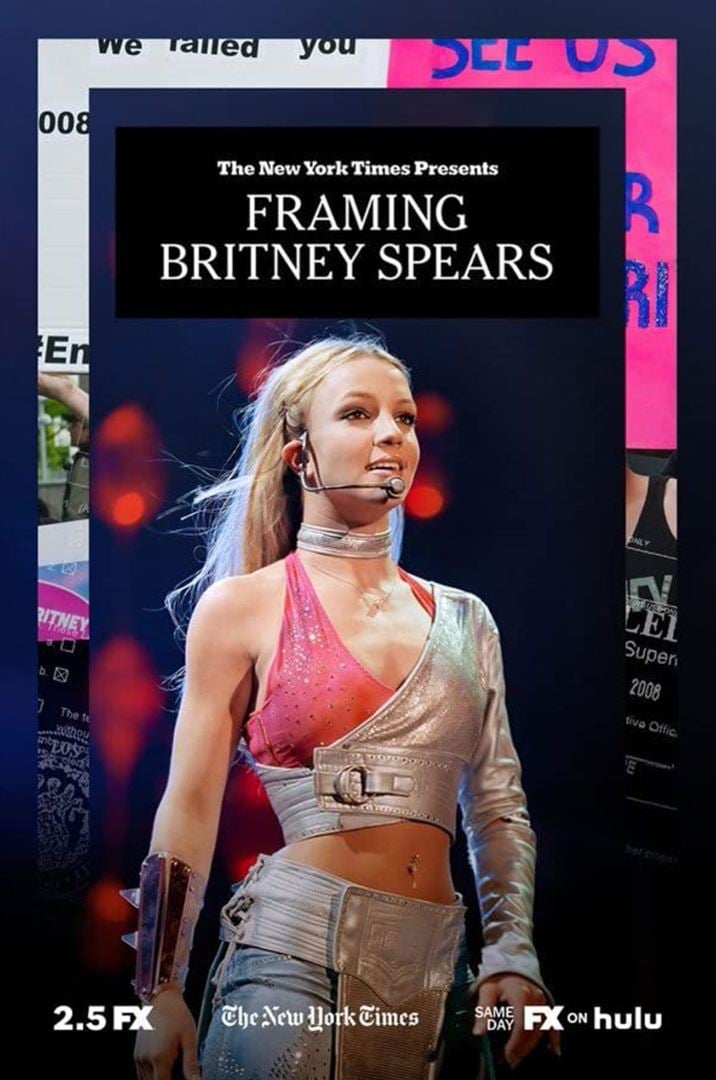 Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi.
Enfant star, révélée dès ses onze ans par le Mickey Mouse Club , Britney Spears accède à la célébrité à seize ans avec … Baby One More Time en 1998. Chanteuse de pop à la voix puissante et grave, elle s’inspire de Madonna et de ses chorégraphies millimétrées. Elle s’adresse à un public adolescent ; mais ses tenues très dénudées ont tôt fait de choquer l’Amérique puritaine. Sa liaison avec Justin Timberlake et sa rupture lui valent l’attention étouffante des paparazzi. Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée.
Paris. Fin des années soixante, début des années soixante-dix. Fernande Grudet alias madame Claude (Karole Rocher) dirige d’une main de fer un réseau de prostituées qui ont pour clients l’élite administrative et financière de la France pompidolienne. Elle bénéficie de l’appui de la pègre et de la police qu’elle renseigne régulièrement sur ses habitués. Pour autant, elle vit dans l’angoisse permanente d’être rackettée voire éliminée. Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.
Kit (Brie Larson) est une artiste née qui vit la tête dans les nuages, au milieu des arcs-en-ciel, des paillettes et des licornes. Après avoir été renvoyée de son école d’art, parce que ses réalisations ne se conformaient pas aux canons lugubres de son professeur, elle accepte, sous la pression de ses parents, de rentrer dans le rang et de travailler dans une agence d’intérim.