 Madame de la Pommeraye (Cécile de France) a perdu son mari et s’est retirée sur ses terres. Elle ne s’est jamais fait d’illusion sur l’amour et ne nourrissait nul penchant pour son mari dont le décès ne l’affecte pas.
Madame de la Pommeraye (Cécile de France) a perdu son mari et s’est retirée sur ses terres. Elle ne s’est jamais fait d’illusion sur l’amour et ne nourrissait nul penchant pour son mari dont le décès ne l’affecte pas.
Le marquis des Arcis (Edouard Baer) lui fait une cour assidue et ne se laisse pas décourager par ses rebuffades amusées. Sa constance est finalement récompensée par la veuve qui lui cède. Mais, passées les premières semaines d’extase, le frivole marquis se lasse de son amante qui, le cœur brisé, n’a d’autre ressource que de lui rendre sa liberté.
Toutefois la femme blessée entend faire payer à l’amant inconstant sa trahison. Une mère désargentée (Natalia Dontcheva) et sa fille à la beauté angélique, Mademoiselle de Joncquières (Alice Isaaz), contraintes de vivre de leurs charmes suite à leurs revers de fortune, seront les instruments de sa vengeance.
Depuis une vingtaine d’années, le marseillais Emmanuel Mouret creuse un sillon bien à lui dans le cinéma français en y semant comme autant de pépites de charmants marivaudages dont les titres faussement candides annoncent l’esprit : Laissons Lucie faire, Un baiser s’il vous plaît !, L’art d’aimer, Caprice. En regardant son premier film d’époque, on se demande comment il n’est pas venu plus tôt au Siècle des Lumières, à la perfection de sa langue, à l’élégance de ses toilettes.
Emmanuel Mouret emprunte à Diderot un épisode de Jaques le Fataliste qui avait inspiré à Robert Bresson Les Dames du bois de Boulogne. L’intrigue déroule sans anicroches sa mécanique (trop ?) bien huilée. Les scènes se succèdent qui inexorablement voient le marquis des Arcis tomber sous le charme de la jeune demoiselle de Joncquières, d’autant plus séduisante qu’elle ne prononce pas une parole, lui promettre une rivière de diamants, une rente, un hôtel particulier et, bientôt, le mariage.
Lorsqu’au lendemain de la nuit de noces, Mme de la Pommeraye triomphe en révélant au mari berné son aveuglement, on croit l’histoire terminée. Il n’en est rien. Elle dure vingt minutes de plus qu’Emmanuel Mouret emprunte en partie à Diderot et extrapole pour le reste. Ce qu’il emprunte à Diderot, c’est un dénouement bancal que Diderot lui-même avait critiqué : le marquis des Arcis, par amour pour sa femme, accepte sans broncher la mésalliance au risque de devenir la risée du tout-Paris. On se souvient que l’histoire de la Pommeraye est racontée à Jacques et à son maître par la patronne de l’Auberge du Grand-Cerf où ils passent la nuit et la critique qu’en font Jacques et son maître est l’occasion, comme l’a brillamment analysé Kundera, de poser les bases de l’art du roman moderne
Emmanuel Mouret conclut son film avec Mme de la Pommeraye, renvoyée à son amère solitude, qui croyait punir le marquis de son inconstance, mais qui, à son corps défendant, lui a permis de connaître la félicité d’un mariage heureux, nonobstant le passé caché de son épouse. Cette conclusion ne figure pas dans l’œuvre de Diderot. Elle coule pourtant de source. Sa brutalité saisit. En un clin d’œil on passe de Marivaux à Choderlos de Laclos.

 Quelques extraterrestres ont débarqué sur notre planète avant son invasion générale et ont pris apparence humaine pour comprendre la psyché de ses habitants. D’un simple contact du majeur, ils volent aux humains leurs « concepts » : la famille, la peur, l’amour…
Quelques extraterrestres ont débarqué sur notre planète avant son invasion générale et ont pris apparence humaine pour comprendre la psyché de ses habitants. D’un simple contact du majeur, ils volent aux humains leurs « concepts » : la famille, la peur, l’amour…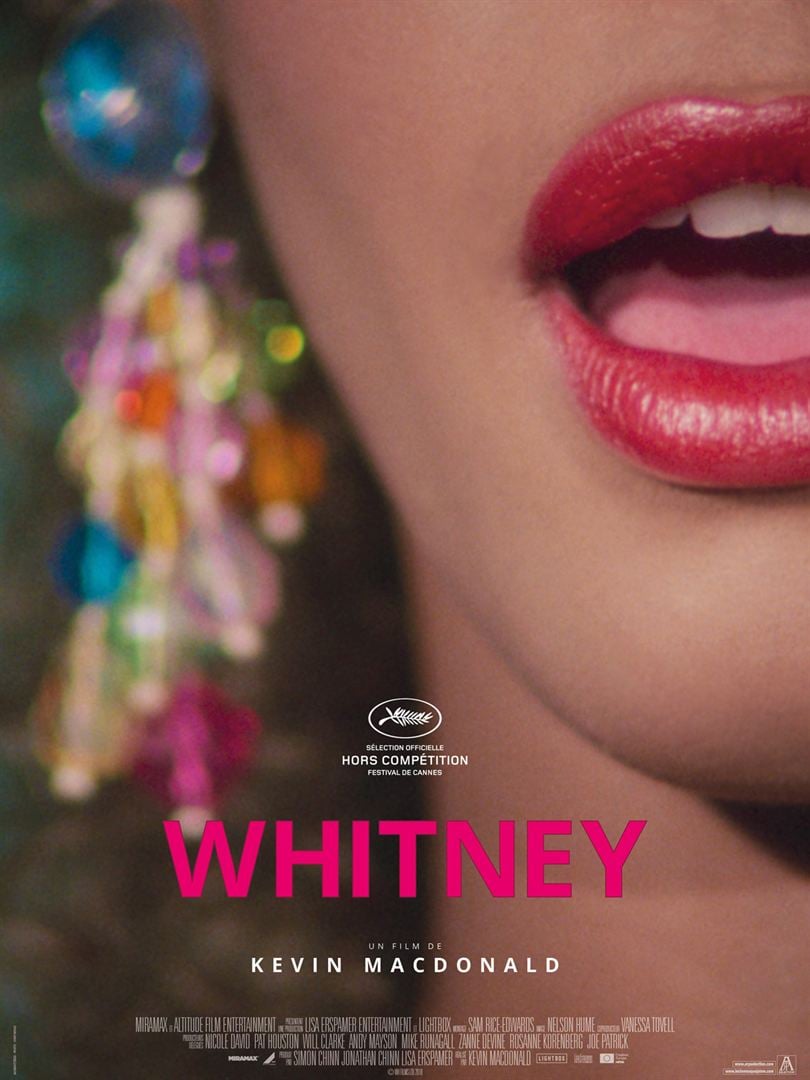 Whitney Houston (1963-2012) fut l’une des chanteuses pop les plus célèbres de son temps. Elle aurait vendu plus de 200 millions d’albums et de singles. Son premier album, sorti en 1985, disque de diamant, enregistre les meilleures ventes de tous les temps pour un artiste solo et contient trois singles classés numéro un : Saving All My Love for You, How Will I Know et Greatest Love Of All. Son deuxième est dès sa sortie en juin 1987 en tête des charts avec notamment le hit I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me). En 1992, la gloire de Whitney Houston est à son apogée avec le film Bodyguard et sa B.O. vendue à 44 millions d’exemplaires à travers le monde.
Whitney Houston (1963-2012) fut l’une des chanteuses pop les plus célèbres de son temps. Elle aurait vendu plus de 200 millions d’albums et de singles. Son premier album, sorti en 1985, disque de diamant, enregistre les meilleures ventes de tous les temps pour un artiste solo et contient trois singles classés numéro un : Saving All My Love for You, How Will I Know et Greatest Love Of All. Son deuxième est dès sa sortie en juin 1987 en tête des charts avec notamment le hit I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me). En 1992, la gloire de Whitney Houston est à son apogée avec le film Bodyguard et sa B.O. vendue à 44 millions d’exemplaires à travers le monde. Sofia est enceinte. Mais elle refuse de l’admettre. Au Maroc, hélas, le déni de grossesse est un délit de grossesse – comme le titre joliment Le Monde – pour qui a conçu un enfant hors mariage. Il faut toute la débrouillardise de Lena, la cousine de Sofia, étudiante en médecine, et de Leila, sa tante, pour permettre à Sofia d’accoucher dans une clinique privée et de sortir du commissariat où elle est ensuite détenue. Pour y parvenir, les trois femmes ont dû convaincre Omar, l’homme que Sofia rend responsable de sa maternité.
Sofia est enceinte. Mais elle refuse de l’admettre. Au Maroc, hélas, le déni de grossesse est un délit de grossesse – comme le titre joliment Le Monde – pour qui a conçu un enfant hors mariage. Il faut toute la débrouillardise de Lena, la cousine de Sofia, étudiante en médecine, et de Leila, sa tante, pour permettre à Sofia d’accoucher dans une clinique privée et de sortir du commissariat où elle est ensuite détenue. Pour y parvenir, les trois femmes ont dû convaincre Omar, l’homme que Sofia rend responsable de sa maternité.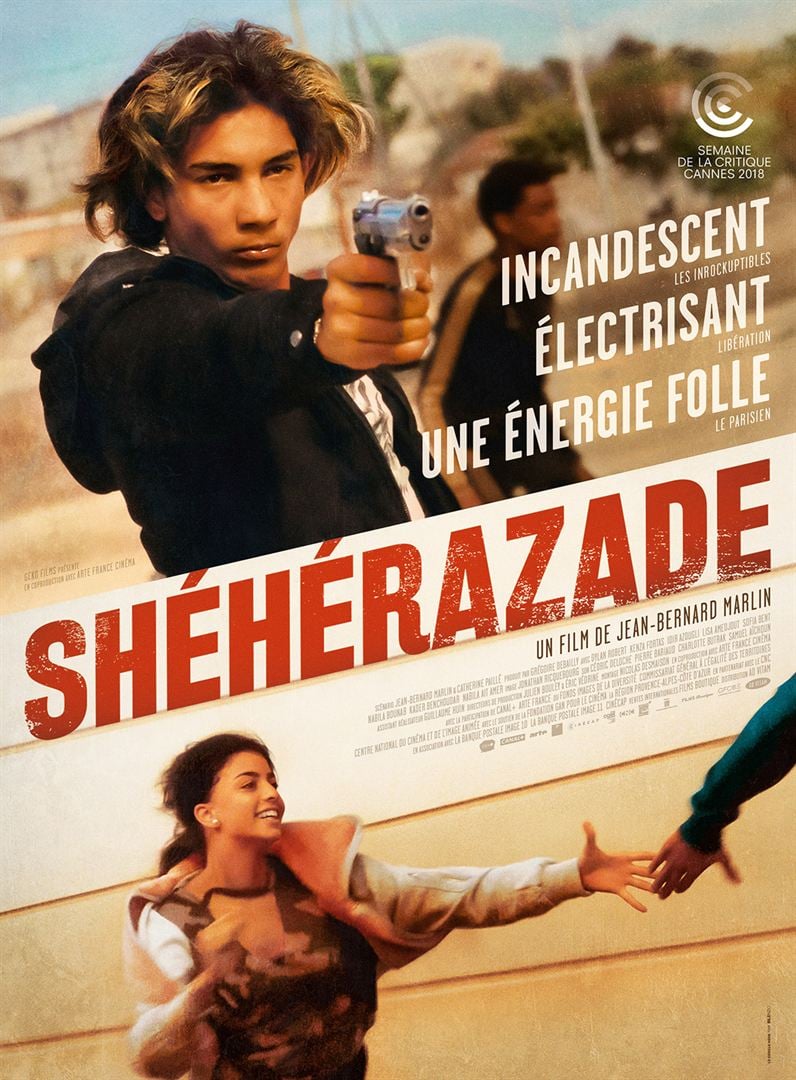 Zachary a dix-sept ans. C’est un ado brinquebalé entre une mère trop jeune incapable de l’éduquer et des foyers éducatifs incapables de l’aimer, une caillera dont les petits larcins l’ont déjà conduit en EPM (établissement pénitentiaire pour mineurs).
Zachary a dix-sept ans. C’est un ado brinquebalé entre une mère trop jeune incapable de l’éduquer et des foyers éducatifs incapables de l’aimer, une caillera dont les petits larcins l’ont déjà conduit en EPM (établissement pénitentiaire pour mineurs).