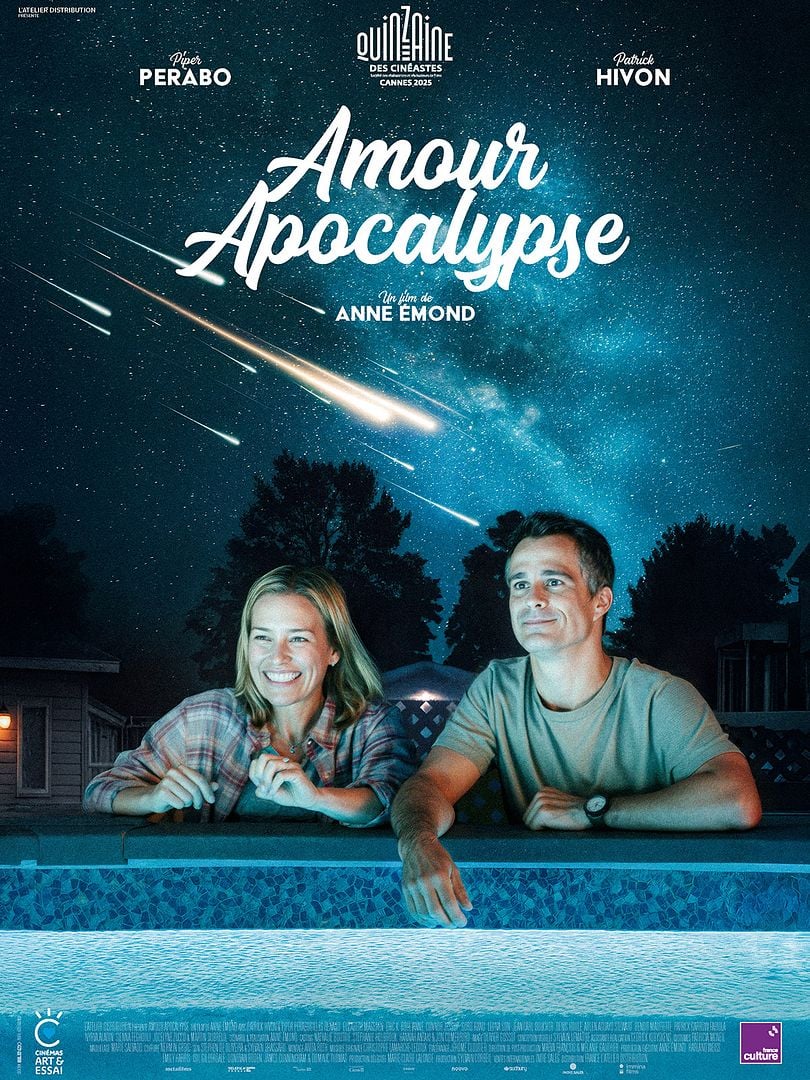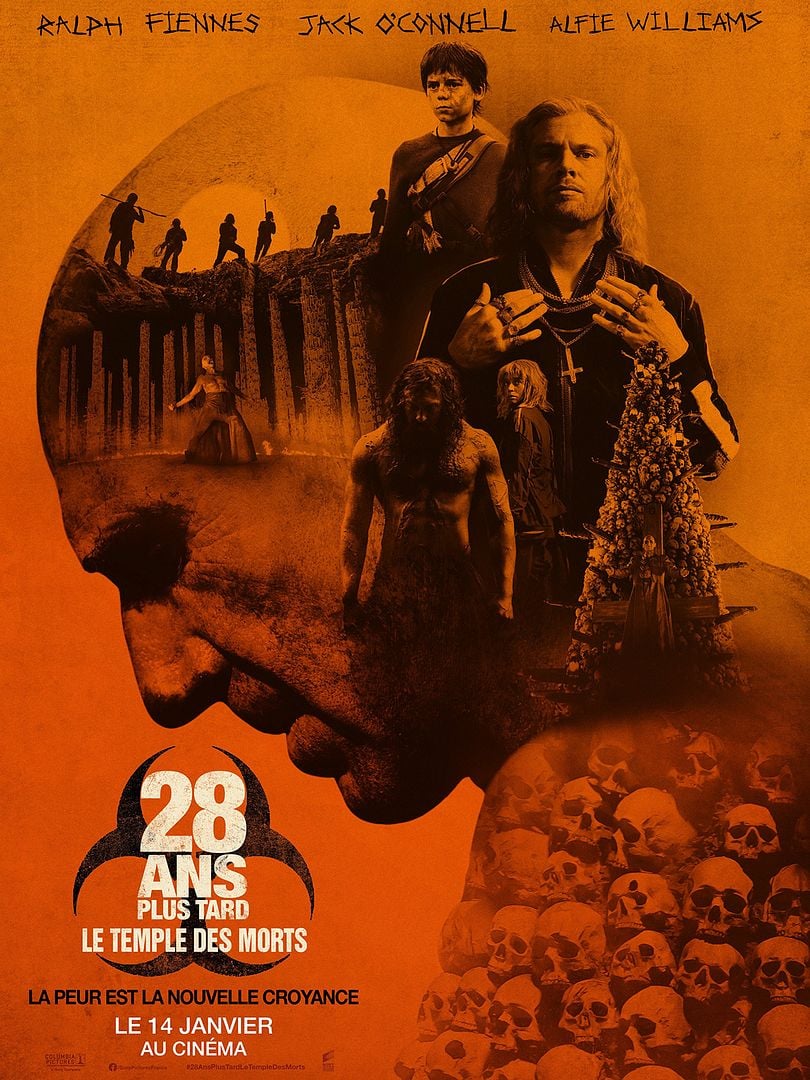Le journaliste Mohammed Aïssaoui lui avait consacré un livre en 2010 couronné par le prix Renaudot de l’essai. Abd al Malik, un rappeur passé derrière la caméra, l’adapte dans le second de ses films, après Qu’Allah bénisse la France, sorti en 2015, tiré de son autobiographie dans laquelle il évoquait son intégration et son rapport, modéré et tolérant, à l’Islam.
Les deux films, aussi différents soient-ils, par leur sujet, par leur cadre, par leur forme, défendent les mêmes valeurs : la dignité humaine, la liberté, l’égalité et la fraternité.
Furcy (Makita Samba découvert dans Les Olympiades) est un esclave né en 1786 sur l’Île Bourbon, l’actuelle île de la Réunion. À la mort de sa mère en 1817, il découvre dans ses papiers l’acte d’affranchissement dont elle avait fait l’objet une trentaine d’années plus tôt mais qui n’avait jamais été exécuté. S’estimant libre, Furcy assigne en justice son maître Joseph Lory (Vincent Macaigne haïssable à souhait). Sa requête est rejetée. Le procureur Boucher (Romain Duris, aux antipodes des rôles de jeunots espiègles auxquels il était abonné) prend fait et cause pour Furcy et fait, sans succès, appel, avant d’être lui-même rappelé à l’ordre par sa hiérarchie.
S’ouvre alors la deuxième partie du film qui s’étirera pendant plus d’une vingtaine d’années et verra Furcy vieillir au point de se couvrir de cheveux blancs. Réduit en esclavage, Furcy est envoyé à Maurice où il travaille dans une propriété des Lory. Ses conditions de vie sont épouvantables. Il manque mourir d’épuisement et de privations et est sauvé par un cyclone qui met en faillite l’exploitation. Il devient confiseur et finit même grâce à une erreur d’enregistrement au moment de son arrivée sur l’île par être affranchi par les Britanniques qui gouvernent Maurice. C’est pour lui l’occasion de renouer avec le procureur Boucher qui entretemps a obtenu la cassation de son procès et le rejugement de son affaire devant la cour royale de Paris (dont le président est interprété par François Sureau !)
Le procès se tient à Paris en 1845. C’est la troisième et dernière partie du film. Il s’engage sur des bases juridiques radicalement différentes – ce qui m’aurait interrogé si j’avais mieux maîtrisé le droit civil dont je ne suis pas spécialiste. L’acte d’affranchissement de sa mère, postérieur à la naissance de Furcy n’est plus en cause. C’est sur deux autres arguments que se fondent le requérant et son avocat, Boucher qui a quitté la magistrature. Le premier est l’origine de Madeleine, la mère de Furcy, qui est née à Chandernagor où, invoque maître Boucher, l’esclavage n’a été étendu par aucune loi française, empêchant ainsi que celle-ci soit légalement regardée comme esclave. Le deuxième, qui s’avèrera déterminant, est le séjour de Madeleine en France et l’applicabilité d’un principe posé dès 1315 dans un édit royal selon lequel « le sol de la France affranchit l’esclave qui le touche ». Selon cette branche du raisonnement, à supposer même que Madeleine ait pu être réduite en esclavage à Chandernagor, son séjour en France l’aurait affranchie et par conséquent ses enfants seraient nés libres.
On l’aura compris à la lecture des longs développements qui précèdent : j’ai pris un vrai plaisir à suivre les raisonnements très juridiques de ce film. Au double motif que je connais un peu le droit en général et très mal le droit civil en particulier. Mais les qualités du film ne se réduisent pas à ses subtils raisonnements juridiques. Furcy – dont le sous-titre m’avait semblé pendant sa première partie inexact mais qui s’éclaire dans sa dernière – est un film historique qui dépeint la société coloniale outre-mer, rarement montrée à l’écran – sinon dans Ni chaînes ni maîtres qui se déroule à Maurice – et le racisme assumé qui y prospérait. C’est un film humaniste qui condamne l’esclavage et exalte le combat des esclaves pour la reconnaissance de leur liberté et de leur humanité.
La bande-annonce