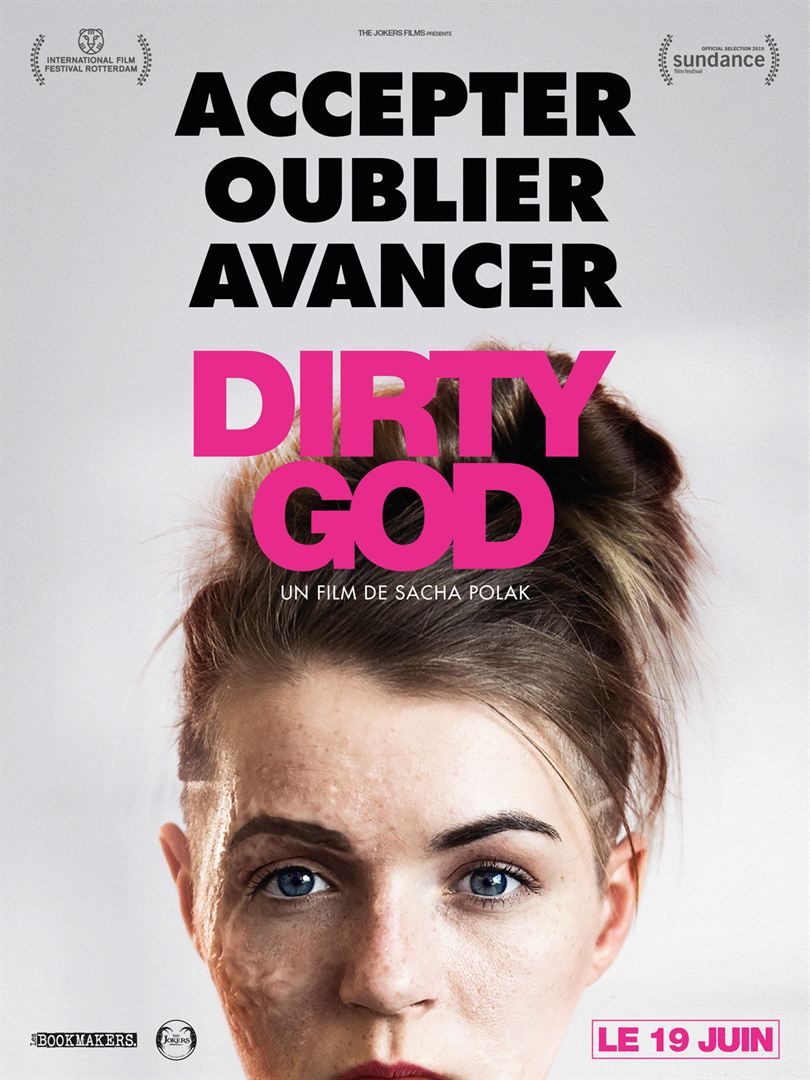Tout commence par le plan spectaculaire d’un homme en contre-plongée dont le corps s’écrase du haut d’un immeuble de plusieurs étages. Nous sommes à Taïwan, en 2049, dans une société futuriste d’où le suicide a été banni. Des drones policiers quadrillent la ville. Une substance illicite, le Rejuvenator, permet de lutter contre le vieillissement. Un agent de sécurité revenu de tout, Lao Zhang, cherche à assouvir un vengeance.
Tout commence par le plan spectaculaire d’un homme en contre-plongée dont le corps s’écrase du haut d’un immeuble de plusieurs étages. Nous sommes à Taïwan, en 2049, dans une société futuriste d’où le suicide a été banni. Des drones policiers quadrillent la ville. Une substance illicite, le Rejuvenator, permet de lutter contre le vieillissement. Un agent de sécurité revenu de tout, Lao Zhang, cherche à assouvir un vengeance.
Trente ans plus tôt, Lao Zhang est un jeune policier plein d’avenir. Il vient de se marier. Il arrête une touriste française kleptomane.
Encore quinze ans avant, Lao Zhang n’est qu’un adolescent mal dégrossi, arrêté par la police après le vol d’une mobylette.
Couronné par le Grand prix du Festival du film policier de Beaune 2019, précédé par une critique élogieuse, Face à la nuit s’annonçait comme le film de la semaine. Son scénario complexe, son esthétique qui se revendique à la fois de Blade Runner et de Wong Kar Wai avaient de quoi mettre l’eau à la bouche.
Raconter une histoire en commençant par la fin est une sacrée gageure d’écriture. Si commencer la narration par une scène choc avant de remonter en arrière par un long flashback, lequel conduira à retrouver ladite scène aux deux tiers du film environ, est devenu une recette éculée, c’est tout autre chose d’écrire un scénario en marche arrière. Quelques films s’y sont essayé avec succès : Irréversible de Gaspard Noé, 5×2 de François Ozon, Memento de Christopher Nolan.
Mais pour y réussir, il faut surmonter deux écueils. Le premier est de ne pas perdre le spectateur en route. Le second est d’avoir une histoire qui la tienne.
Hélas tel n’est pas le cas de ce Face à la nuit (titre français calamiteux d’insignifiance, traduction de Cities of Last Things dont le réalisateur indique, dans sa note d’intention, qu’il lui aurait été inspiré par un roman de Paul Auster). Sans doute comprend-on, surtout après avoir lu les premières lignes de cette critique, que le film compte trois volets mettant en scène le même personnage à trois âges de sa vie. Mais, j’avoue avoir mis du temps à identifier l’homme sur lequel, dans le premier volet, il exerce sa vengeance.
Le plus grave est ailleurs : dans l’absence totale de crédibilité de son histoire. Le comble est atteint avec le personnage d’Ara. On imagine mal comment notre héros peut finir la nuit avec elle dans le deuxième volet et comment il la retrouve trente ans plus tard dans le premier.
Au bout du compte, on se sent un peu berné. Berné par le mélange mal maîtrisé des genres : SF, polar, mélo. Berné par des personnages qui se réduisent à leur caricature : flics ripoux, prostituées au grand cœur… Berné par un procédé narratif qui, pour alléchant qu’il soit, n’apporte rien.