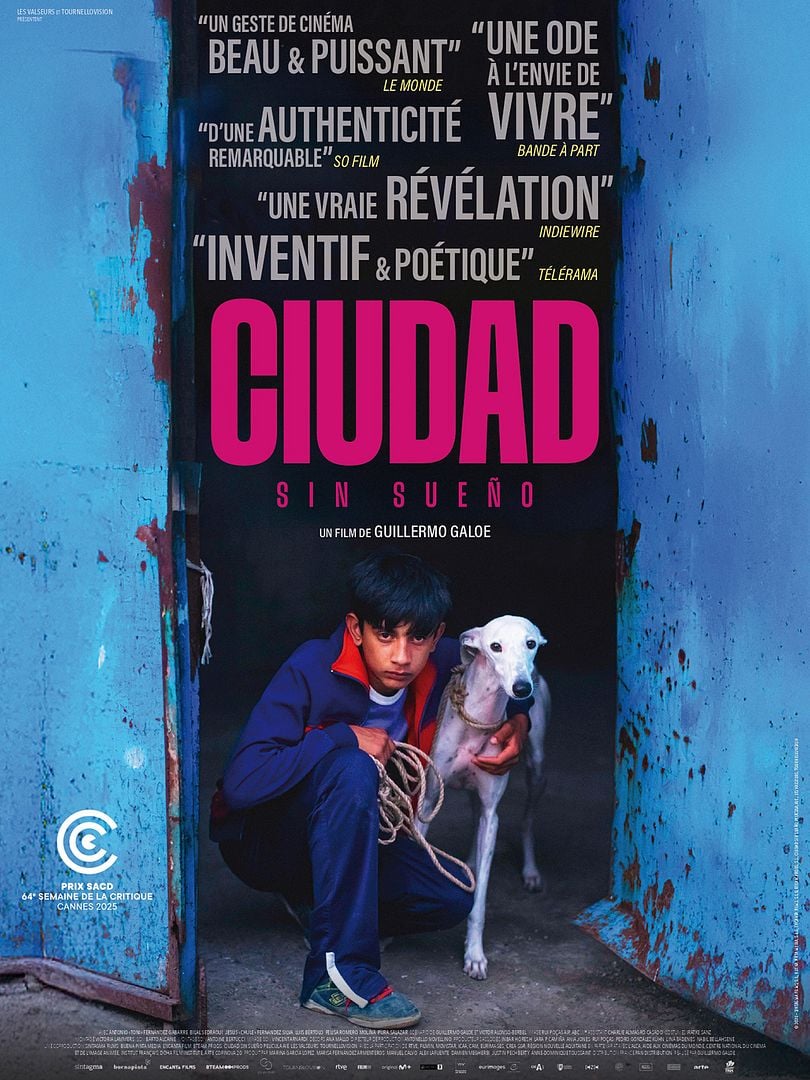Lucy (Léa Drucker) est infirmière en chef dans un service de pédiatrie. Adam, quatre ans, gravement malnutri, y a été hospitalisé. Les droits de visite de sa mère, Rebecca (Anamaria Vartolomei), ont été restreints par une ordonnance judiciaire d’éloignement ; car Rebecca exerçait sur lui semble-t-il une influence toxique. Mais Adam refuse de s’alimenter sans sa mère et Rebecca, unie à son fils par une relation symbiotique refuse de le quitter.
Hasard heureux ou malheureux de la programmation : L’Intérêt d’Adam sort trois semaines à peine après En première ligne, le remarquable film suisse qui suivait sans la lâcher Leonie Benesch dans un hôpital bâlois pendant toute une garde harassante.
Qui aura vu les deux aura spontanément tendance à les hiérarchiser. Pour moi, c’est match nul : je les ai autant aimés l’un que l’autre, plaçant le premier en tête de mes films préférés du mois d’août et le second pas loin du sommet de septembre avec Sirāt et Connemara.
En première ligne est un film transversal : il passe en revue l’ensemble des situations auxquelles une infirmière se trouve confrontée pendant une garde. L’Intérêt d’Adam est un film longitudinal : il s’attache à un patient, même s’il en évoque brièvement – et aurait pu en faire l’économie – quelques autres : la famille congolaise nombreuse et bruyante communiquant mal en français, la mineure musulmane relevant d’un curetage qu’elle ne veut pas que sa mère apprenne…
Quelles sont les causes de la malnutrition et de la sarcopénie dont souffre Adam ? Sa mère en est-elle responsable ? Par quels enchaînements en est-elle arrivée à maltraiter ainsi son enfant ? Souffre-t-elle d’un syndrome de Münchhausen par procuration, voulant à tout prix susciter la compassion pour son fils au point de provoquer chez lui un état pathologique ? Le film aurait pu, à la façon d’une enquête policière, remonter ce fil-là et chercher les origines de cette situation. Mais il refuse cette facilité pour s’intéresser au temps présent. Il se pose une seule question, en temps réel : comment séparer Rebecca, qui s’y refuse, de son fils ?
On pourrait craindre qu’un scénario si étique ne suffise pas à un film. La réponse est dans sa durée – 1h18 à peine – et dans la qualité de son écriture qui ne réserve ni ventre mou ni temps faible. Comme En première ligne, L’Intérêt d’Adam ne laisse à Lucy et aux spectateurs qui ne la lâchent pas d’une semelle aucun répit. Avec elle, on partage le stress quasiment irrespirable de cette longue course folle.
En sortant du film, une amie espiègle me disait que son meilleur interprète était la barrette à cheveux de Lucy, filmée de dos dans les longs couloirs du service. C’est faire peu de cas des deux actrices qui portent le film à bout de bras et qui sont venues le présenter dimanche soir à l’avant-première à laquelle j’ai eu le privilège d’assister. Léa Drucker y est aussi impressionnante que dans Dossier 137 dont je dirai à sa sortie le 19 novembre le bien immense que j’en pense. Elle réussit à être en même temps impériale – on ne résiste pas à ses commandements – et empathique. Anamaria Vartolomei, la peau grasse, le cheveu filasse, a un rôle ingrat qu’elle interprète avec une brûlante incandescence.
Après En première ligne, après L’Intérêt d’Adam, je ne me précipiterai pas pour voir un autre film sur l’hôpital. Mais je suis profondément heureux d’avoir vu ces deux-là.