 Le fait divers avait défrayé la chronique à l’automne 2007 : une association humanitaire française avait tenté de faire sortir du Tchad 103 enfants présentés comme orphelins du Darfour.
Le fait divers avait défrayé la chronique à l’automne 2007 : une association humanitaire française avait tenté de faire sortir du Tchad 103 enfants présentés comme orphelins du Darfour.
Joachim Lafosse, un réalisateur belge dont le précédent film « À perdre la raison », lui aussi inspiré d’une histoire vraie, m’avait bouleversé, a très fidèlement adapté cette histoire. Seule distance prise avec la réalité : ses principaux protagonistes ont été rebaptisés et les lieux de l’action ne sont pas nommés – précaution bien dérisoire qui ne tiendrait pas longtemps devant un tribunal.
La grande réussite de son film est de décrire la lente perversion des meilleures intentions.
Car, les intentions du charismatique directeur de l’Arche de Zoé, impeccablement interprété par Vincent Lindon, sont pures : sauver des orphelins de l’enfer du Darfour. Fort de l’expérience qu’il a acquise après le tsunami en Asie du Sud-Est, il convainc plusieurs dizaines de familles du Sud-Ouest de la France de se porter volontaires à les accueillir.
Les choses se compliquent quand les orphelins attendus ne répondent pas à l’appel. Les humanitaires espéraient sauver le monde ; mais le monde n’a pas besoin d’être sauvé. Ayant reçu de l’argent pour fournir des orphelins, les chefs de village fournissent aux humanitaires ce qu’ils ont sous la main : des enfants dont les parents acceptent de se séparer, soit qu’ils aient reçu de l’argent pour ce faire, soit qu’ils espèrent ainsi leur assurer une vie meilleure. C’est ainsi que, coincés entre les familles adoptantes qui les attendent en France, des chefs de village qui ne leur amènent pas les orphelins escomptés et des autorités tchadiennes auxquelles elle ne parvient pas longtemps à cacher ses plans d’exfiltration, l’équipe de l’Arche de Zoé s’est retrouvé dans un dilemme sans issue.
Cette lente perversion est remarquablement incarnée par un personnage secondaire : celui de la journaliste interprétée par Valérie Donzelli. Son rôle était de filmer la mission pour offrir aux familles adoptantes un témoignage. Elle se positionne au départ en dehors du groupe – dont elle filme, sans mot dire, les premiers déchirements. Mais peu à peu, attendrie par la détresse des enfants recueillis, elle prend fait et cause pour la mission, au point de perdre sa lucidité.
L’autre réussite des « Chevaliers blancs » est de filmer l’humanitaire. Il est surprenant que ce monde, hautement dramaturgique, ait aussi peu inspiré le cinéma. On voit parfois quelques silhouettes, en arrière-plan d’un film catastrophe. Un drame humanitaire est parfois filmé à travers leurs yeux. Mais aucun film n’a, à ma connaissance, filmé l’humanitaire en train de se faire – alors que les romans et les essais sur ce thème sont légion (tels que « Asmara » de Jean-Christophe Rufin ou « Frontières » de Sylvie Brunel). Or, l’action humanitaire renferme de riches ressorts dramatiques. Ce que Joachim Lafosse réussit très bien à filmer ne va pas de soi : c’est, quand l’équipe privée d’accès au terrain ne parvient pas à accueillir d’enfants, le temps mort de l’attente, du désœuvrement, de l’oisiveté où la frontière entre le travail et les vacances se perd.
La bande-annonce


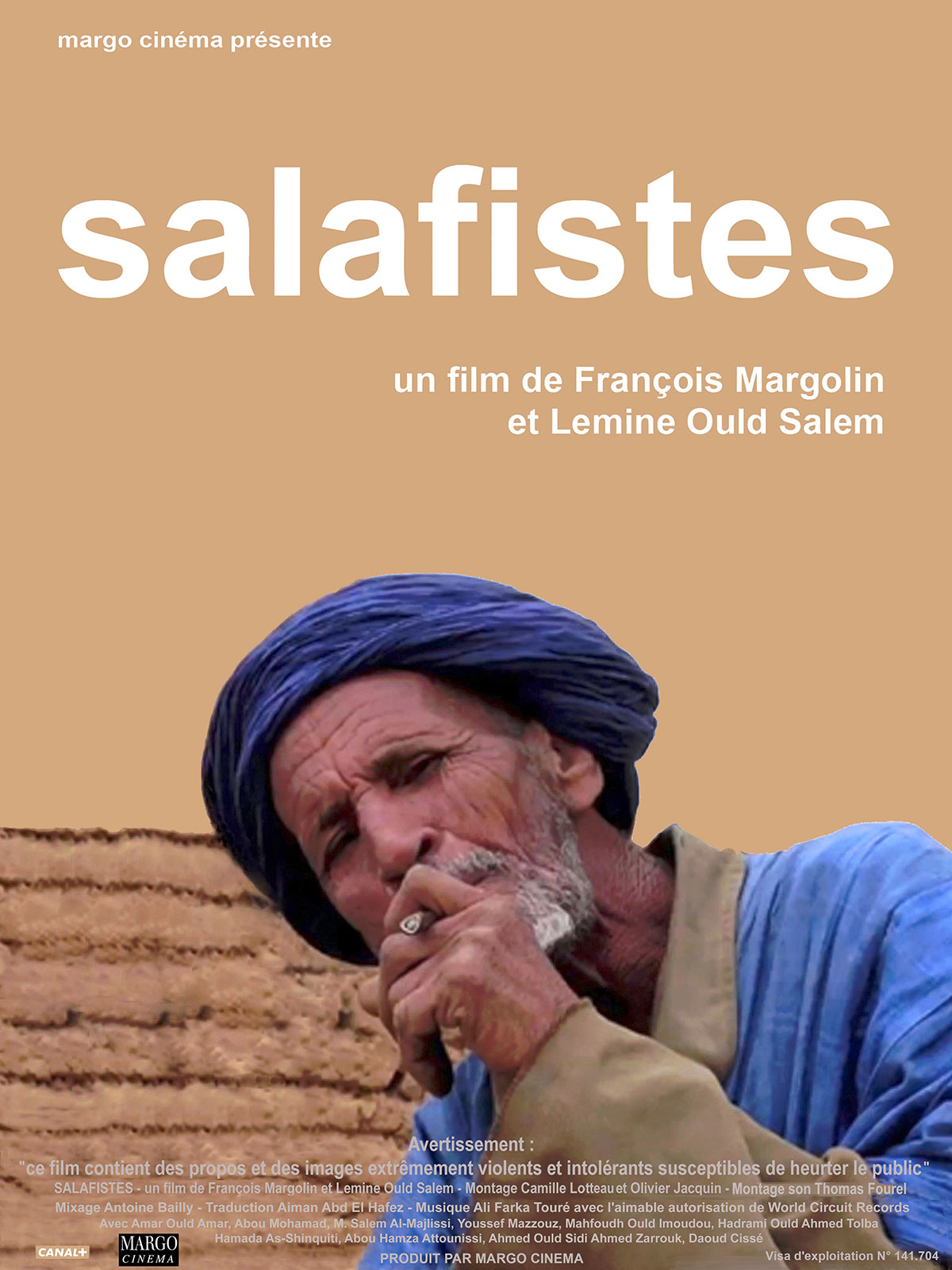
 Jane Got a Gun arrive sur nos écrans lesté de lourdes casseroles. Produit par Natalie Portman, le film devait être réalisé par Lynne Ramsay (We Need to Talk about Kevin) qui a déclaré forfait la veille du tournage. Bradley Cooper puis Jude Law étaient annoncés pour le premier rôle masculin, finalement interprété par Joel Edgerton (Life, Strictly Criminal, Exodus). Sa sortie en France, prévue le 25 novembre, est décalée suite aux attentats du 13 novembre. Last but not least, le film, sorti aux États-Unis vendredi dernier, a enregistré des résultats catastrophiques au box-office ce week-end.
Jane Got a Gun arrive sur nos écrans lesté de lourdes casseroles. Produit par Natalie Portman, le film devait être réalisé par Lynne Ramsay (We Need to Talk about Kevin) qui a déclaré forfait la veille du tournage. Bradley Cooper puis Jude Law étaient annoncés pour le premier rôle masculin, finalement interprété par Joel Edgerton (Life, Strictly Criminal, Exodus). Sa sortie en France, prévue le 25 novembre, est décalée suite aux attentats du 13 novembre. Last but not least, le film, sorti aux États-Unis vendredi dernier, a enregistré des résultats catastrophiques au box-office ce week-end. Deux chasseurs de primes lancés à la poursuite d’un couple en cavale vont le défendre contre la population locale décidée à le lyncher.
Deux chasseurs de primes lancés à la poursuite d’un couple en cavale vont le défendre contre la population locale décidée à le lyncher.
 « La Fille du patron », c’est deux films en un. D’un côté, des employés d’une entreprise textile qui forment une équipe de rugby. De l’autre, l’arrivée dans ce groupe soudé d’un corps exogène – la fille du patron chargée de mener une étude d’ergonomie dans l’entreprise de son père – qui va révéler les conflits de classe.
« La Fille du patron », c’est deux films en un. D’un côté, des employés d’une entreprise textile qui forment une équipe de rugby. De l’autre, l’arrivée dans ce groupe soudé d’un corps exogène – la fille du patron chargée de mener une étude d’ergonomie dans l’entreprise de son père – qui va révéler les conflits de classe.
 Les sourds veulent se faire entendre. Voilà le titre de la critique de ce beau documentaire que j’aurais écrit pour Libération.
Les sourds veulent se faire entendre. Voilà le titre de la critique de ce beau documentaire que j’aurais écrit pour Libération. Dans les années 60, les frères Krays régnèrent sur la mafia londonienne. Un premier film leur avait été consacré en 1990 que j’avais vu encore étudiant – et dont je n’ai gardé que le souvenir vague d’une efficace série B. Brian Helgeland, le réalisateur des dispensables « Payback » et « Chevalier », aime les titres courts et filme la légende de ces deux malfrats.
Dans les années 60, les frères Krays régnèrent sur la mafia londonienne. Un premier film leur avait été consacré en 1990 que j’avais vu encore étudiant – et dont je n’ai gardé que le souvenir vague d’une efficace série B. Brian Helgeland, le réalisateur des dispensables « Payback » et « Chevalier », aime les titres courts et filme la légende de ces deux malfrats. Le fait divers avait défrayé la chronique à l’automne 2007 : une association humanitaire française avait tenté de faire sortir du Tchad 103 enfants présentés comme orphelins du Darfour.
Le fait divers avait défrayé la chronique à l’automne 2007 : une association humanitaire française avait tenté de faire sortir du Tchad 103 enfants présentés comme orphelins du Darfour.