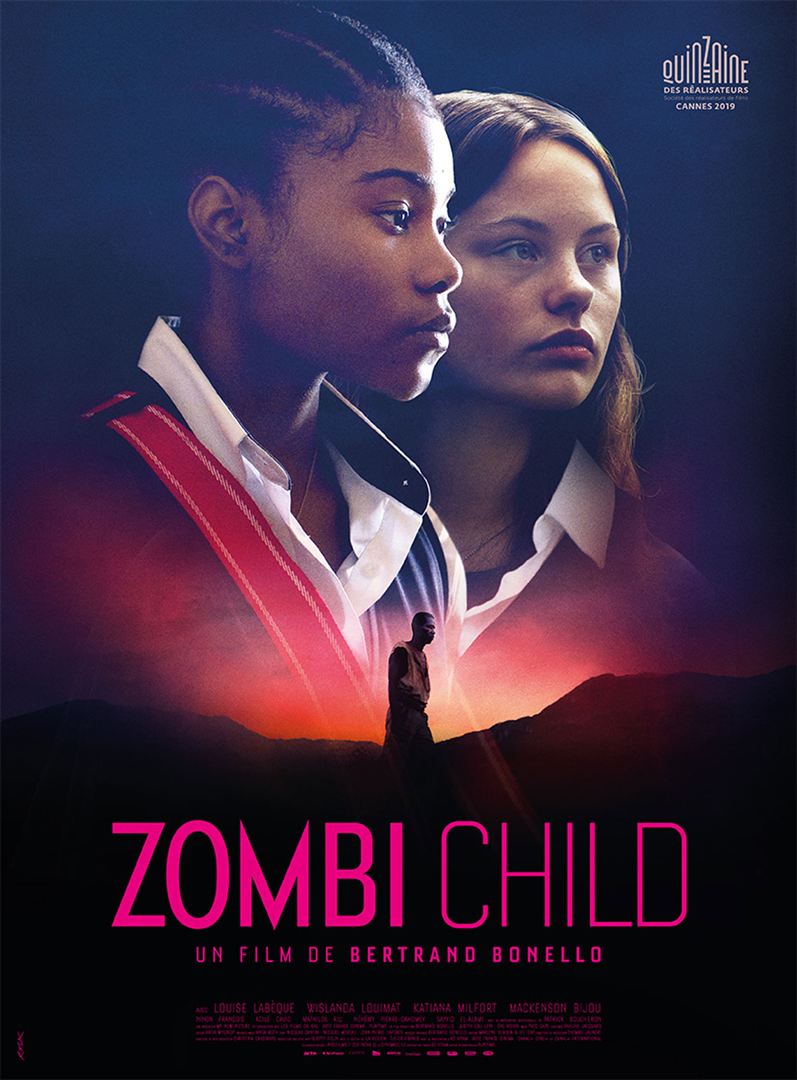Pablo fait partie de la haute bourgeoisie guatémaltèque. Très proche de ses parents, de son frère aîné, de sa sœur, il a une femme, deux enfants, un bon travail. Mais Pablo entretient une relation avec Francisco que sa famille très pieuse ne saurait tolérer. Elle lui met un marché en main : se « guérir » de son homosexualité par une cure rigoureuse pratiquée par son Église ou renoncer à tout jamais à voir ses enfants.
Pablo fait partie de la haute bourgeoisie guatémaltèque. Très proche de ses parents, de son frère aîné, de sa sœur, il a une femme, deux enfants, un bon travail. Mais Pablo entretient une relation avec Francisco que sa famille très pieuse ne saurait tolérer. Elle lui met un marché en main : se « guérir » de son homosexualité par une cure rigoureuse pratiquée par son Église ou renoncer à tout jamais à voir ses enfants.
Le second film du réalisateur guatémaltèque Jayro Bustamante fait froid dans le dos. Comme La Servante écarlate, comme Boy Erased, il dénonce les dérives d’une religion fanatisée en croisade contre l’homosexualité. On ne peut évidemment qu’être choqué par la cruauté de ces « thérapies de conversion » et solidaire du héros, brinquebalé entre sa famille qui le renie, son amant, si doux, et la cheffe glaçante de cette Église dévoyée.
Le scénario repose sur un parti pris audacieux. Il choisit de nous plonger dans le cœur du sujet dans une première scène impressionnante où l’on voit Pablo confronté à sa famille, sommé de faire un choix. Le scénario aurait pu suivre un cours radicalement différent. Il aurait pu lentement nous montrer la vie bourgeoise de Pablo, ses joies mais aussi ses failles, puis sa rencontre avec Francisco, son trouble, ses hésitations. Il y avait de quoi remplir intelligemment un bon tiers de film. Le parti retenu est tout autre. Il a l’avantage de nous haper, l’inconvénient de tomber, passée cette première scène, dans un trou d’air dont on ne ressortira qu’à la conclusion du film particulièrement surprenante.






 Le monteur français Denis Parrot est allé sur Youtube glaner des vidéos de coming out postées entre 2012 et 2018. On y voit des garçons et des filles du monde entier y annoncer leur homosexualité ou leur décision de changer de sexe.
Le monteur français Denis Parrot est allé sur Youtube glaner des vidéos de coming out postées entre 2012 et 2018. On y voit des garçons et des filles du monde entier y annoncer leur homosexualité ou leur décision de changer de sexe.