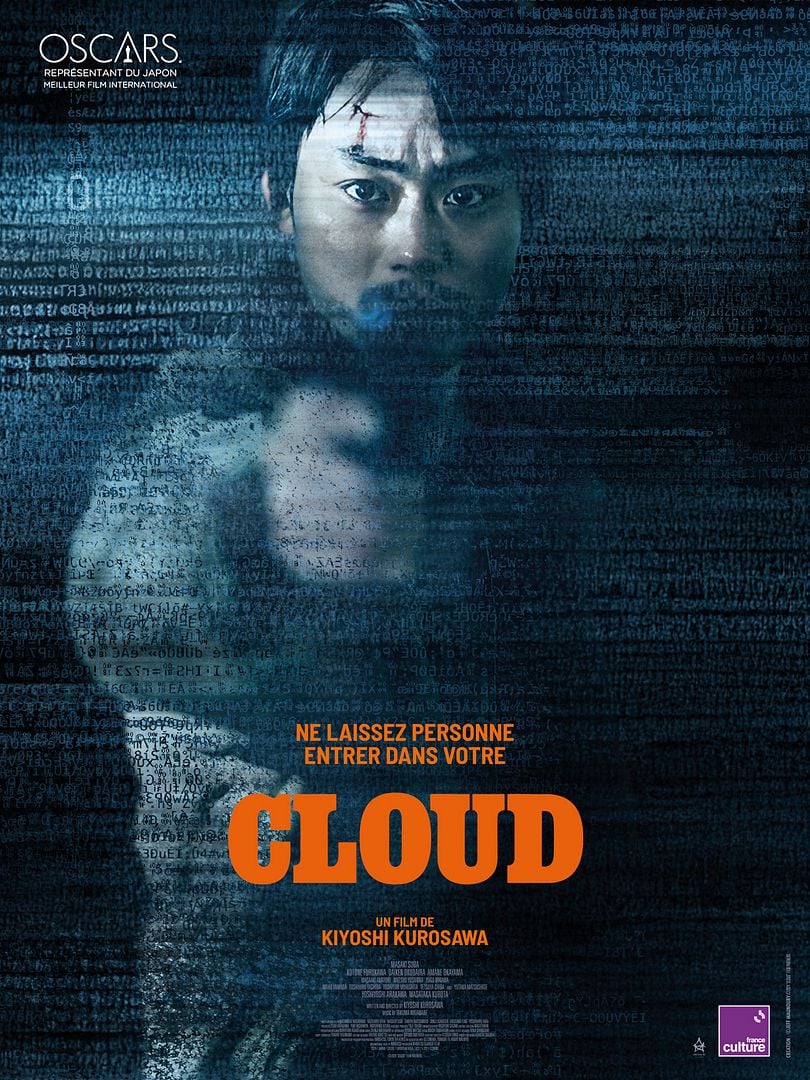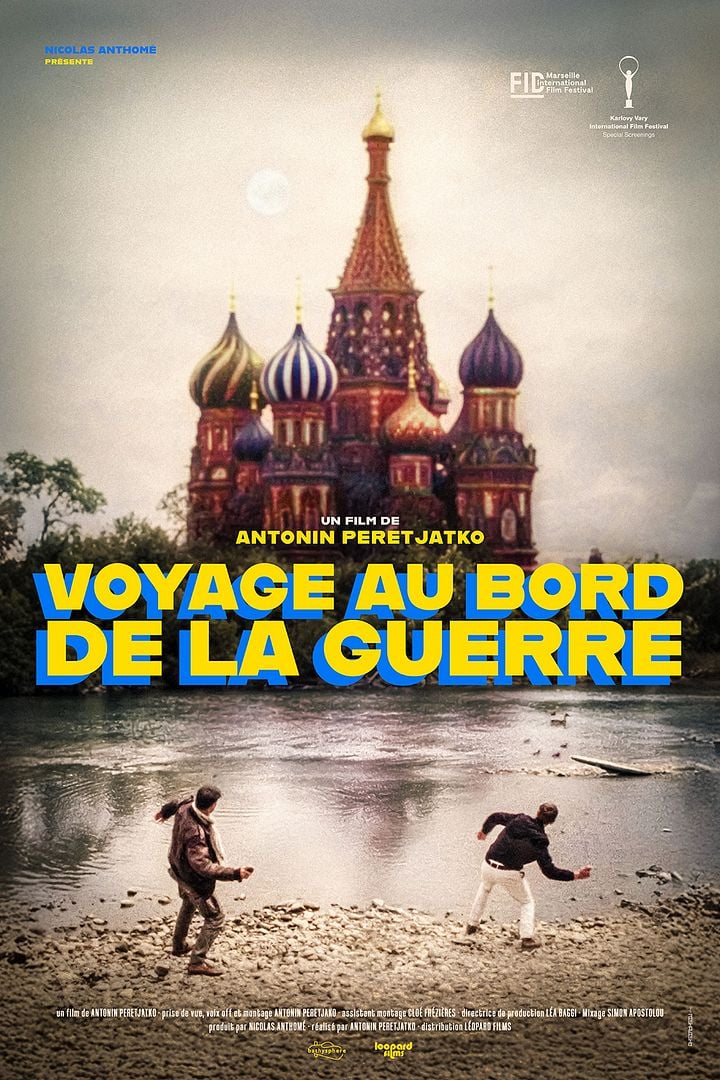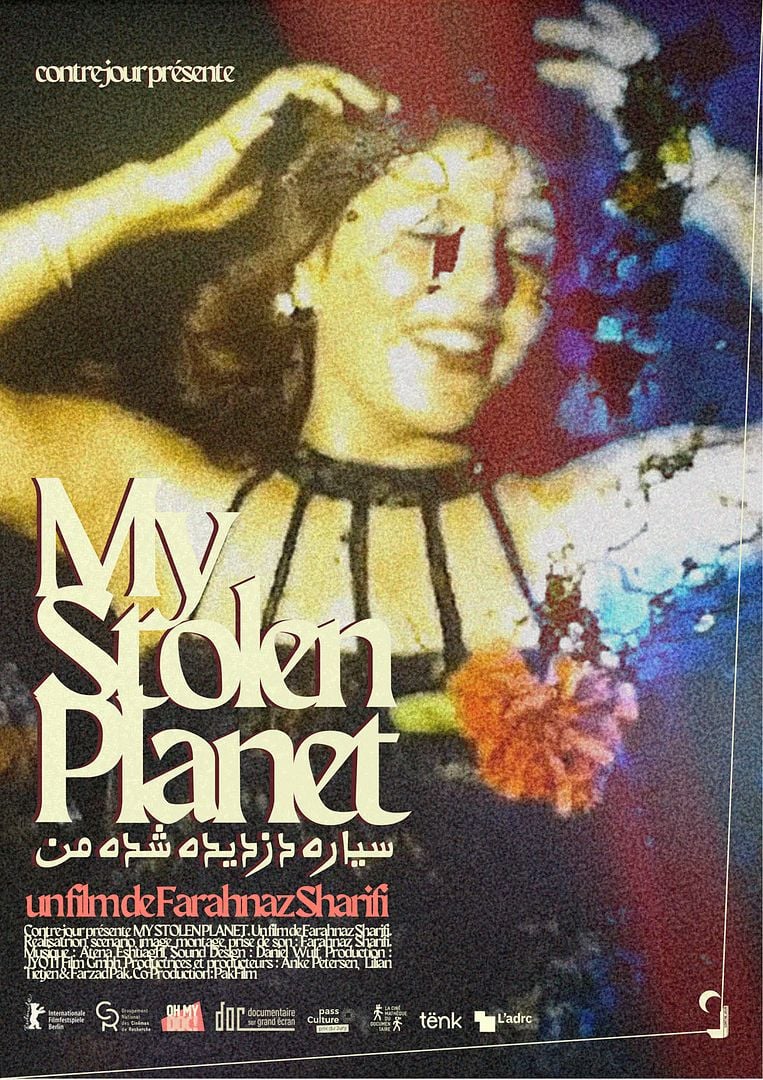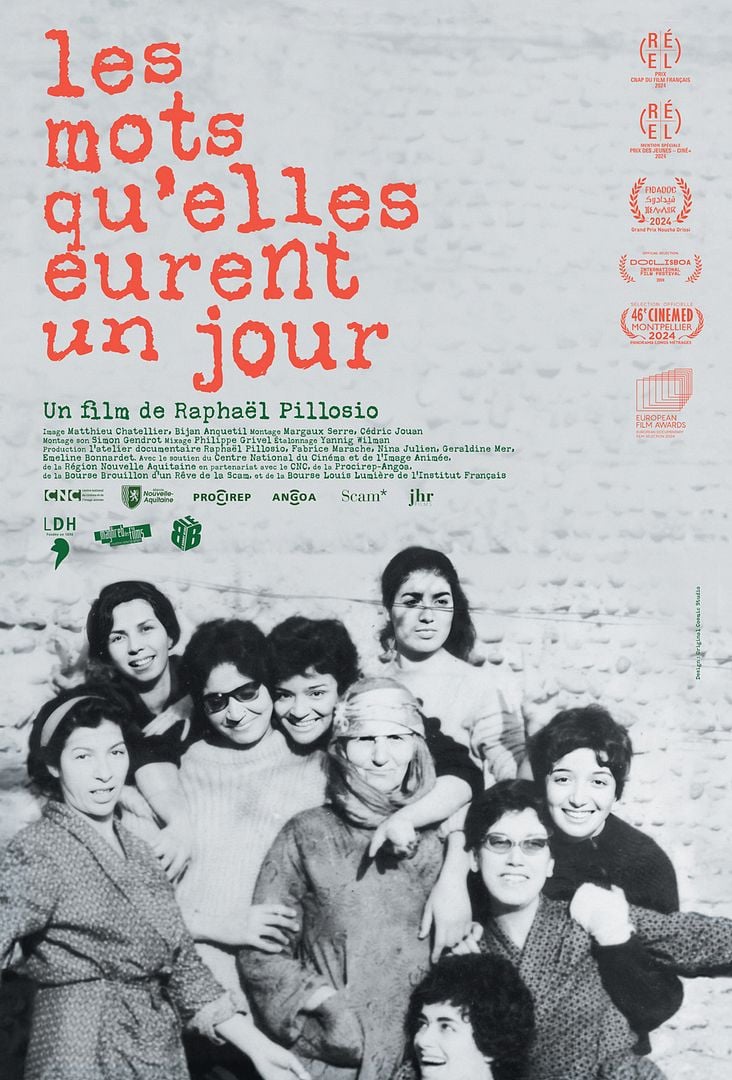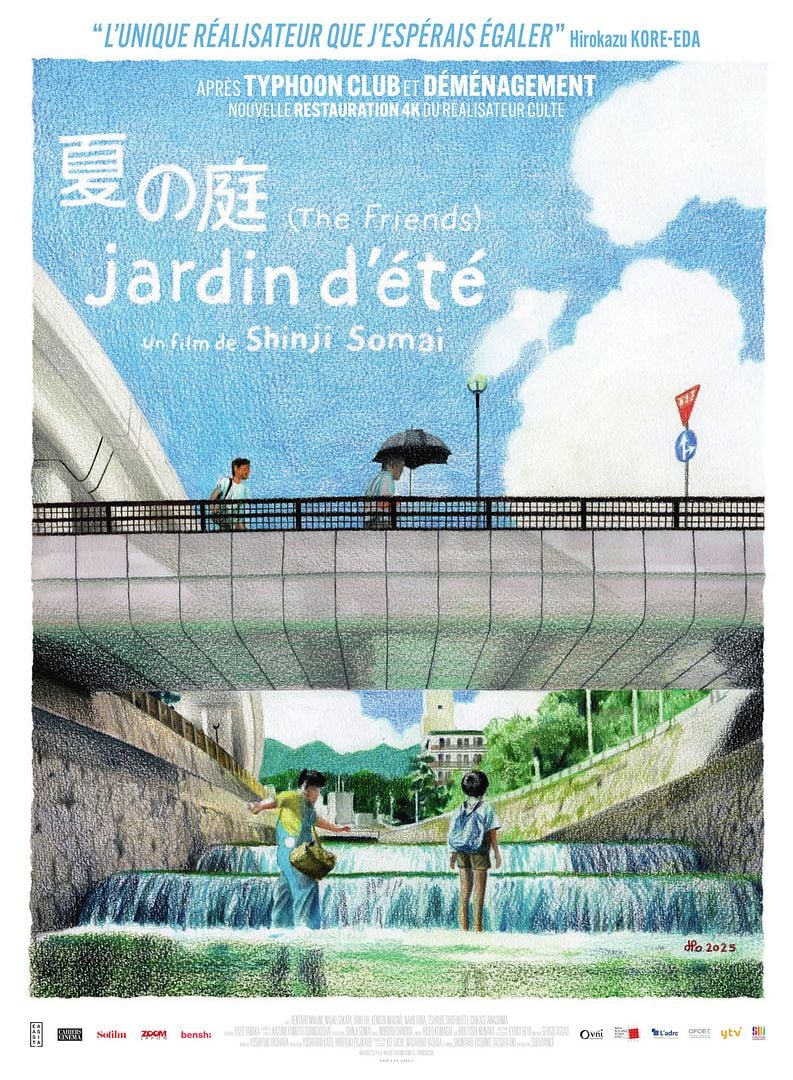Sonny Hayes (Brad Pitt) fut dans sa jeunesse un espoir de la F1, en route vers un titre mondial, avant qu’un accident ne vienne briser sa carrière. Mais il est revenu à l’anonymat, vit dans son van et ne participe plus guère qu’à quelques courses quand Ruben (Javier Bardem), son équipier du temps jadis, vient le convaincre de rempiler pour aider l’écurie qu’il dirige, classée bonne dernière, et mettre le pied à l’étrier de son jeune rookie (Damson Idris).
F1 aura été le blockbuster de l’été 2025, dépassant les six cents millions de dollars de recettes dans le monde et les trois millions de spectateurs en France.
Cet engouement était-il justifié ? À mon avis, oui et non.
F1 nous en donne pour notre argent. Le tycoon hollywoodien Jerry Bruckheimer a obtenu une wild card pour filmer directement de l’intérieur les grands prix de Silverstone et d’Abu Dhabi. Il s’est adjoint un faiseur consciencieux, Joseph Kosinski (Tron: Heritage, Oblivion, Top Gun: Maverick…), un musicien de légende, Hans Zimmer (en fermant les yeux, on se croit parfois dans Gladiator !) et un casting cosmopolite pour mettre en valeur « l’homme le plus sexy du monde ».
J’ai nommé Brad Pitt, 61 ans au compteur, mais pas un poil de graisse, des tatouages de bad boy et un sourire à faire fondre la ménagère de l’Iowa et de la Creuse. Il cabotine délicieusement pendant les 2h35 du film
Les principales limites de F1 tiennent à son cahier des charges corseté. On en sait dès le début chacune des étapes – même si je n’avais pas prévu le vainqueur du dernier Grand Prix. On sait par avance que Brad Pitt soldera les comptes de son passé et pavera pour son coéquipier le chemin de l’avenir… sans oublier de conquérir le cœur de la directrice technique de l’écurie (on notera pour s’en féliciter qu’elle a quand même la quarantaine). Ses partenaires sont réduits à de pâles caricatures : le coéquipier encore un peu tendre, le vieil ami fidèle, le traître de comédie ourdissant les plus veules trahisons, la directrice technique susmentionnée qui a pour le héros tellement séduisant les yeux de Chimène…
F1 est un film hyper-testostéroné, portant aux nues les valeurs virilistes, qui échouerait lamentablement au test de Bechdel. Sans doute ce catalogue de défauts devrait-il conduire logiquement à sa plate condamnation. Pour autant, il serait malhonnête de nier le plaisir qu’on a pris à le regarder. le scénario bien rythmé tient la durée avec une alternance de scènes de circuits fast and furious et de scènes plus intimistes ; ses images immersives à 300 km/h au ras du macadam sont à couper le souffle ; les caméos des meilleurs conducteurs du circuit sont autant de clins d’œil – à condition, ce qui n’est pas toujours mon cas, de savoir reconnaître Verstatten, Hamilton ou Leclerc. Bref un film old school où on ne s’ennuie pas.