 Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.
Le sociologue Edgar Morin et l’ethnologue Jean Rouch se sont rencontrés dans le jury d’un festival dont ils étaient tous les deux membres et ont décidé, malgré leurs divergences qui ont empoisonné sa réalisation, son montage et jusqu’à sa diffusion, de réaliser un documentaire ensemble. Leur objectif était de filmer la jeunesse française telle qu’elle était, dans son intimité et dans son environnement social et politique. L’ambition était titanesque et Chronique d’un été n’y parvient pas. Mais le film invente une méthode – un mot cher à Morin : le cinéma-vérité.
En théoricien du cinéma (Morin a signé trois ans plus tôt Les Stars), les deux réalisateurs s’interrogent sur la « vérité » documentaire. Peut-on filmer la réalité ? peut-on en rendre compte sans la déformer ? la seule présence d’une caméra ne conduit-elle pas automatiquement ceux qui la filment à « jouer » ?
Ces questions sont depuis toujours et seront encore longtemps au centre de la démarche documentaire. Frederick Wiseman – auquel la romancière, et collègue du Conseil d’Etat, Clémence Rivière, consacre un roman chez Stock – a inventé une méthode souvent reprise : accumuler les heures de tournage pour faire oublier la caméra jusqu’à obtenir « l’instant décisif », pour reprendre l’expression du photographe Henri Cartier-Bresson, la vérité nue, sans artifice.
La méthode proposée par Morin et Rouch, que reprendra trois ans plus tard Pasolini dans son Enquête sur la sexualité, est différente. Les intervieweurs sont à l’écran ; on les voit avec leur appareil d’enregistrement – qui nous semble monstrueusement encombrant mais qui était pour l’époque à la pointe de la miniaturisation – et leurs micros ; on entend le dialogue qu’ils nouent avec les interviewés.
Fort de cette méthode, Morin et Rouch réunissent quelques jeunes. On reconnaît parmi eux, au détour d’un plan Régis Debray qui avait vingt ans à peine. Marceline (Loridan) raconte dans un long plan tourné sur la place de la Concorde le vide laissé par la mort de son père et sa déportation en camp. Angelo, un fort-en-gueule, travaille chez Renault – et s’en fera licencier pendant le tournage. Marilù, une Italienne installée à Paris – qui fut l’amante de Morin, ce que le film passe sous silence – confesse ses pulsions suicidaires. Modeste Landry, un jeune Ivoirien qui a grandi dans le Lot et que Rouch venait de faire tourner dans La Pyramide humaine (un documentaire d’une incroyable justesse sur les relations entre Noirs et Blancs à l’aube de la décolonisation) évoque le racisme ordinaire qu’il subit.
Chronique d’un été vaut par les témoignages qu’il livre sur une France en noir et blanc aujourd’hui disparue. Ce qui me frappe pourrait sembler anecdotique : c’est l’élocution des Français de l’époque, leur niveau de langage et leur diction, cet accent parisien si prononcé qui me semble avoir disparu.
Mais au-delà de sa valeur historique et sociologique, Chronique d’un été vaut plus encore pour sa construction réflexive. Il s’agit d’un documentaire qui réfléchit à ce que doit être et à ce que peut être un documentaire. Dans sa dernière séquence, il nous montre sa diffusion à ses acteurs et leurs réactions, certains ne s’y reconnaissant pas, d’autres au contraire témoignant de leur gêne à se découvrir, aussi intimement dévoilés, à l’écran.

 La quarantaine, Daniel traverse une mauvaise passe. Il vient d’être mis à pied de l’académie de police où il était chargé d’instruire les jeunes recrues. Privé de salaire, contraint de licencier son assistante de vie, il doit s’occuper de son vieux père impotent. Sa seule planche de salut est la relation virtuelle qu’il entretient avec Sara, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sur un coup de tête, il décide de traverser le Brésil pour faire sa rencontre. Mais Sara glisse entre les doigts de Daniel qui ne comprend pas son entêtement à lui échapper.
La quarantaine, Daniel traverse une mauvaise passe. Il vient d’être mis à pied de l’académie de police où il était chargé d’instruire les jeunes recrues. Privé de salaire, contraint de licencier son assistante de vie, il doit s’occuper de son vieux père impotent. Sa seule planche de salut est la relation virtuelle qu’il entretient avec Sara, qu’il a rencontrée sur les réseaux sociaux. Sur un coup de tête, il décide de traverser le Brésil pour faire sa rencontre. Mais Sara glisse entre les doigts de Daniel qui ne comprend pas son entêtement à lui échapper.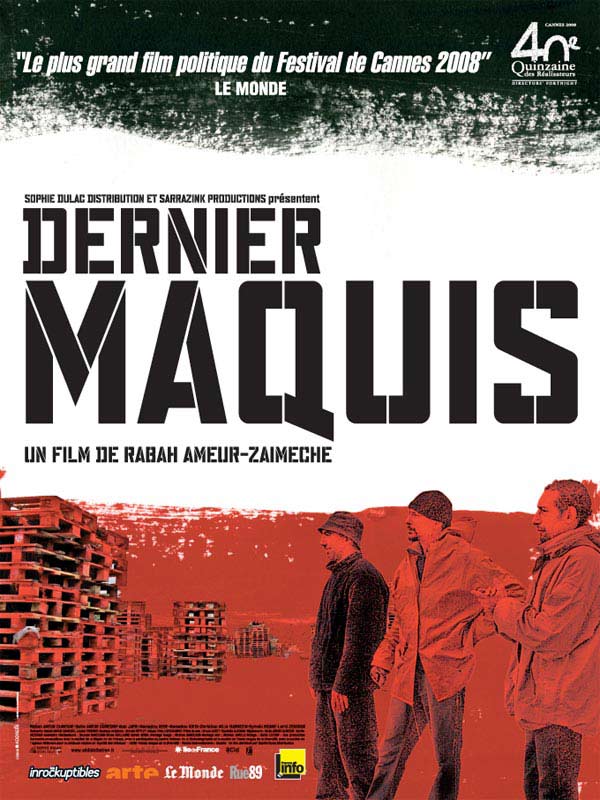
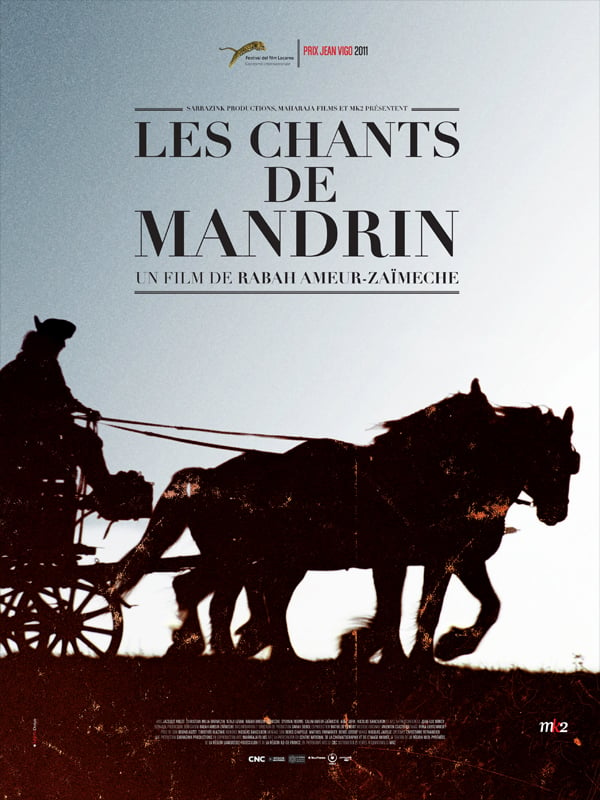 À l’occasion de la sortie du
À l’occasion de la sortie du  Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ?
Un père (Aurélien Recoing) aidé de ses trois enfants (Louis, Esther et Léna Garrel) dirige le théâtre de marionnettes créé par sa propre mère (Francine Bergé). Mais cette belle harmonie familiale se brise lorsque le père décède brutalement, bientôt suivi dans la tombe par la grand-mère. Leur disparition place les survivants face à un choix douloureux : perpétuer la tradition familiale au risque de s’étioler ? ou trouver enfin sa voie ailleurs, au risque de la trahir ? Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement.
Ansa (Alma Pöysti) travaille dans un supermarché. Holappa (Jussi Vatanen) est ouvrier dans une usine. Ces deux solitaires vont se rencontrer un soir dans un bar, se regarder et se plaire sans avoir besoin d’échanger plus que quelques paroles. Mais le sort contrariera leur rapprochement. Thien habite Saïgon. Sa belle-soeur y meurt dans un accident de scooter laissant derrière elle, un orphelin de cinq ans, Diao. Accompagné de son neveu, Thien ramène la dépouille de sa belle-soeur dans son village natal. Elle y est enterrée dans la religion catholique. Ce voyage est pour Thien l’occasion de se replonger dans son passé.
Thien habite Saïgon. Sa belle-soeur y meurt dans un accident de scooter laissant derrière elle, un orphelin de cinq ans, Diao. Accompagné de son neveu, Thien ramène la dépouille de sa belle-soeur dans son village natal. Elle y est enterrée dans la religion catholique. Ce voyage est pour Thien l’occasion de se replonger dans son passé. Retiré des affaires du monde, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) s’est installé dans la Cité des doges. Un policier italien (Riccardo Scamarcio) assure sa protection. Une amie romancière (Tina Fey), pariant sur son cartésianisme et son goût des défis, réussit toutefois à le sortir de sa retraite pour le faire assister, la nuit d’Halloween, à une séance de spiritisme dans un splendide palazzo vénitien où la fille de la propriétaire (Kelly Reilly) a trouvé la mort deux ans plus tôt. Mais la soirée, qui réunit une dizaine de convives, s’achève par la mort de l’un des participants. Refusant d’en imputer la responsabilité aux esprits qui hanteraient cette lugubre demeure, Hercule Poirot mène l’enquête.
Retiré des affaires du monde, Hercule Poirot (Kenneth Branagh) s’est installé dans la Cité des doges. Un policier italien (Riccardo Scamarcio) assure sa protection. Une amie romancière (Tina Fey), pariant sur son cartésianisme et son goût des défis, réussit toutefois à le sortir de sa retraite pour le faire assister, la nuit d’Halloween, à une séance de spiritisme dans un splendide palazzo vénitien où la fille de la propriétaire (Kelly Reilly) a trouvé la mort deux ans plus tôt. Mais la soirée, qui réunit une dizaine de convives, s’achève par la mort de l’un des participants. Refusant d’en imputer la responsabilité aux esprits qui hanteraient cette lugubre demeure, Hercule Poirot mène l’enquête. Doctorant besogneux en sciences physiques, après avoir échoué en médecine, Benjamin (Vincent lacoste) accepte un remplacement en mathématiques au collège. Ses premiers pas sont difficiles. Il a du mal à se faire respecter de ses élèves et, plus encore, à s’en faire comprendre. mais il peut compter sur l’accueil chaleureux et le soutien de ses collègues du lycée Molière : Meriem (Adèle Exarchopoulos), une autre prof de maths qui a un contact fantastique avec ses élèves, Fouad (William Lebghil), le prof d’anglais sur qui tout glisse, Sandrine (Louise Bourgoin), la prof de SVT psycho-rigide et Pierre (François Cluzet), le vieux prof de français qui leur sert à tous de grand frère ou de parrain.
Doctorant besogneux en sciences physiques, après avoir échoué en médecine, Benjamin (Vincent lacoste) accepte un remplacement en mathématiques au collège. Ses premiers pas sont difficiles. Il a du mal à se faire respecter de ses élèves et, plus encore, à s’en faire comprendre. mais il peut compter sur l’accueil chaleureux et le soutien de ses collègues du lycée Molière : Meriem (Adèle Exarchopoulos), une autre prof de maths qui a un contact fantastique avec ses élèves, Fouad (William Lebghil), le prof d’anglais sur qui tout glisse, Sandrine (Louise Bourgoin), la prof de SVT psycho-rigide et Pierre (François Cluzet), le vieux prof de français qui leur sert à tous de grand frère ou de parrain. Quand ses producteurs lui annoncent qu’ils cessent de financer son dernier film, Marc Becker s’enfuit dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun, égérie de Jean Eustache) avec sa monteuse (Blanche Gardin) et son assistante (Frankie Wallach, égérie de EDF) pour en boucler le montage. Mais cette fuite à la campagne exacerbe la créativité débordante du réalisateur, au grand dam de ses proches.
Quand ses producteurs lui annoncent qu’ils cessent de financer son dernier film, Marc Becker s’enfuit dans les Cévennes chez sa tante Denise (Françoise Lebrun, égérie de Jean Eustache) avec sa monteuse (Blanche Gardin) et son assistante (Frankie Wallach, égérie de EDF) pour en boucler le montage. Mais cette fuite à la campagne exacerbe la créativité débordante du réalisateur, au grand dam de ses proches. Tamer, Shekel et Safwat sont trois étudiants d’un lycée arabe en Israël qui, comme tous les lycées du pays, s’apprête à fêter avec pompe l’indépendance nationale le 14 mai. Mais si cette date marque pour les Juifs d’Israël l’indépendance, elle marque aussi pour les Arabes la Nakba, la catastrophe qui les a dépossédés de leurs biens et forcés à l’exil. Pour commémorer la Nakba, Safwat voudrait remplacer le drapeau israélien qui orne la façade du lycée par un drapeau palestinien. Tamer, que son histoire familiale a dissuadé de tout engagement politique, n’y est guère favorable. Mais, l’arrivée dans le groupe de Maysaa va le faire changer d’avis.
Tamer, Shekel et Safwat sont trois étudiants d’un lycée arabe en Israël qui, comme tous les lycées du pays, s’apprête à fêter avec pompe l’indépendance nationale le 14 mai. Mais si cette date marque pour les Juifs d’Israël l’indépendance, elle marque aussi pour les Arabes la Nakba, la catastrophe qui les a dépossédés de leurs biens et forcés à l’exil. Pour commémorer la Nakba, Safwat voudrait remplacer le drapeau israélien qui orne la façade du lycée par un drapeau palestinien. Tamer, que son histoire familiale a dissuadé de tout engagement politique, n’y est guère favorable. Mais, l’arrivée dans le groupe de Maysaa va le faire changer d’avis.