 Jared Eamons (Lucas Hedges propulsé ado à problèmes depuis Manchester by the sea) est le fils unique d’un couple aimant. Son père (Russell Crowe lesté – ou pas – de trente kilos supplémentaires) est un prêcheur baptiste. Sa mère (Nicole Kidman joue sans maquillage le rôle d’une épouse botoxée) accepte sans mot dire les oukases de son mari.
Jared Eamons (Lucas Hedges propulsé ado à problèmes depuis Manchester by the sea) est le fils unique d’un couple aimant. Son père (Russell Crowe lesté – ou pas – de trente kilos supplémentaires) est un prêcheur baptiste. Sa mère (Nicole Kidman joue sans maquillage le rôle d’une épouse botoxée) accepte sans mot dire les oukases de son mari.
Lorsque ses parents découvrent l’homosexualité de leur fils, ils envoient Jared suivre une thérapie de conversion dans l’espoir de l’en « guérir ».
Inspiré de l’autobiographie de Garrard Conley, Boy Erased est construit autour d’un ressort simple sinon simpliste : nous révolter face à ces cures de réorientation sexuelle, mélange improbable de croyance mystique et de psychologie new age. Elles étaient déjà le sujet de Come As You Are sorti l’été dernier. On pense dans le même registre au stupéfiant documentaire Jesus Camp sorti en 2007 sur l’endoctrinement des enfants dès leur plus jeune âge dans des colonies de vacances évangéliques.
Le problème de Boy Erased est que son ressort dramatique est faible : Jared entre en cure… et en sort. Du coup, le scénario est obligé de chercher désespérément les moyens de nourrir ce squelette : en multipliant les flash-back pour découvrir les rencontres qui ont émaillé la prise de conscience par Jared de son homosexualité, en donnant sa minute de célébrité à chacun de ses compagnons de cure (l’obèse, le rebelle, la lesbienne…) et au directeur de l’institut Love In Action (interprété par le réalisateur) dont un carton final nous révèle l’étonnant destin, etc.
Le plus intéressant est ailleurs : dans le triangle familial magnifiquement résumé dans la photo qui fait l’affiche. Joel Edgerton joue sur du velours avec deux acteurs hors pair. Nicole Kidman et Russell Crowe sont l’un comme l’autre impressionnants, chacun dans son registre. Et Lucas Hedges est décidément un solide comédien pour réussir à ne pas se faire voler la vedette par ces deux monstres sacrés.

 Janne (Aenne Schwarz) la petite trentaine vit avec Piet (Andreas Döhler). Le couple, très investi dans son travail, a fondé une maison d’édition qui bat de l’aile après le départ de leur associé. Il prend la décision de quitter la ville pour s’installer à la campagne dans une maison que leur cède un proche.
Janne (Aenne Schwarz) la petite trentaine vit avec Piet (Andreas Döhler). Le couple, très investi dans son travail, a fondé une maison d’édition qui bat de l’aile après le départ de leur associé. Il prend la décision de quitter la ville pour s’installer à la campagne dans une maison que leur cède un proche. En 1979, le communisme impose sa loi d’airain en Allemagne de l’Est, claquemurée derrière un mur infranchissable. Quelques esprits rebelles rivalisent d’ingéniosité pour le franchir. Les Strelzyk et les Wetzel imaginent de le faire par la voie des airs, en montgolfière. Une première tentative échoue de justesse.
En 1979, le communisme impose sa loi d’airain en Allemagne de l’Est, claquemurée derrière un mur infranchissable. Quelques esprits rebelles rivalisent d’ingéniosité pour le franchir. Les Strelzyk et les Wetzel imaginent de le faire par la voie des airs, en montgolfière. Une première tentative échoue de justesse.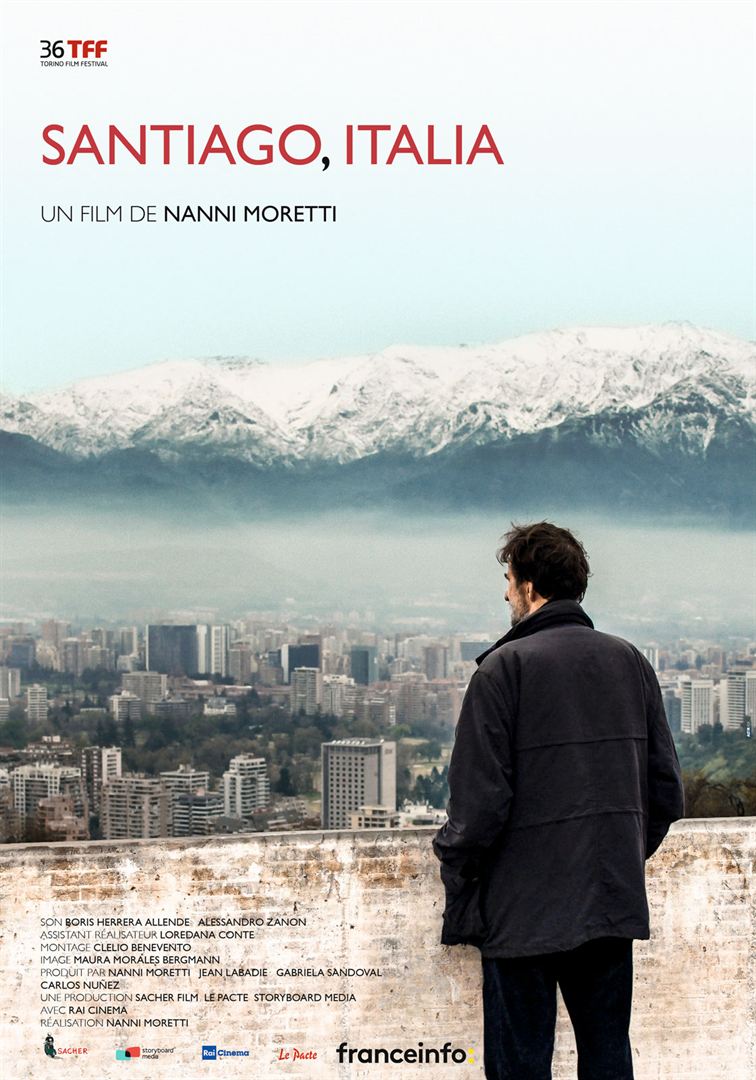 En 1973, lorsque la junte de Augusto Pinochet renverse le gouvernement de Salvador Allende et arrête en masse ses supporters, des réfugiés politiques affluent dans les ambassades étrangères de Santiago en quête de protection. L’ambassade d’Italie leur a ouvert ses portes.
En 1973, lorsque la junte de Augusto Pinochet renverse le gouvernement de Salvador Allende et arrête en masse ses supporters, des réfugiés politiques affluent dans les ambassades étrangères de Santiago en quête de protection. L’ambassade d’Italie leur a ouvert ses portes. Salam (Kais Nashif) est un Arabe israélien de Jérusalem. Chaque jour, il va travailler à Ramallah avec son oncle à une série télévisée à succès Tel Aviv on Fire dont le rôle principal est interprété par une vedette française (Lubna Azabal). Il se retrouve bientôt en charge de rédiger le scénario des derniers épisodes.
Salam (Kais Nashif) est un Arabe israélien de Jérusalem. Chaque jour, il va travailler à Ramallah avec son oncle à une série télévisée à succès Tel Aviv on Fire dont le rôle principal est interprété par une vedette française (Lubna Azabal). Il se retrouve bientôt en charge de rédiger le scénario des derniers épisodes. Jonah a dix ans à peine. C’est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Sa mère d’origine italienne et son père portoricain se sont rencontrés à Brooklyn et ont laissé derrière eux des familles, qu’on imagine volontiers hostiles à leur rapprochement, pour vivre à la campagne dans le nord de l’État de New York.
Jonah a dix ans à peine. C’est le cadet d’une fratrie de trois garçons. Sa mère d’origine italienne et son père portoricain se sont rencontrés à Brooklyn et ont laissé derrière eux des familles, qu’on imagine volontiers hostiles à leur rapprochement, pour vivre à la campagne dans le nord de l’État de New York. Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché.
Quatre kaïras et leur éducateur (sic) braquent un supermarché. La quarantaine bien entamée, Mario (Bouli Lanners) vit seul avec ses deux filles. Sa femme vient de le quitter. Niki, l’aînée, qui fêtera bientôt ses dix-huit ans, supporte vaillamment la séparation. Frida, la cadette, la vit plus mal. Mais, de tous, c’est Mario qui est le plus désemparé.
La quarantaine bien entamée, Mario (Bouli Lanners) vit seul avec ses deux filles. Sa femme vient de le quitter. Niki, l’aînée, qui fêtera bientôt ses dix-huit ans, supporte vaillamment la séparation. Frida, la cadette, la vit plus mal. Mais, de tous, c’est Mario qui est le plus désemparé. 1966. Le reporter de guerre Pierre Schoendoerffer est dépêché au Vietnam par Pierre Lazareff, le réalisateur de 5 colonnes à la Une, le magazine d’informations de l’ORTF. Le reporter de guerre qui avait combattu à Diên Biên Phu douze ans plus tôt et filmé La 317ème Section l’année précédente retourne en Indochine. Avec un caméraman et un preneur de sons, il est « embedded » pendant sept semaines dans une section de cavalerie héliportée.
1966. Le reporter de guerre Pierre Schoendoerffer est dépêché au Vietnam par Pierre Lazareff, le réalisateur de 5 colonnes à la Une, le magazine d’informations de l’ORTF. Le reporter de guerre qui avait combattu à Diên Biên Phu douze ans plus tôt et filmé La 317ème Section l’année précédente retourne en Indochine. Avec un caméraman et un preneur de sons, il est « embedded » pendant sept semaines dans une section de cavalerie héliportée. De mystérieux extra-terrestres ont envahi la planète. S’appuyant sur quelques collaborateurs, ils la gouvernent d’une main de fer. Mais la résistance s’organise.
De mystérieux extra-terrestres ont envahi la planète. S’appuyant sur quelques collaborateurs, ils la gouvernent d’une main de fer. Mais la résistance s’organise.