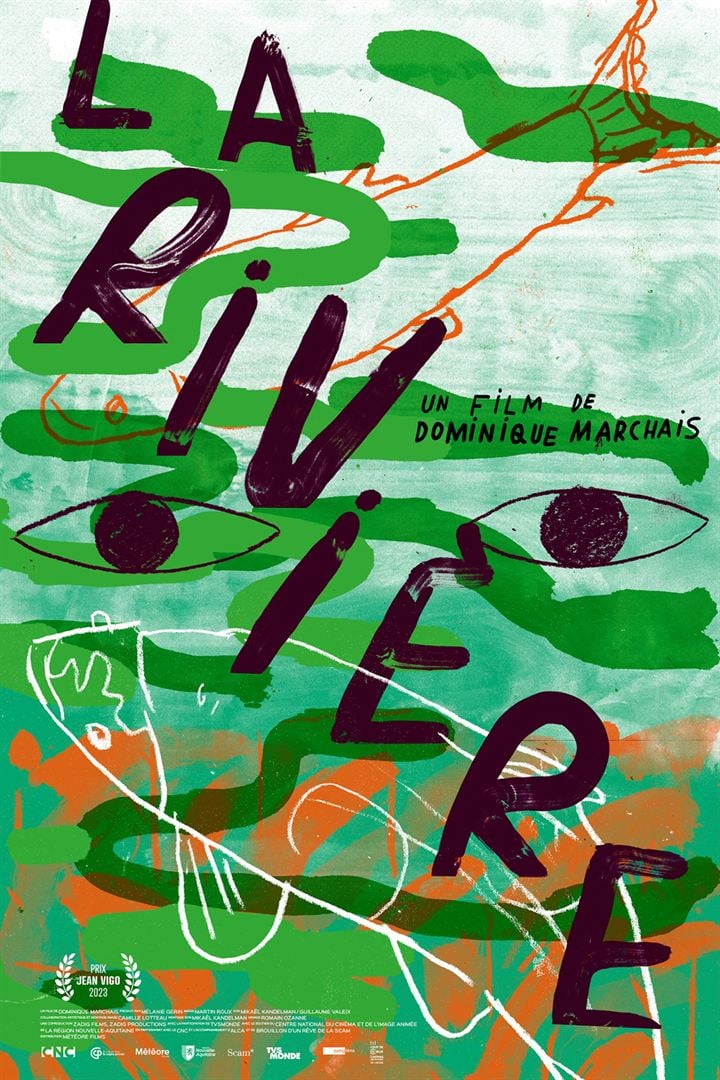 Documentariste amoureux de la nature, Dominique Marchais avait déjà consacré plusieurs documentaires aux défis posés au monde agricole : Le Temps des grâces (2009), La Ligne de partage des eaux (2013), Nul homme n’est une île (2017). Il s’est rendu cette fois, le long des gaves, ces rivières qui dégringolent des Pyrénées jusqu’à l’Atlantique, dont l’écosystème est menacé par l’activité humaine, par les barrages qui bloquent la remontée des saumons, par les pesticides et les nitrates qui les polluent, par la culture intensive du maïs qui en assèche le débit.
Documentariste amoureux de la nature, Dominique Marchais avait déjà consacré plusieurs documentaires aux défis posés au monde agricole : Le Temps des grâces (2009), La Ligne de partage des eaux (2013), Nul homme n’est une île (2017). Il s’est rendu cette fois, le long des gaves, ces rivières qui dégringolent des Pyrénées jusqu’à l’Atlantique, dont l’écosystème est menacé par l’activité humaine, par les barrages qui bloquent la remontée des saumons, par les pesticides et les nitrates qui les polluent, par la culture intensive du maïs qui en assèche le débit.
Il donne la parole à des défenseurs de l’environnement, des bénévoles, des garde-pêche, des scientifiques qui inlassablement arpentent le versant des rivières, en diagnostiquent l’inquiétante dégradation et proposent des solutions pour la ralentir.
Le documentaire écologique est devenu un genre en soi. Il ne se passe pas de mois, sinon de semaine sans qu’on en voie sortir un en salles, certes souvent, dans une distribution très confidentielle. Certains rencontrent le sujet, moins d’ailleurs en raison de leur contenu que de leurs têtes d’affiche : Une vérité qui dérange avec le prix Nobel Al Gore, Home du photographe Yann Artus-Bertrand, dont nous avons tous offert les livres illustrés à Noël à notre belle-mère/beau-frère/ filleul(e) au début des années 2000, Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent… celui qui m’a laissé le souvenir le plus marquant fut Le Cauchemar de Darwin de Hubert Sauper sorti en 2004.
Le reste de la production ne laisse pas un souvenir marquant. Elle oscille entre deux écoles. La première se veut très pédagogique. La sensibilisation et l’éducation sont ses objectifs affichés. La seconde est plus poétique voire élégiaque : c’est la nature, sa beauté, sa fragilité qui sont mises en valeur.
Le documentaire de Dominique Marchais se situe à la rencontre de ces deux tendances. Il ne résiste pas à la tentation d’esthétiser la nature, d’en filmer la tranquille beauté dans de longs travelings silencieux. Mais il entend surtout délivrer un message, radicalement écologique : les écosystèmes sont fragiles, l’activité humaine les menace et ils seront fatalement détruits si rien n’est fait pour infléchir la tendance actuelle. Il a le mérite de ne pas sombrer dans l’alarmisme et de proposer des alternatives : ainsi de la culture du maïs grand-roux basque, porteur d’une plus grande diversité génétique et moins glouton en eau.

 Eddy Bellegueule est né et a grandi dans l’ouest de la Somme dans une famille très modeste. Il s’y sent très vite rejeté en raison de ses manières efféminées et de son intellectualisme. Il quitte son village pour intégrer un internat à Amiens dans la section théâtre d’un lycée puis, le bac en poche, il entame des études d’histoire, avant d’intégrer l’Ecole normale supérieure. Son changement de nom à vingt-et-un ans consacre son changement de classe. Son parcours est désormais bien connu puisqu’il en a fait le sujet d’un livre autobiographique publié en 2014, très commenté par les médias, En finir avec Eddy Bellegueule (qui a fait en 2017 l’objet d’une adaptation à l’écran qu’Edouard Louis a reniée,
Eddy Bellegueule est né et a grandi dans l’ouest de la Somme dans une famille très modeste. Il s’y sent très vite rejeté en raison de ses manières efféminées et de son intellectualisme. Il quitte son village pour intégrer un internat à Amiens dans la section théâtre d’un lycée puis, le bac en poche, il entame des études d’histoire, avant d’intégrer l’Ecole normale supérieure. Son changement de nom à vingt-et-un ans consacre son changement de classe. Son parcours est désormais bien connu puisqu’il en a fait le sujet d’un livre autobiographique publié en 2014, très commenté par les médias, En finir avec Eddy Bellegueule (qui a fait en 2017 l’objet d’une adaptation à l’écran qu’Edouard Louis a reniée,  Au crépuscule de sa vie, la reine Conann est condamnée par Rainer, le chien des enfers (Elina Löwensohn) à revivre les six étapes de sa vie marquée par la violence. Enfant, elle assista à la mort traumatisante de sa mère et tomba en esclavage. Tous les dix ans, elle doit mourir avant de se réincarner sous une autre enveloppe.
Au crépuscule de sa vie, la reine Conann est condamnée par Rainer, le chien des enfers (Elina Löwensohn) à revivre les six étapes de sa vie marquée par la violence. Enfant, elle assista à la mort traumatisante de sa mère et tomba en esclavage. Tous les dix ans, elle doit mourir avant de se réincarner sous une autre enveloppe. Cinq jeunes femmes passent sept jours à la campagne pour y répéter une pièce de théâtre.
Cinq jeunes femmes passent sept jours à la campagne pour y répéter une pièce de théâtre.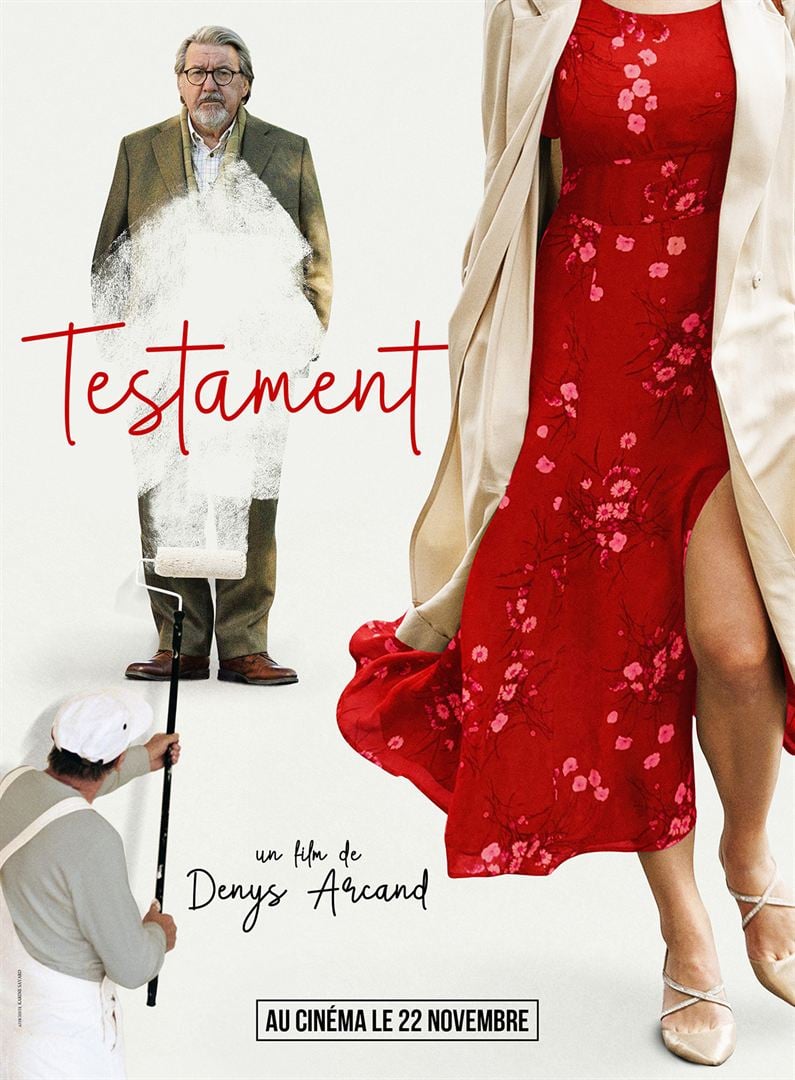 Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé.
Septuagénaire sans femme ni enfants, amer mais volontiers philosophe, Jean-Michel Bouchard se sent de plus en plus déphasé avec le monde qui l’entoure. Il attend sereinement la mort dans la maison de retraite cossue où il s’est installé.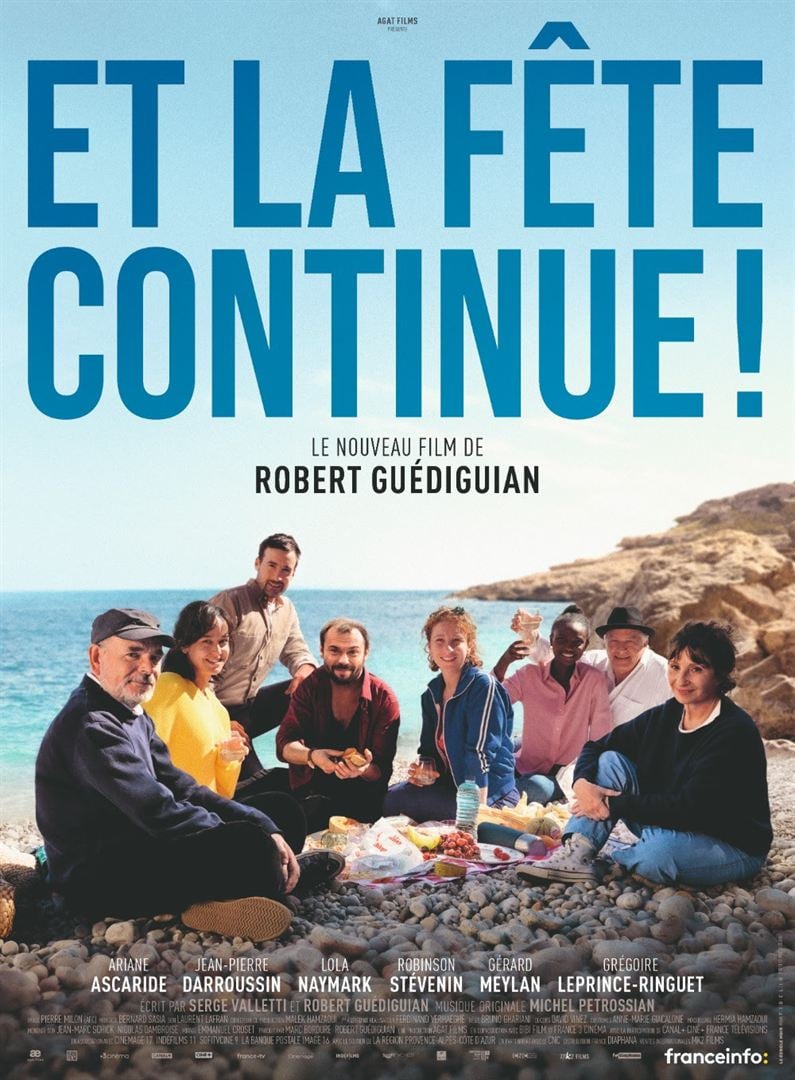 L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère.
L’effondrement de deux immeubles d’habitation le 5 novembre 2018 dans une rue populaire du premier arrondissement de Marseille cause la mort de huit locataires et plonge la cité phocéenne dans la consternation et la colère. En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.
En octobre 2006, lorsqu’il présente aux cadres de France Telecom le plan NExT, le PDG Didier Lombard se targue d’inciter au départ « par la fenêtre ou par la porte » 22 000 salariés de son entreprise. Cette formule obscène – comme celle qu’il utilisera quelques années plus tard parlant de « mode » du suicide – lui est revenue en boomerang lors du procès qui lui est intenté.
 Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille.
Viver Mal et Mal Viver sont, comme leurs titres et leurs affiches l’annoncent, deux films construits en miroir l’un de l’autre. Ils sont tous les deux tournés au même endroit – un hôtel familial qui connut jadis des jours meilleurs – l’espace de deux ou trois jours. Ils racontent tous deux la même histoire envisagée de deux points de vue : Viver Mal s’intéresse aux trois groupes de clients de l’hôtel tandis que Mal Viver se focalise sur la propriétaire et sa famille. Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse.
Dans un futur proche, de plus en plus aseptisé, où la Nature a reculé au profit de technologies qui garantissent le bien-être et la santé, Alvy et Rachel veulent un enfant. Mais ils ne le veulent pas de la même façon. Alvy, un botaniste, viscéralement nostalgique d’une époque où la Nature dictait sa loi, voudrait le concevoir naturellement. Mais Rachel, working girl très impliquée dans son travail, le convainc d’utiliser une technologie révolutionnaire : une gestation extra-utérine dans un « pod » qui, tout en assurant au fœtus des conditions optimales de gestation, évite à la mère les désagréments de la grossesse. Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres.
Depuis que la guerre a éclaté en Ukraine, Maciek Hamela a bénévolement parcouru des dizaines de milliers de kilomètres à bord de son van pour transporter des réfugiés et les aider à quitter les zones de combat. Ce Polonais, formé en France, réalisateur de plusieurs documentaires, a décidé de poser une caméra sur le tableau de bord de sa voiture et de filmer ses passagers pas comme les autres.