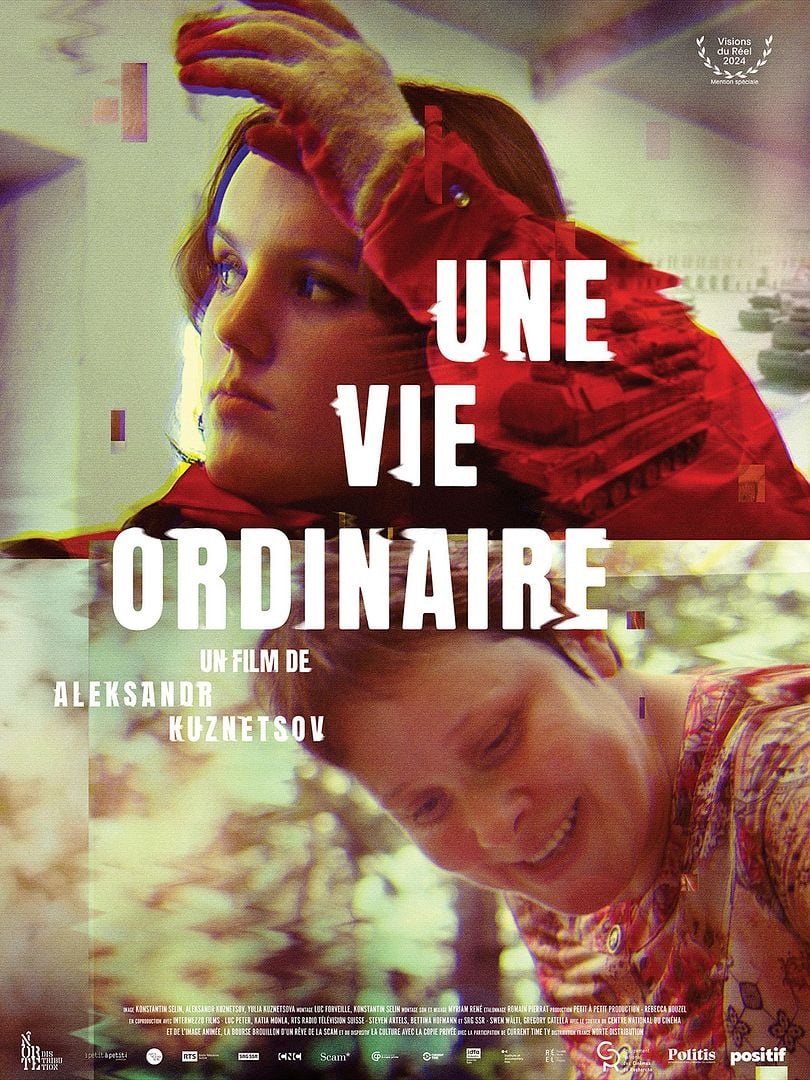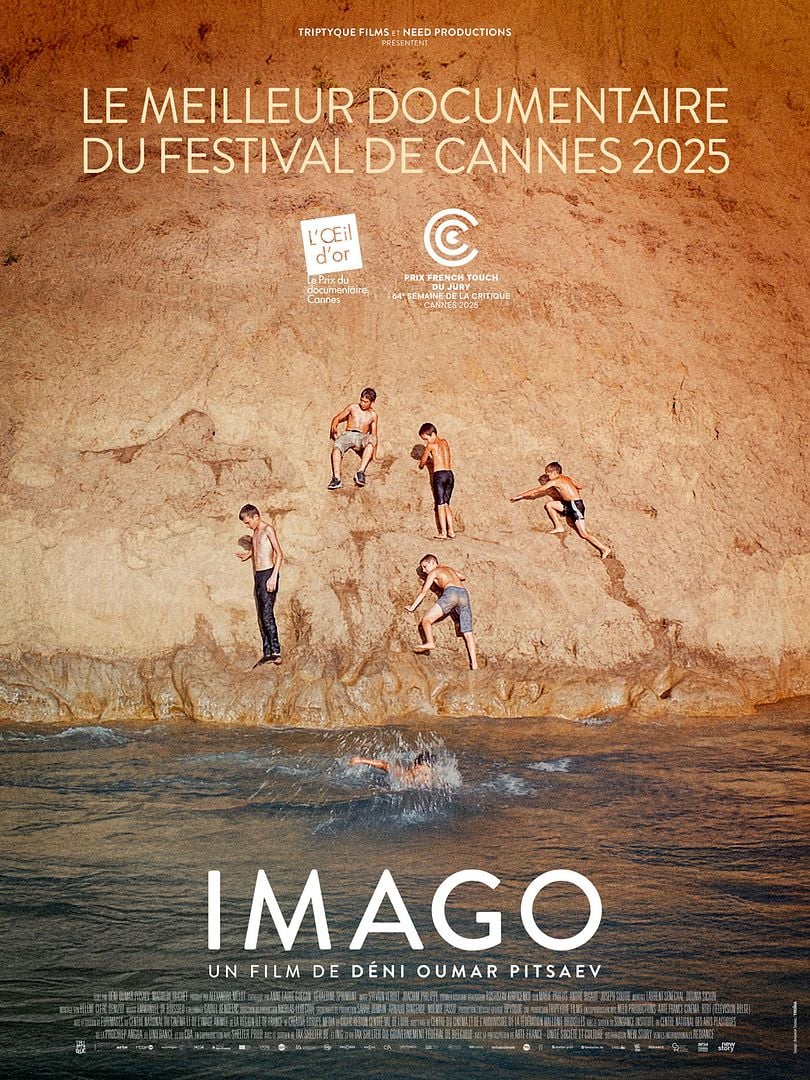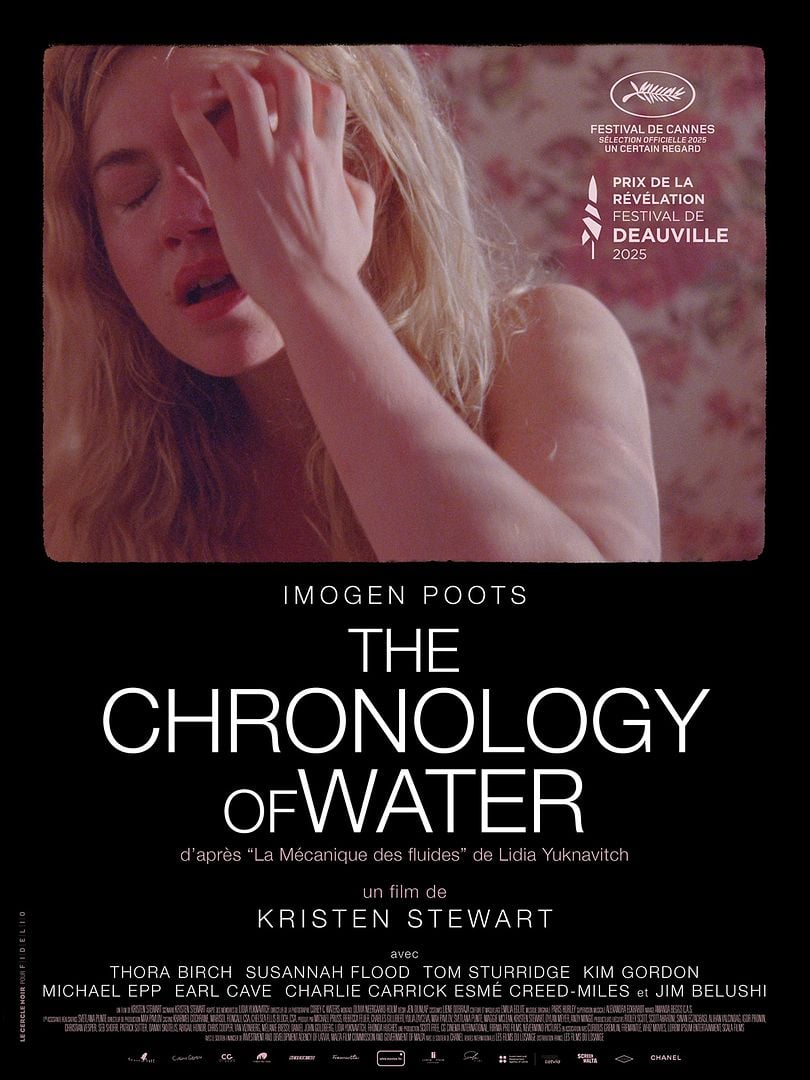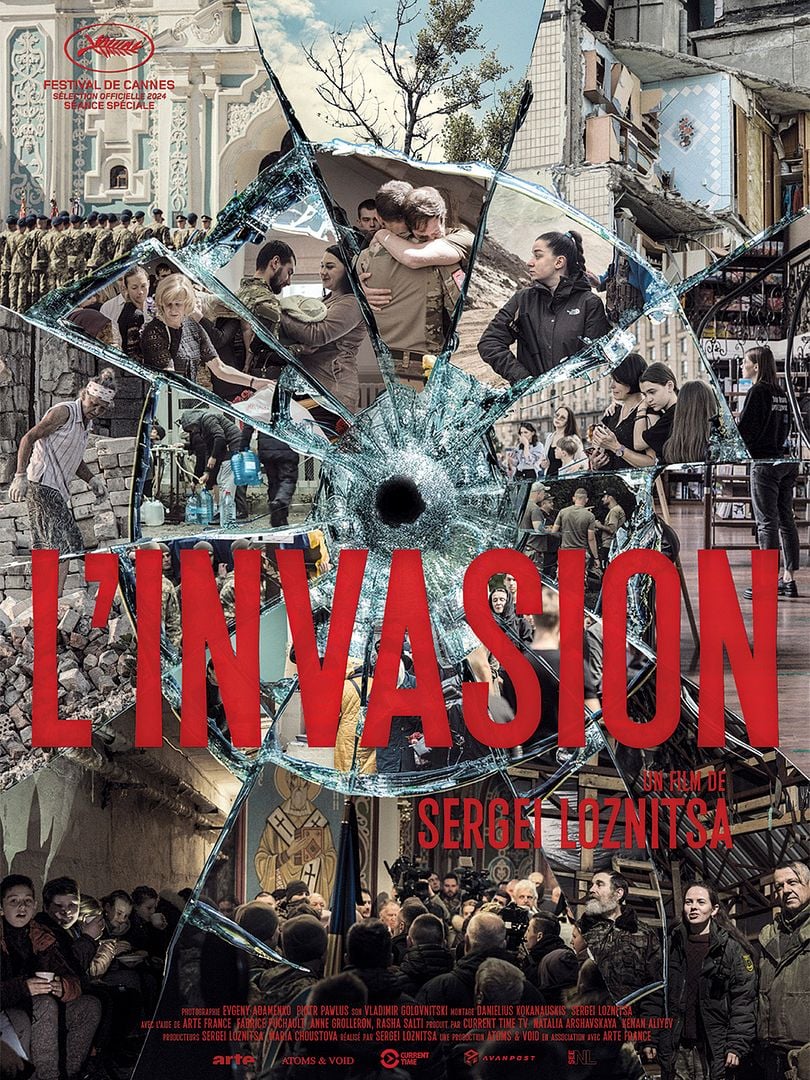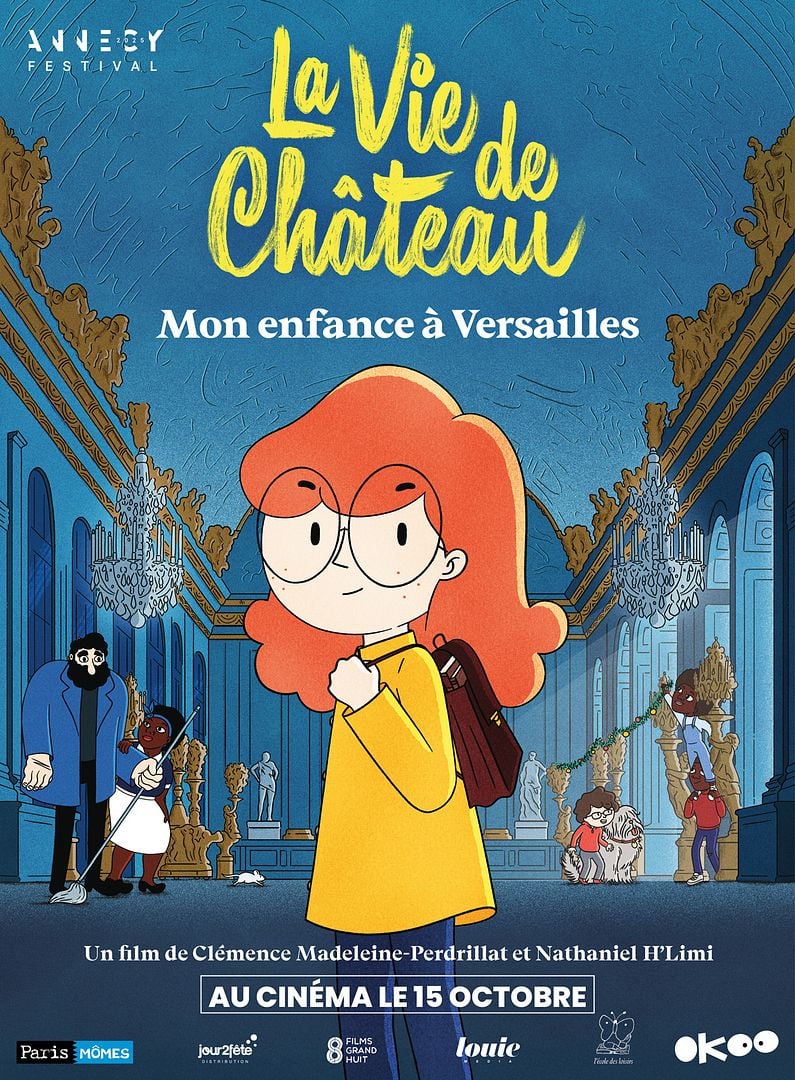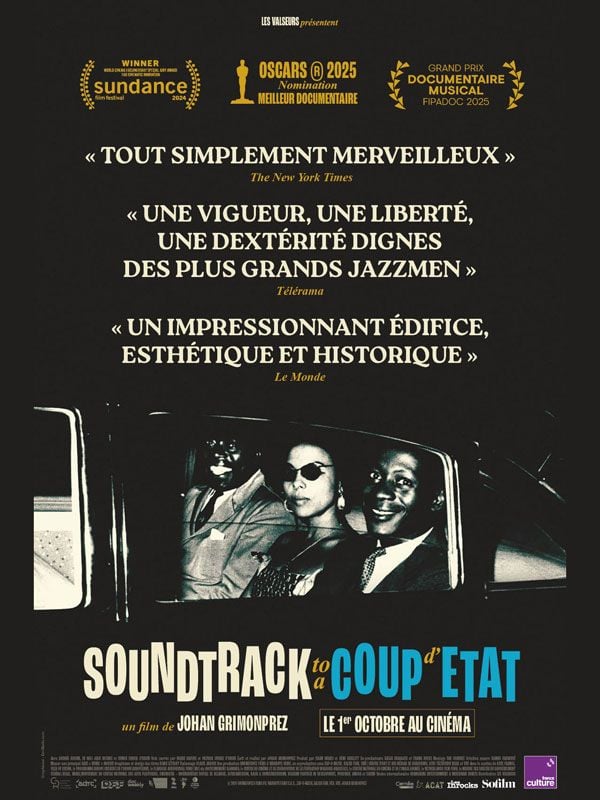Sacré Cœur a fait polémique. Les régies publicitaires de la SNCF et de la RATP ont retiré son affiche au motif qu’elle contrevenait au principe de laïcité. Le maire PS de Marseille a annulé sa projection dans une salle municipale avant que le tribunal administratif, saisi en référé par un élu RN, ne lui enjoigne de le reprogrammer. Le directeur du cinéma municipal de Clichy a démissionné après que son maire l’a forcé à le programmer.
On comprend mal une telle foire d’empoigne. Sa première conséquence aura été de donner au film une visibilité « providentielle » (sic) qu’il n’aurait jamais eue sans elle. Il approche la barre des 500.000 spectateurs, un box office inespéré pour ce genre de documentaire. Autre conséquence : sans ce parfum de soufre qui a excité ma curiosité, je ne serais jamais allé le voir.
Ce qu’il faut bien appeler un phénomène appelle deux séries de remarques.
La première est purement cinématographique. Le film ne vaut pas bezef. Son sujet est la dévotion au cœur sacré du Christ, qui trouve son origine dans deux épisodes de l’évangile selon Saint-Jean et qui fut popularisée par les révélations à la fin du XVIIe siècle de sainte Marguerite-Marie, une visitandine de Paray-le-Monial. Le documentaire essaie péniblement de reconstituer quelques scènes sans parole de la Passion ainsi que des révélations de Marguerite-Marie dans une lumière qui oscille entre les pubs de parfum et Franco Zefirelli.
Entre ces scènes sont intercalées des interviews, face caméra avec des prêtres et des théologiens. Leur contenu est très pauvre. Là où on attendait des informations sur l’histoire et la théologie du Sacré-Cœur, on n’a droit qu’à de mièvres bondieuseries répétitives sur l’amour infini du Christ.
Enfin, troisième strate, une demi-douzaine de témoignages édifiants sont rassemblés, de simples croyants, dont la vie a été bouleversée par la rencontre du Sacré-Cœur : un jeune homme en fauteuil roulant atteint de la myopathie de Duchenne, une ancienne joueuse de football de l’OL frappée par la grâce, un habitant du 9.3. devenu éducateur spécialisé, un percussionniste franco-mexicain en mal d’identité…
La seconde est politique. Sacré Cœur justifie-t-il l’émoi qu’il a suscité ? Certainement pas. C’est un documentaire religieux, produit et distribué par une société de production qui n’en est pas à son coup d’essai. J’avais déjà eu l’occasion de dire ici tout le mal que je pensais d’un de ses précédents documentaires, Libres, sur la vie monastique. Certes, le film a été financé par Canal Plus, propriété du groupe Bolloré. Certes aussi, les médias du groupe Bolloré (CNews, Europe 1, Le Journal du dimanche) en ont fait la publicité. mais cela ne suffit pas à faire de ce documentaire médiocre un instrument de propagande d’extrême droite. « Catho » ne rime pas nécessairement avec « facho ».