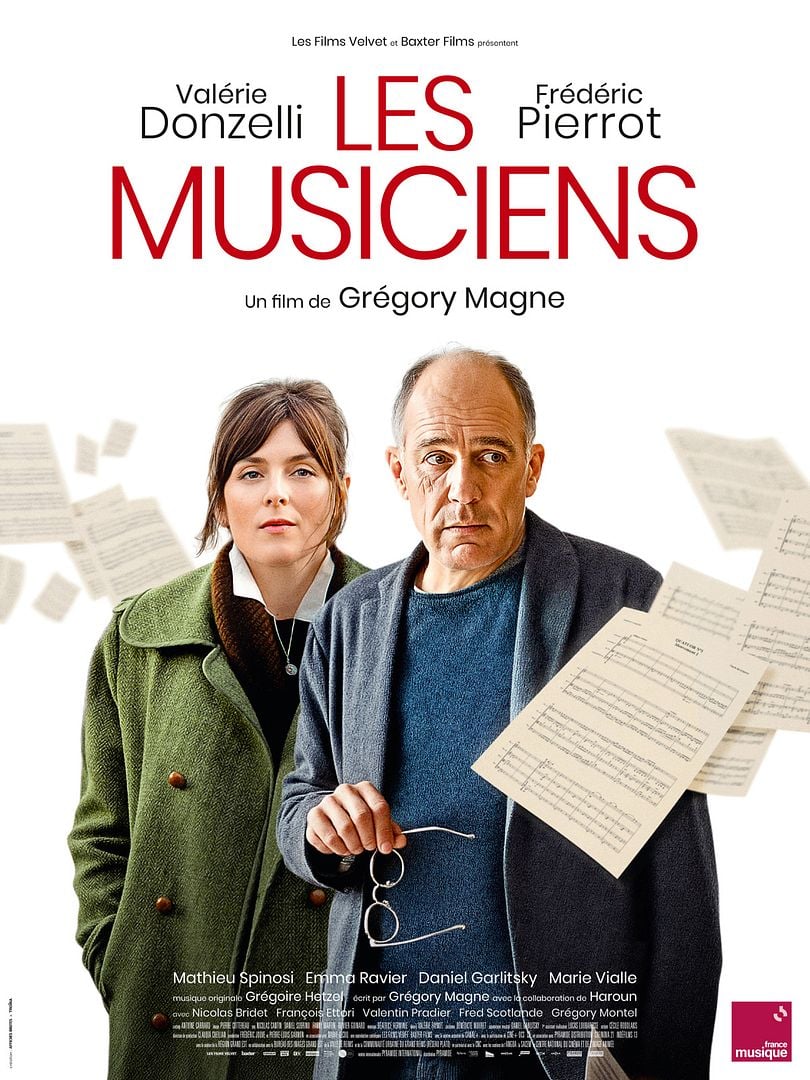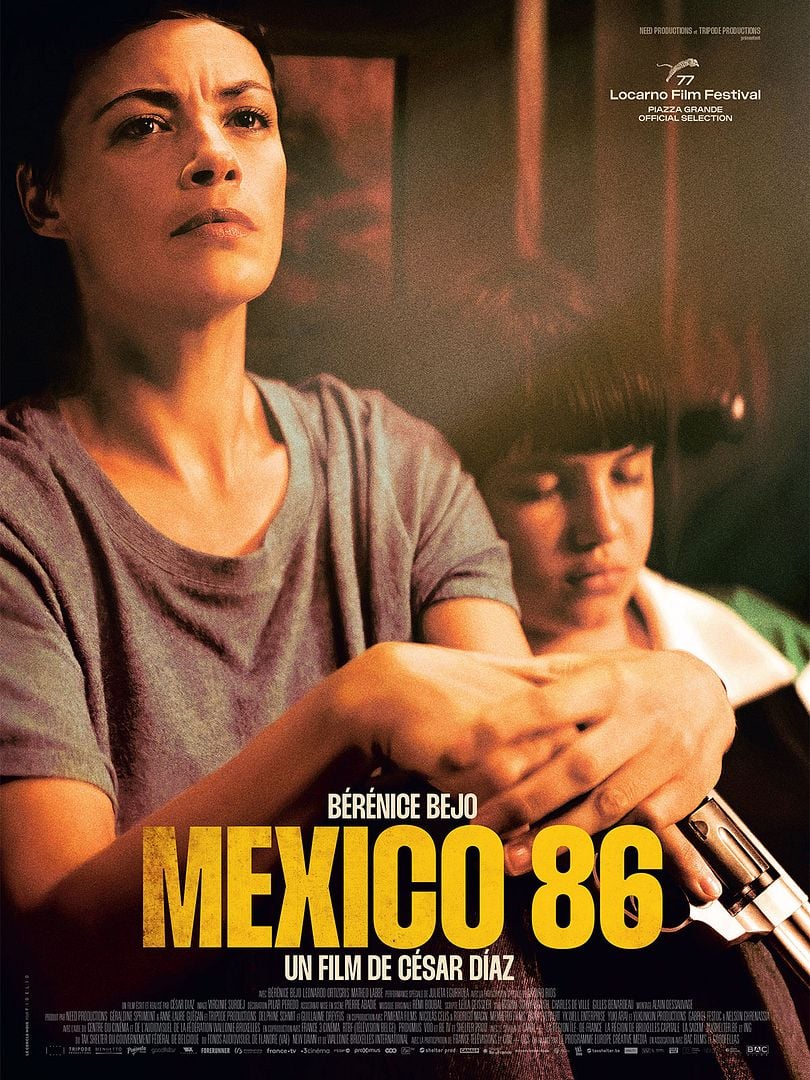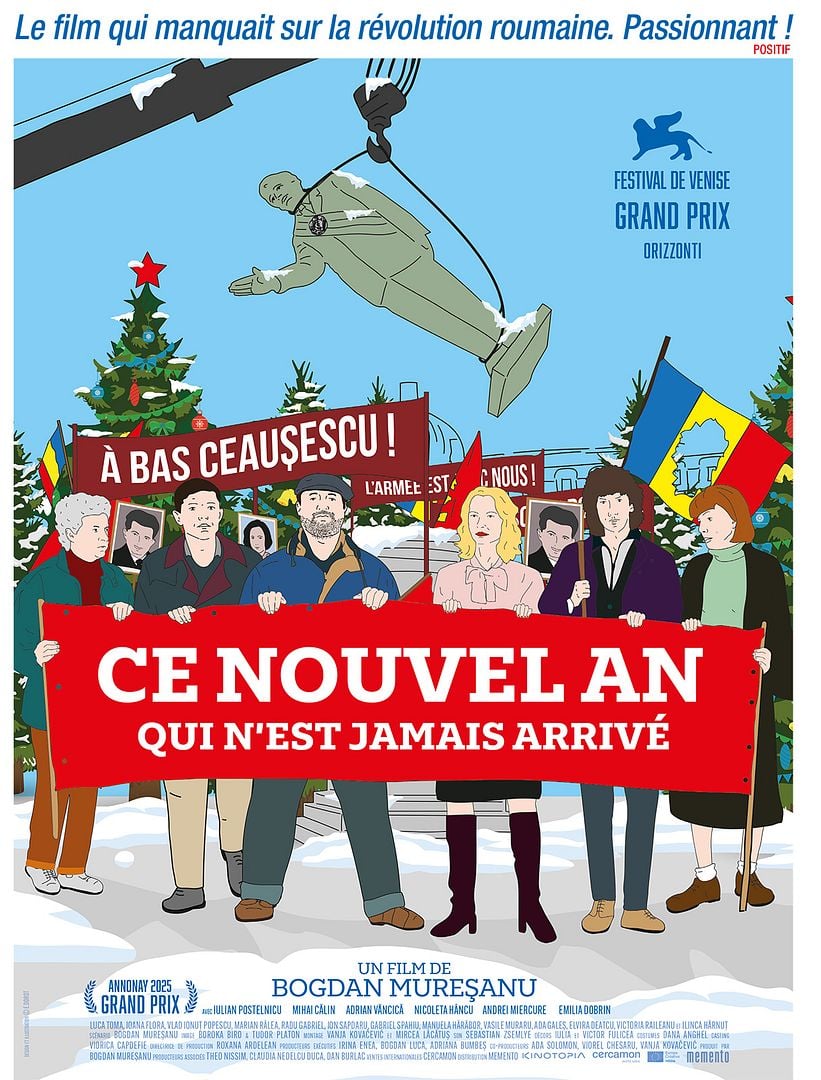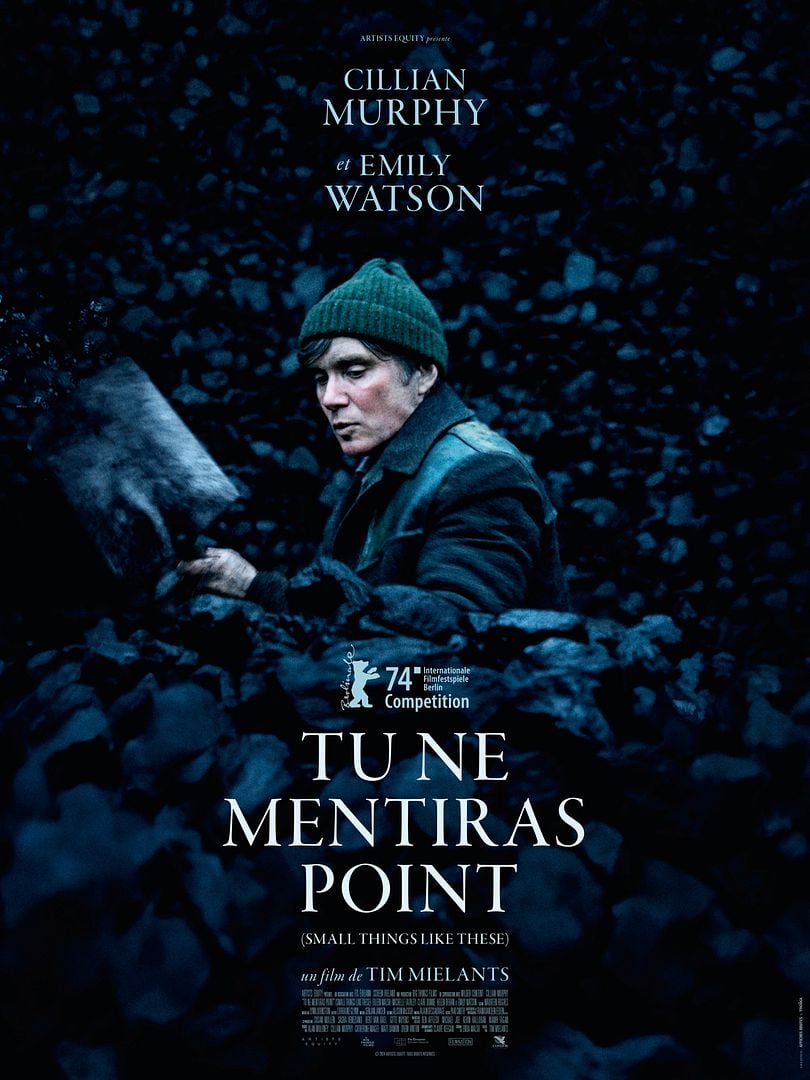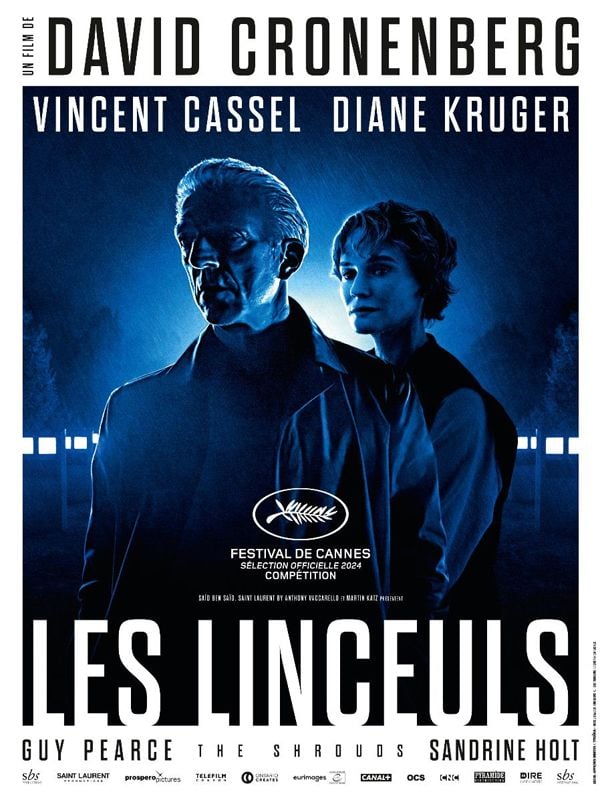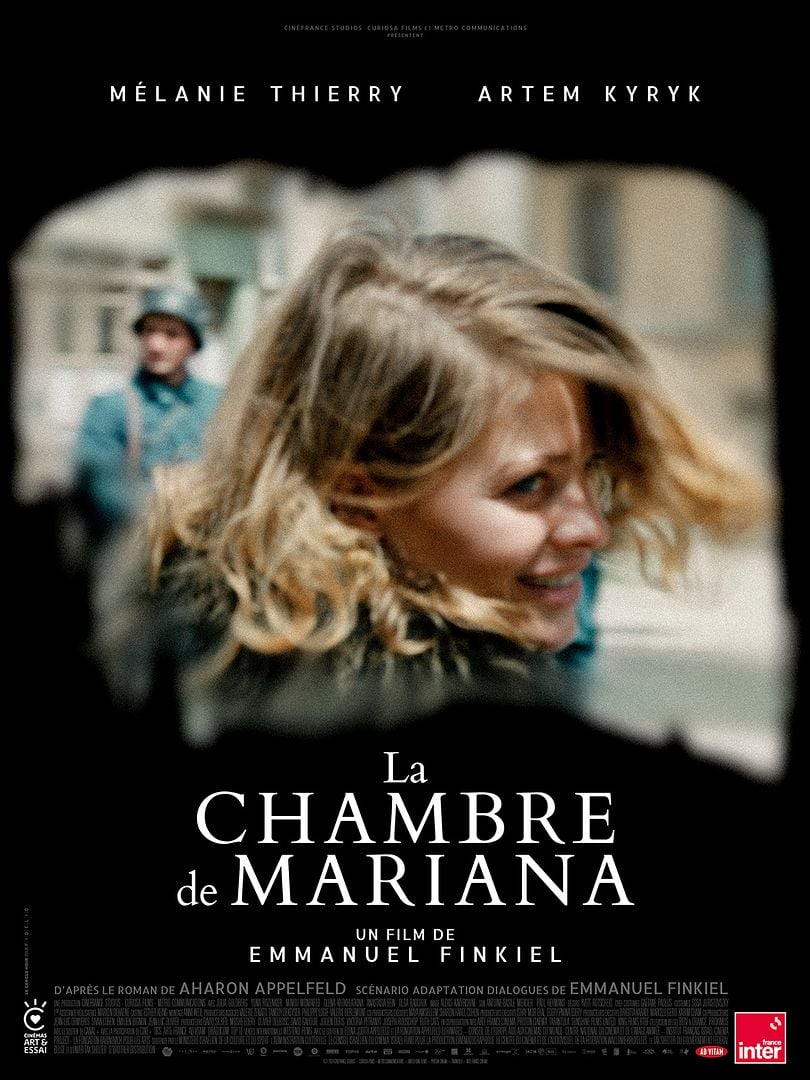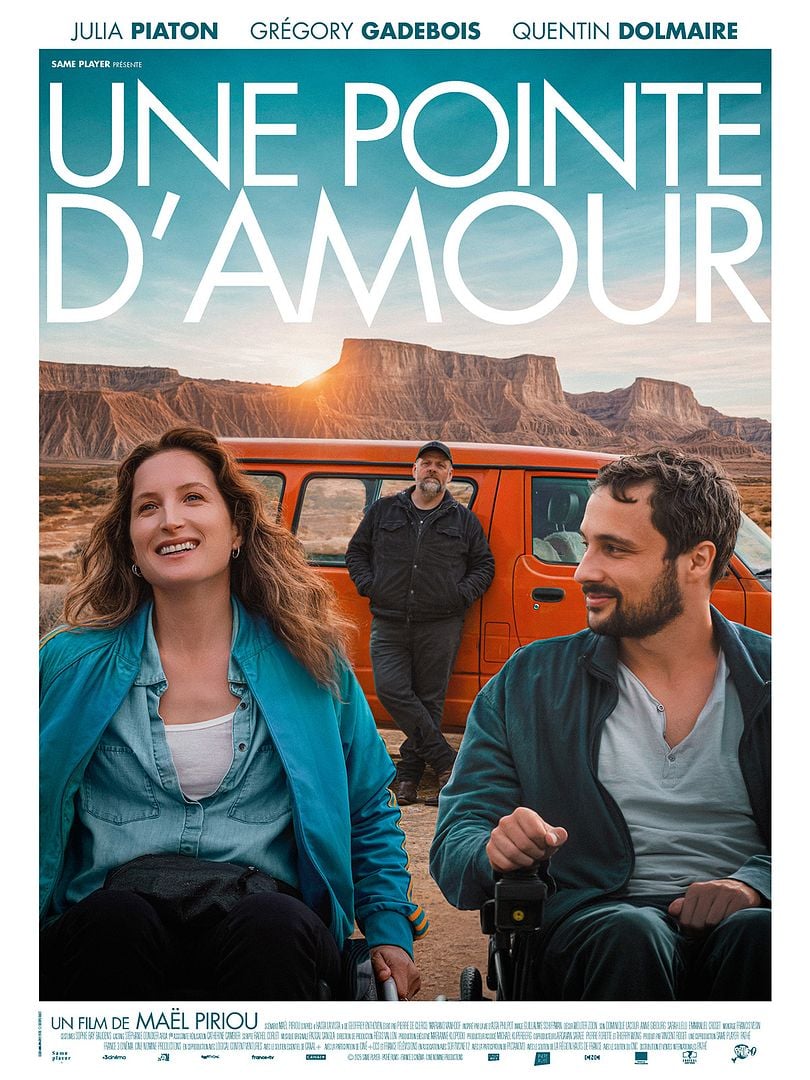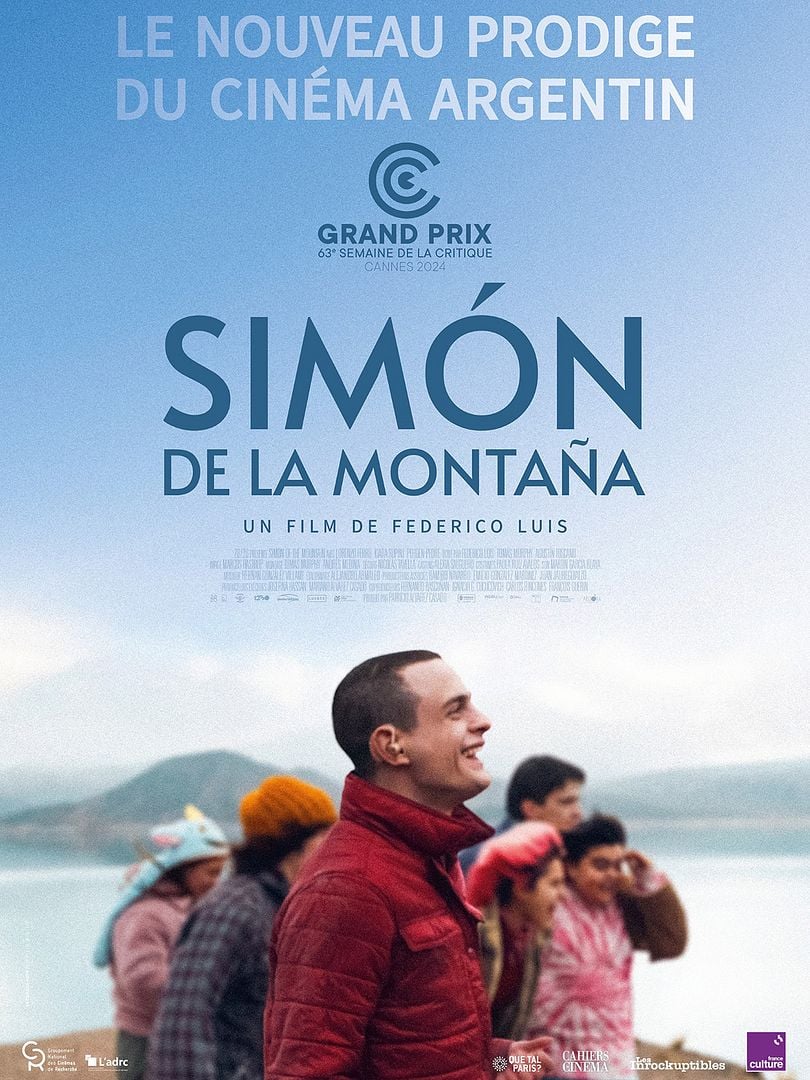Dan est employé de la voirie de Chicago. Il n’est plus le même homme depuis qu’un drame a anéanti sa vie. Le hasard d’une rencontre le conduit à rejoindre une troupe de théâtre où il jouera Roméo et Juliette. Cette expérience cathartique sera pour lui le moyen de se réconcilier avec sa femme et avec sa fille, en pleine crise d’adolescence.
Le scénario de Ghostlight pourrait sembler bien artificiel : il croise le deuil d’une famille inconsolable et la mise en scène par une troupe de théâtre amateur de la pièce archiconnue de Shakespeare. Pourtant, à partir de ce point de départ improbable, Kelly O’Sullivan et Alex Thompson, le couple derrière la caméra, signent un film d’une bouleversante justesse qui m’a fait pleurer de la première (j’exagère : disons la deuxième) à la dernière minute.
La raison de ma réaction est double : mon histoire familiale et mon goût immodéré pour Roméo et Juliette auquel je voue, depuis l’adaptation millenial et musicale de Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio et Clare Danes en 1996 qui avait divisé la critique et m’avait transporté, une admiration irraisonnée. À la même époque, j’en avais vu au théâtre des Amandiers la mise en scène de Stuart Seide qui est restée gravée dans ma mémoire. Il suffit que j’entende les premiers mots de son prologue (« Two households both alike in dignity/ In fair Verona…« ) pour que je tombe en pâmoison.
Les trois rôles principaux – le père, la mère et leur fille – sont joués par une « vraie » famille à la ville : Keith Kupferer (une sorte de Michel Barnier aux cheveux bouclés), sa femme Tara Mallen et leur fille Katherine Mallen Kupferer. Cette dernière est particulièrement remarquable. Elle joue à la perfection une adolescente en surtension permanente, aussi prompte à se révolter (contre la bêtise des adultes et la routine du lycée) qu’à s’enthousiasmer (pour la troupe de théâtre qui, après avoir ouvert ses portes à son père, lui ouvre ses bras). Sa folle énergie contraste avec la placidité dépressive de son père qui s’est muré dans le silence.