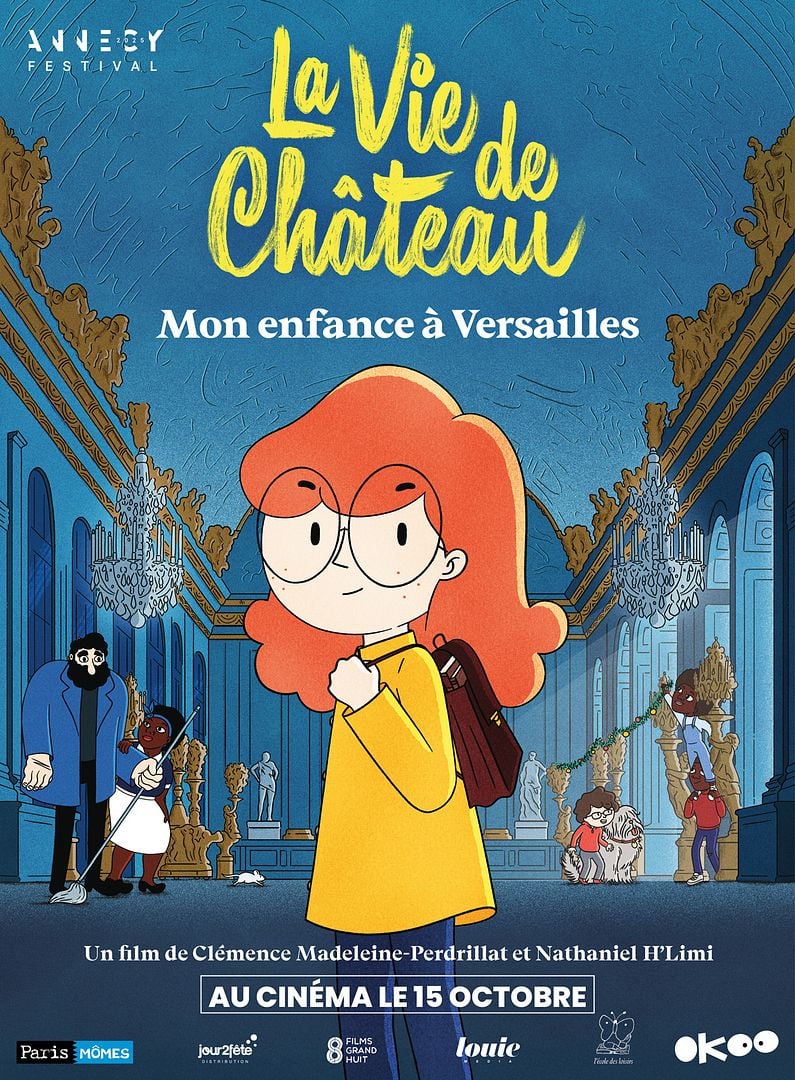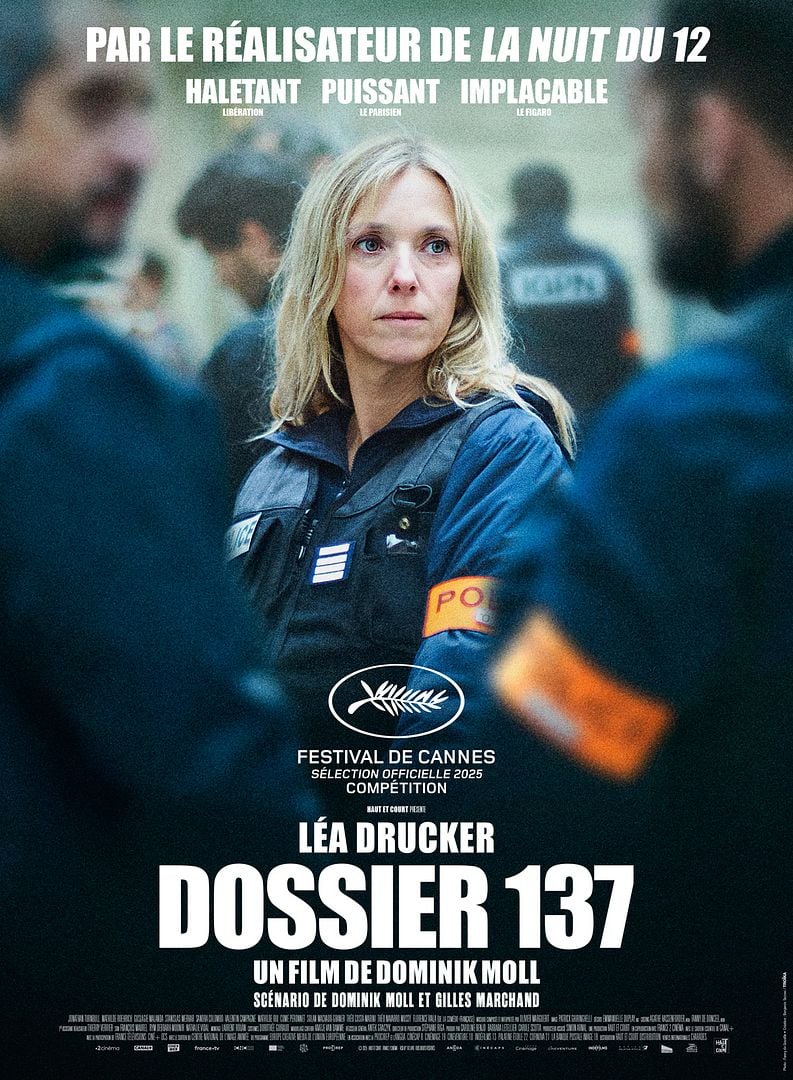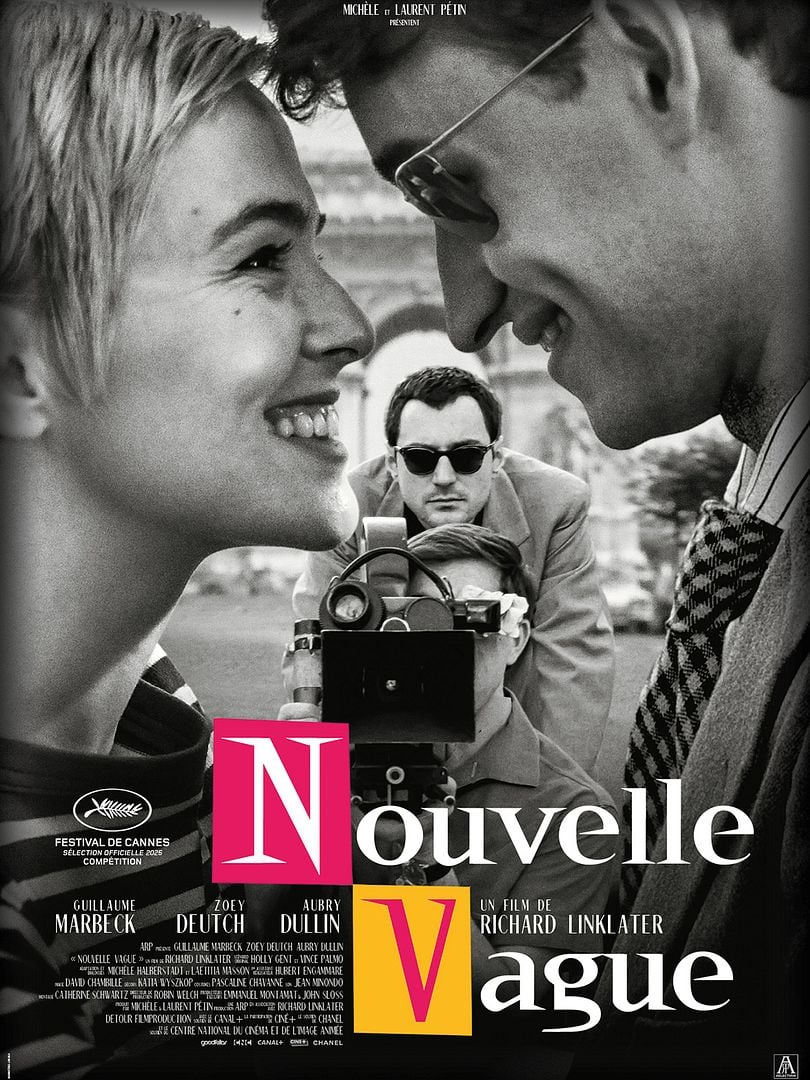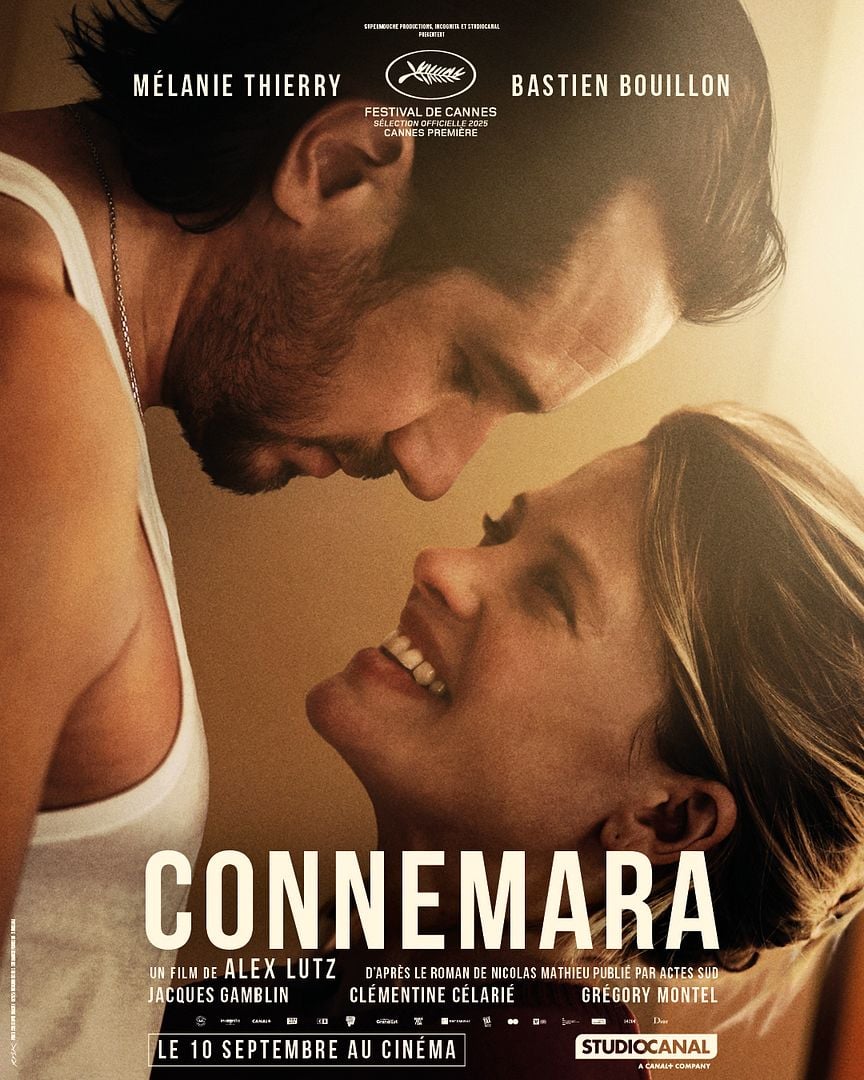Médecin au Havre dans une unité de soins palliatifs, Elsa a hérité de sa mère un don extraordinaire : elle peut voir les morts en peine et les aider à quitter définitivement notre Terre. Mais ce don encombrant a mis à mal sa vie amoureuse. Jusqu’au jour où elle fait la connaissance d’Oscar et entame avec lui une relation passionnée.
La bande-annonce de L’Âme idéale vend la mèche : on y apprend qu’Oscar est mort. Et on pressent déjà ce que le reste du film, privé de ce qui en faisait sans doute le sel, sera : un mélo sirupeux qui se conclura fatalement par le « grand départ » d’Oscar vers un au-delà apaisé. C’était déjà ainsi que se terminait, on s’en souvient Ghost avec Demi Moore et Patrick Swayze.
Oui, mais voilà : le rouge au front, je dois confesser avoir adoré Ghost malgré ses pesantes références eschatologiques ! Vous l’aviez, cher lecteur, déjà pressenti en notant mon penchant coupable pour les comédies musicales genre Les Parapluies de Cherbourg et La La Land : les mélos sirupeux me font fondre.
Aussi, j’ai eu un coup de cœur pour L’Âme idéale, un film qui ne mérite certainement pas les trois étoiles que je lui donne. Pourtant son histoire, j’en ai eu la confirmation, ne réserve aucune surprise : on sait dès le commencement comment elle se terminera.
L’héroïne a le don de voir et de dialoguer avec les morts. La situation pourrait sembler dénuée de toute crédibilité. Combien de fois d’ailleurs dans mes critiques en fais-je le reproche ? Ainsi tout récemment pour Louise. Ici cela ne m’a pas dérangé. Car dès lors que le postulat – aussi peu crédible soit-il comme d’ailleurs dans L’homme qui rétrécit – est posé, le reste de l’histoire s’enchaîne logiquement. Un tel point de départ pourrait donner lieu à des situations comiques. Le scénario d’ailleurs hésite un instant à s’engager dans cette direction. Mais il s’auto-censure et reste dans une veine mélodramatique.
L’Âme idéale n’est pas seulement un mélo. Son sujet invite à une réflexion sur l’attachement, la mort, la séparation. Plus inattendu : l’évolution du personnage d’Elisa invite à une réflexion sur la folie, sur la vie et ce qui en fait le prix.
Son duo d’acteurs est épatant. La Québécoise Magalie Lépine-Blondeau, dont la voix a parfois les mêmes accents graves que celle, envoutante, d’Anna Mouglalis, franchit avec succès l’Atlantique. Jonathan Cohen a presque réussi à me convaincre qu’il est un acteur dramatique. Dommage que ce duo ne laisse pas suffisamment de place aux seconds rôles.