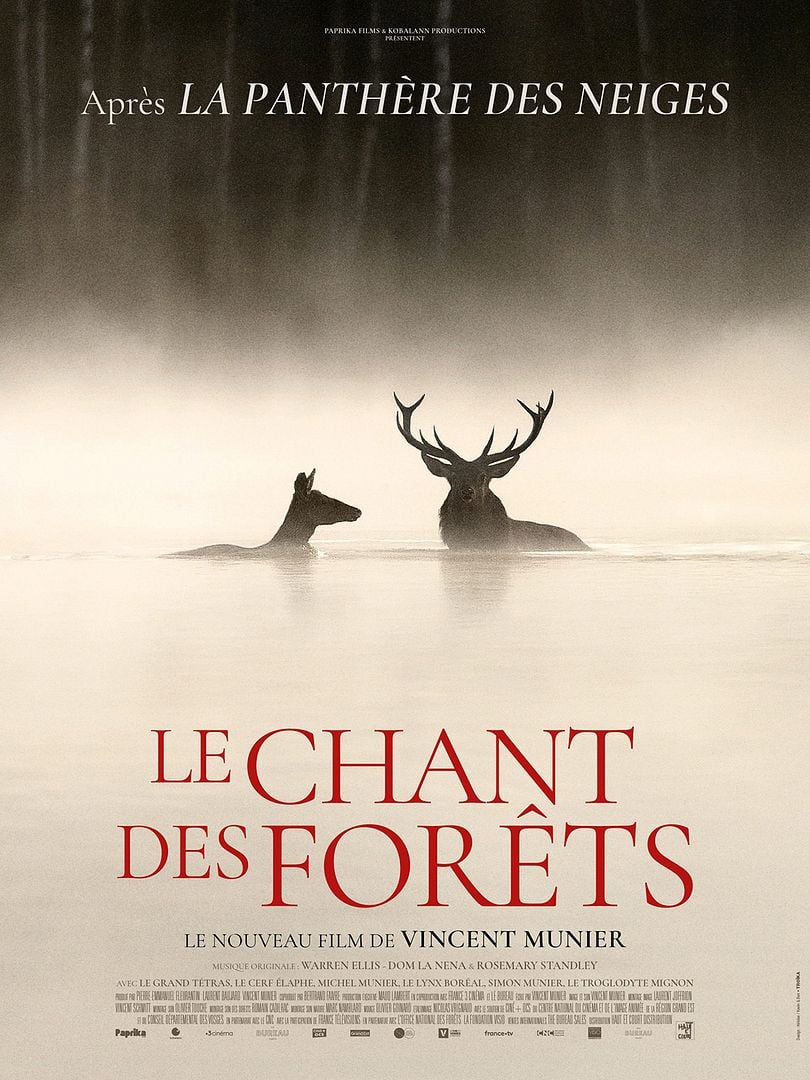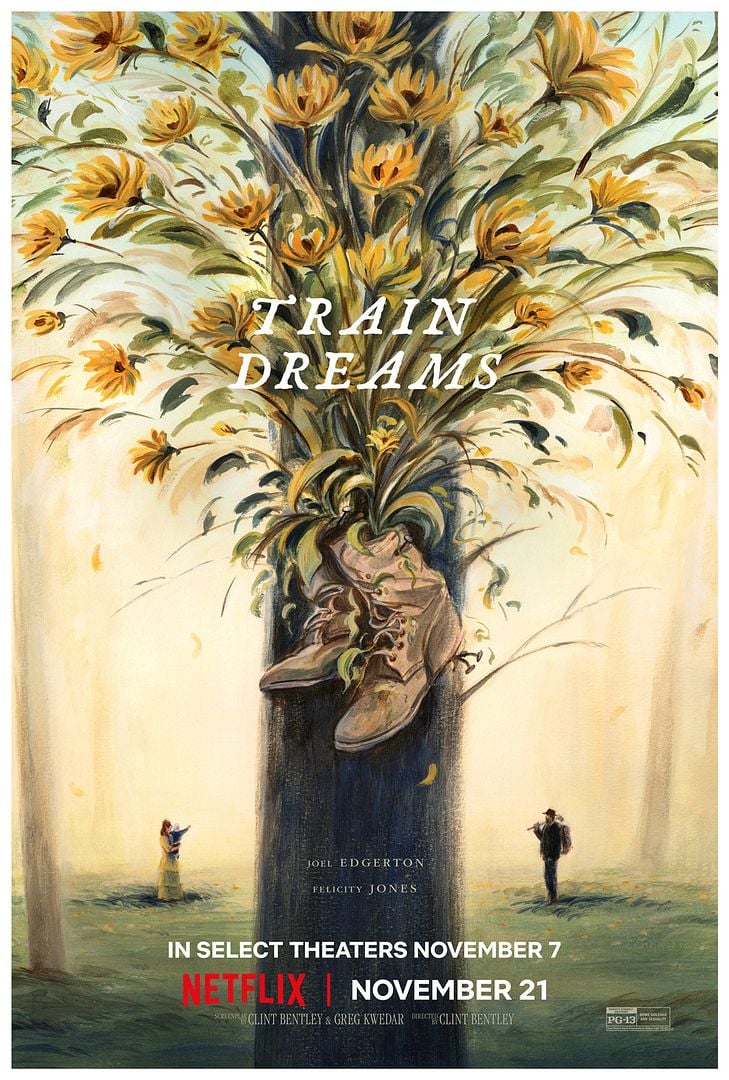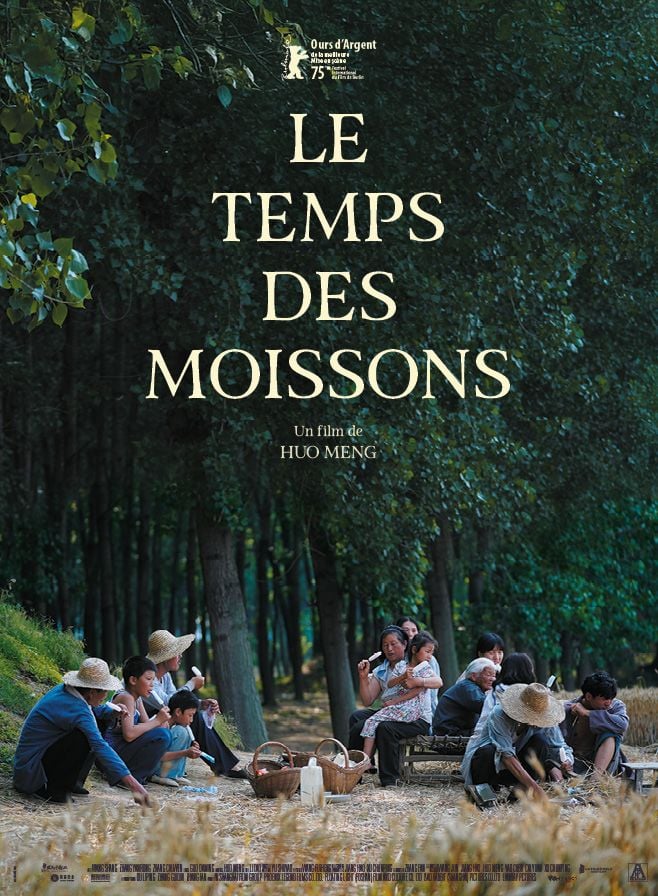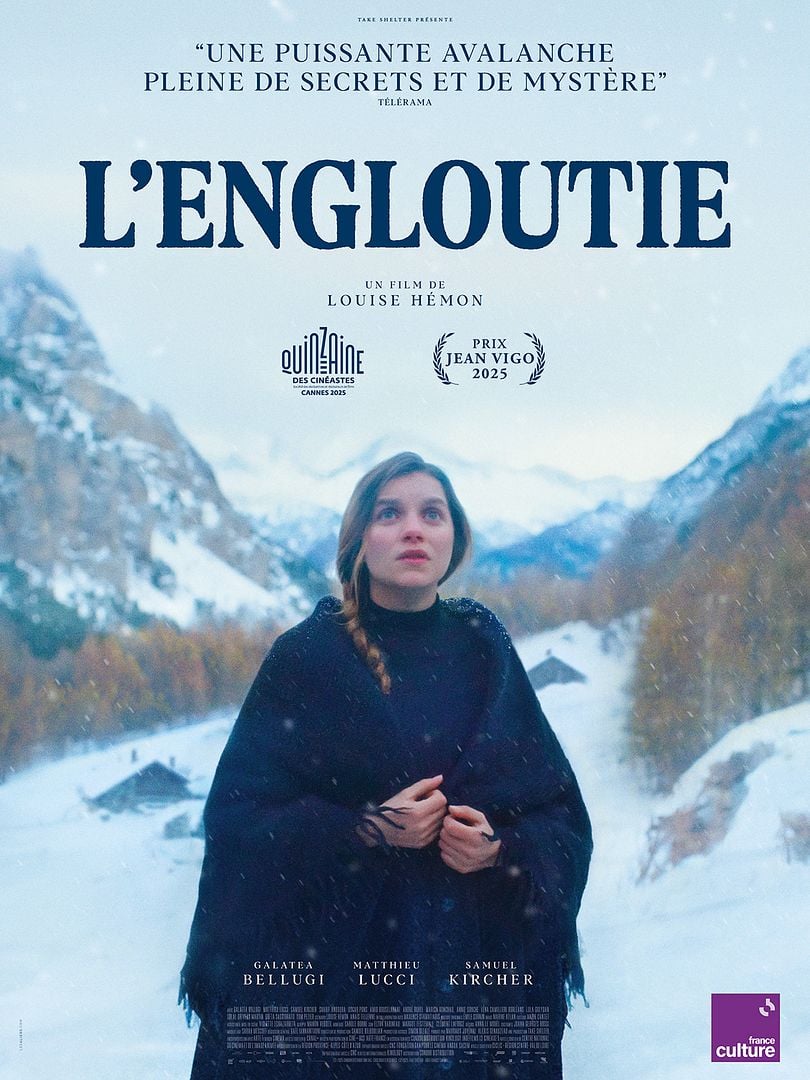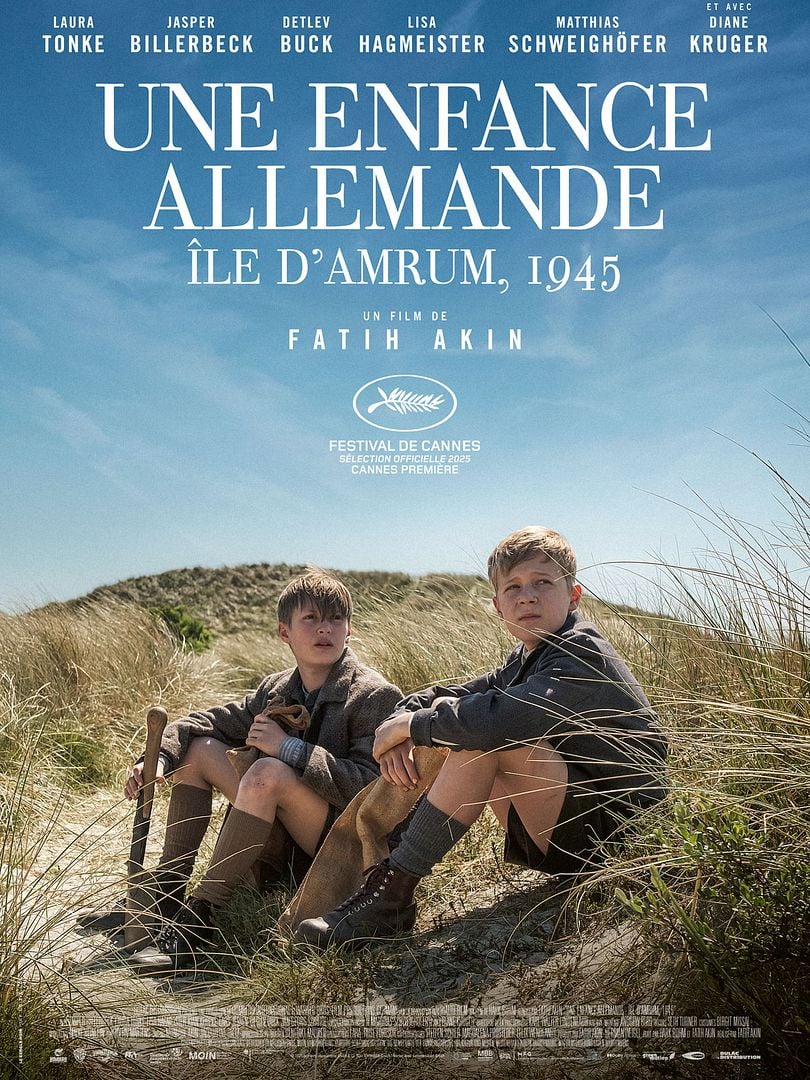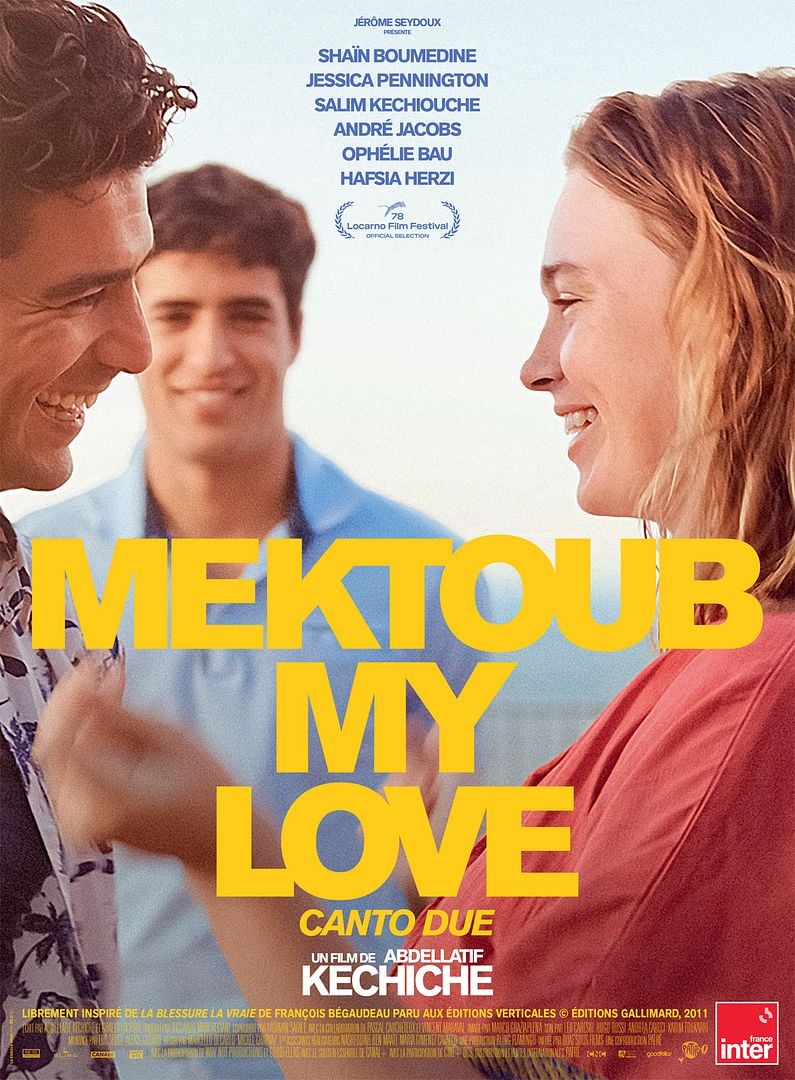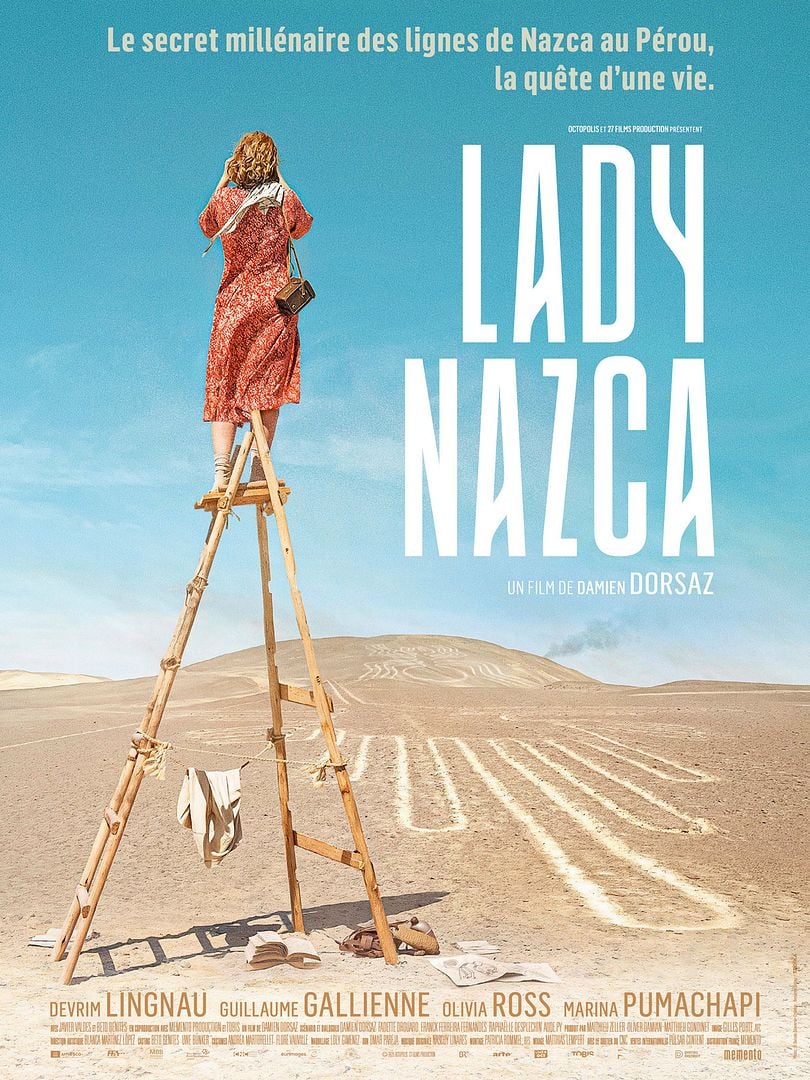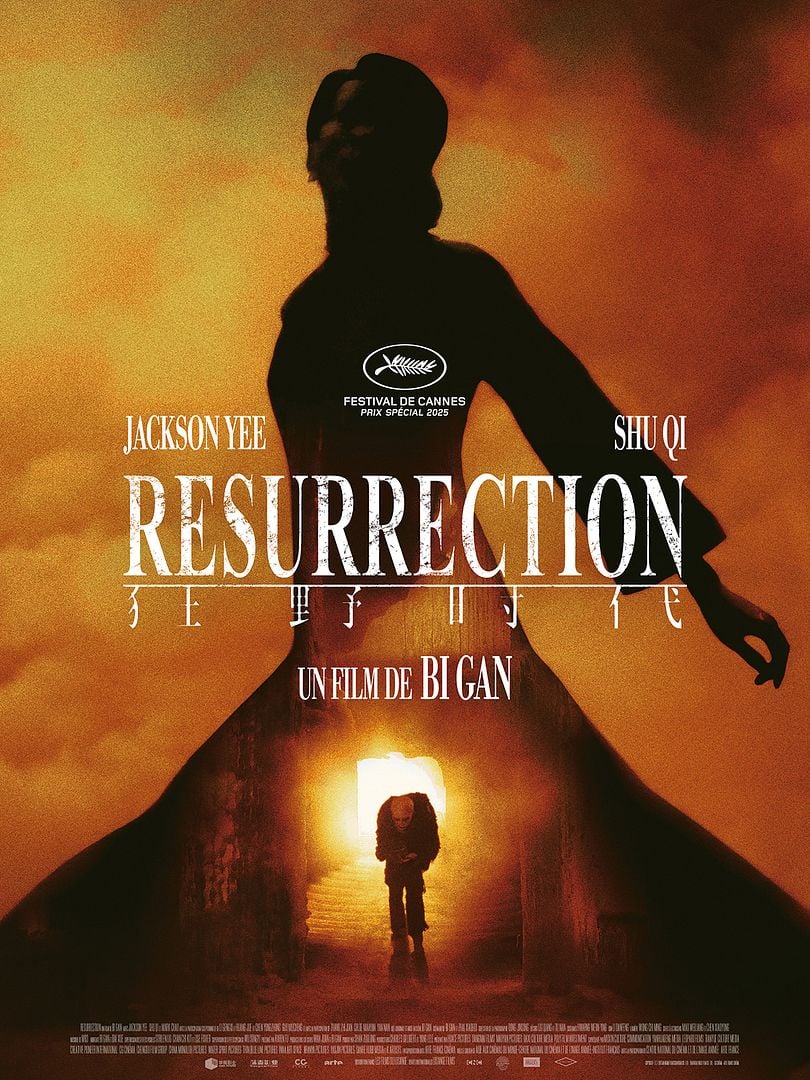Antonio et Estrella vivent depuis leur plus tendre enfance au bord de l’eau. Leur père était plongeur professionnel. Ils ont repris sa maison et son travail, même si un accident de plongée a endommagé l’ouïe d’Estrella (Bárbara Lennie) et lui interdit les grands fonds. Antonio (Antonio de la Torre) continue, malgré l’âge, à mener les opérations les plus périlleuses, même si sa santé présente des signes préoccupants. Son divorce se passe mal. Sa femme lui reproche de ne pas lui verser de pension alimentaire. Aussi est-il tenté de détourner une cargaison de drogue avec la complicité de sa sœur.
Le duo efficace de La Isla Minima, un polar poisseux qui se déroulait dans la chaleur écrasante du delta de Guadalquivir, se reforme quelques kilomètres plus au nord, devant le port pétrolier de Huelva : Alberto Rodriguez derrière la caméra, Antonio de la Torre devant. Comme dans leur précédent film, le décor est un personnage à part entière. Ici l’industrie pétrolière, le trafic incessant des supertankers et la maintenance portuaire assurée par une nuée de sous-traitants se livrant entre eux une concurrence féroce.
Cette dimension documentaire n’est qu’une toile de fond. Mais elle constitue la principale qualité de ce film, le trait distinctif dont je garderai le souvenir. Le reste est plus banal.
Il y a d’une part une vague intrigue policière autour d’une cargaison de drogue que Antonio et Estrella détournent grâce à un procédé ingénieux. Tout évidemment ne se passera pas comme prévu. Mais rien dans les rebondissements convenus n’est vraiment surprenant.
Il y a d’autre part un mélodrame familial qui met aux prises un frère et sa sœur cadette qui vont solder de vieux contentieux. Plus le film avance plus le personnage d’Estrella prend une dimension inattendue, au point pour Bárbara Lennie de voler la vedette au pourtant excellent Antonio de la Torre (El Reino, Compañeros, Une vie secrète…).