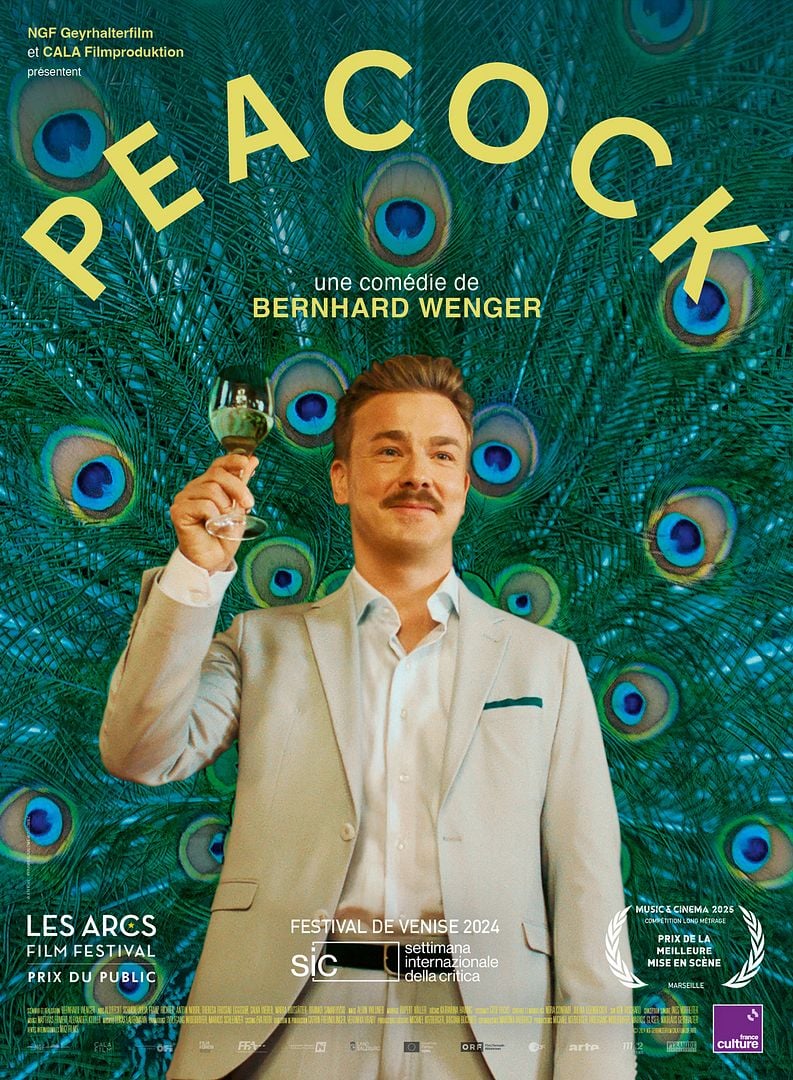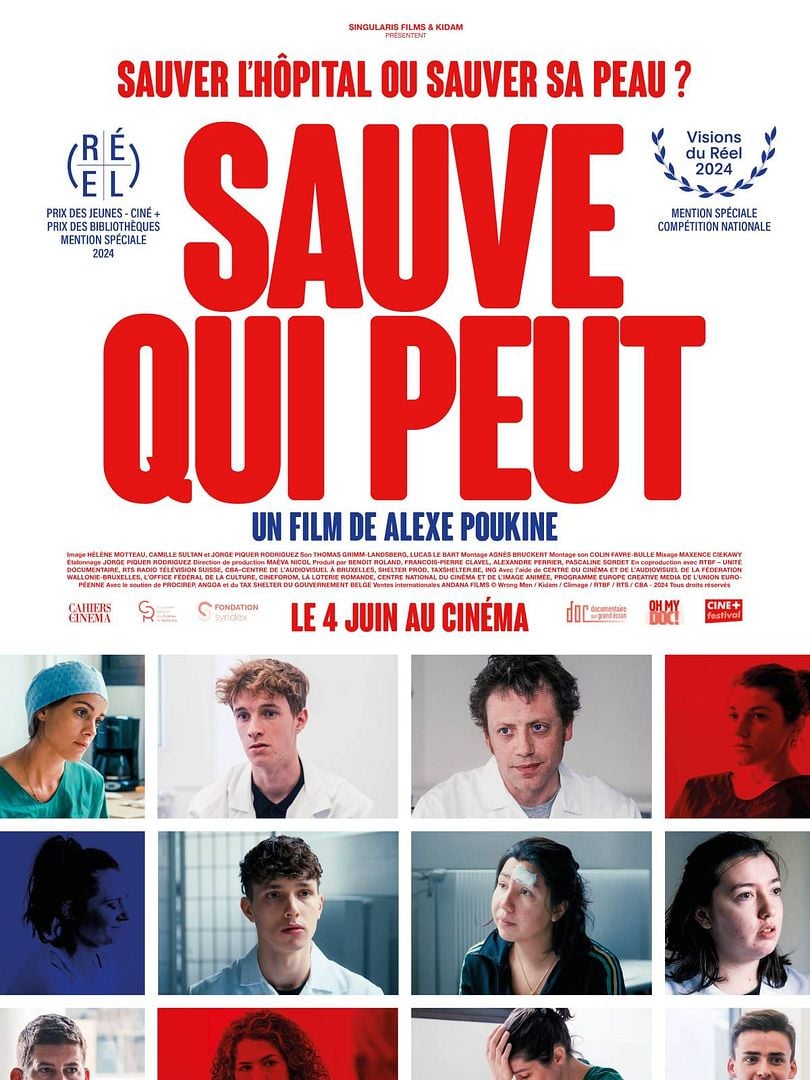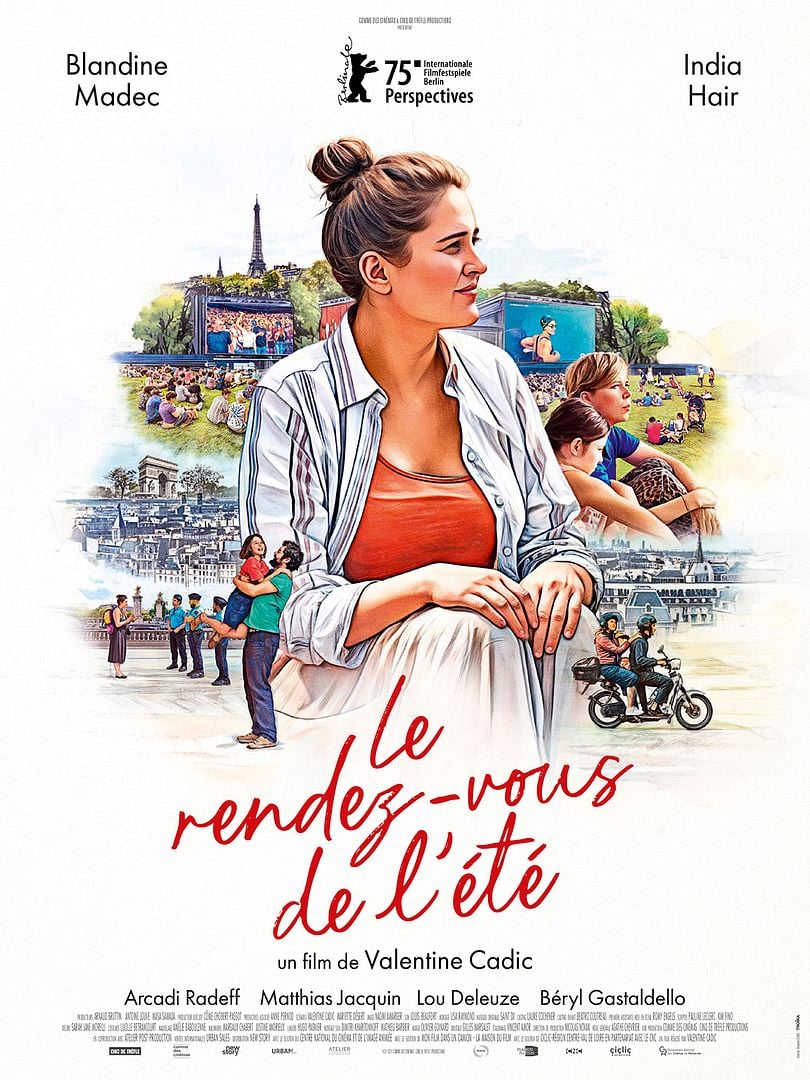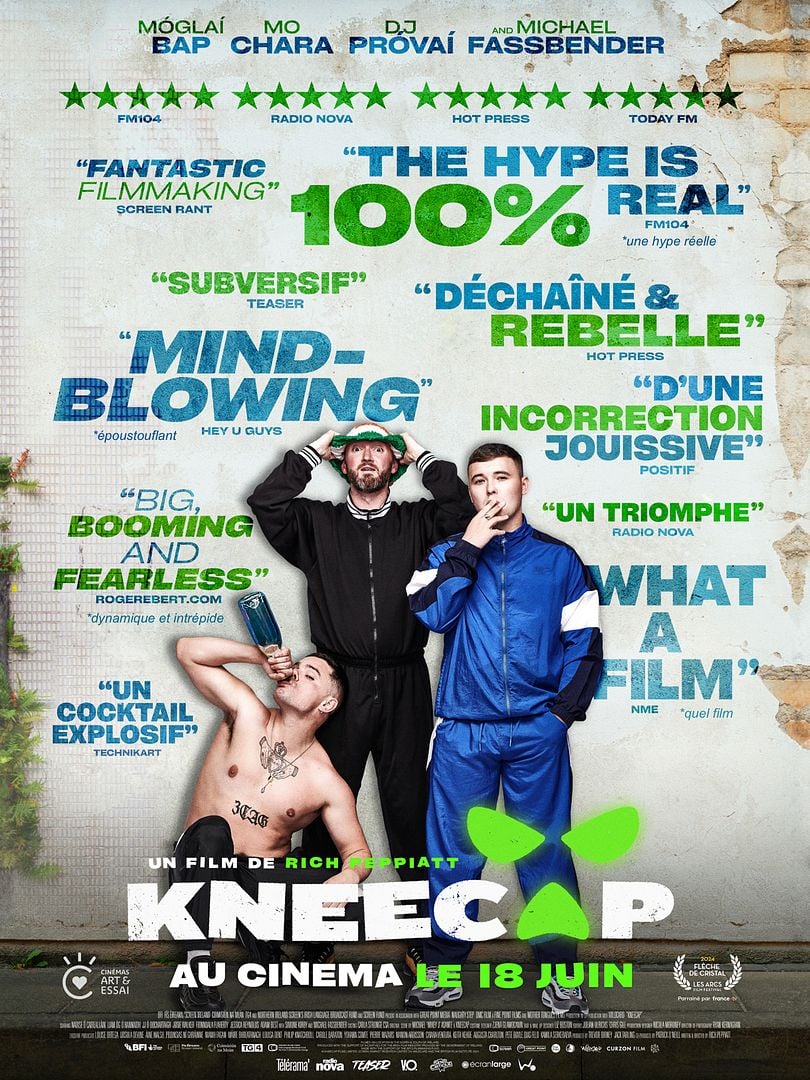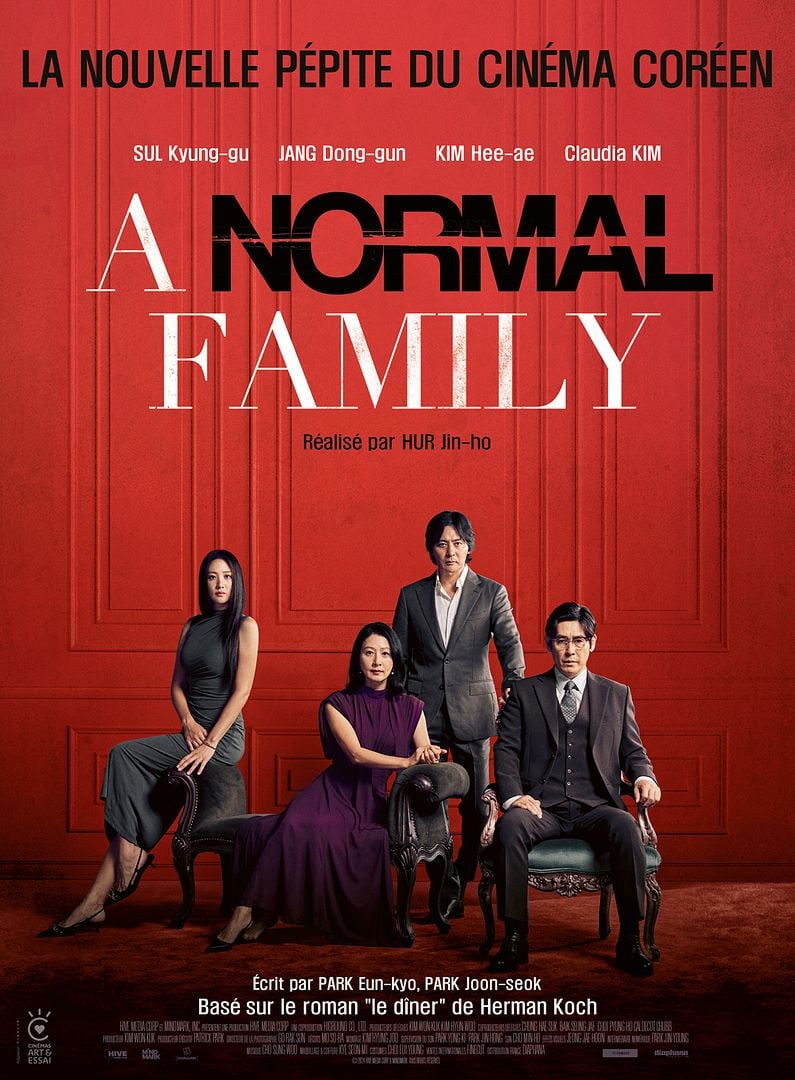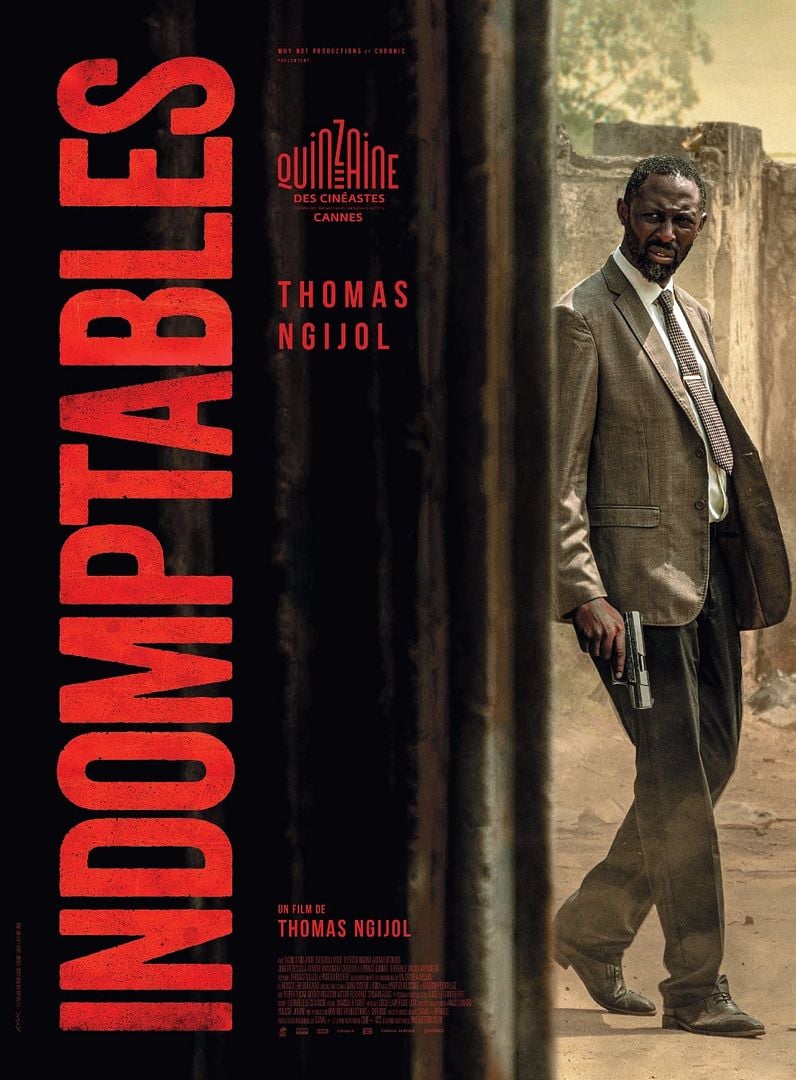Ce film d’animation est l’adaptation du roman bien connu d’Amélie Nothomb, la célèbre écrivaine belge, qui y raconte sa petite enfance au Japon.
Le roman sorti en 2000 passait pour inadaptable. Car, comme son titre intimidant et passablement incompréhensible l’annonçait, il racontait une histoire difficile à mettre en image : l’égocentrisme radical et le sentiment d’omnipotence du nourrisson.
Le film co-réalisé par Maïlys Vallade et Lione-cho Han, produit par mon ami Henri Magalon, y parvient pourtant admirablement dans ses premières minutes. Les suivantes nous plongent dans un cadre édénique, une sorte de paradis perdu qui servira d’écrin aux premières années de la vie de la jeune Fabienne – qui prendra Amélie comme (pré) nom de plume : le Japon du Kansaï où son père était à l’époque consul général de Belgique.
Tout se passe autour de la maison des Nothomb : le père, diplomate donc, la mère, pianiste, le frère aîné, André, qui martyrise sa benjamine, et la sœur aînée, Juliette. La maison compte un membre de plus : la nounou, Nishio san, avec laquelle l’enfant développera une relation symbiotique qu’elle évoquera dans plusieurs de ses livres. Pour corser cet environnement un peu fade, les scénaristes ont inventé un autre personnage secondaire, dont je ne suis plus sûr qu’il figurât dans le roman : celui de la propriétaire, veuve de guerre inconsolée et xénophobe sur le chemin de la rédemption.
Projeté en sélection officielle (hors compétition) au festival de Cannes, grand prix du jury au festival d’Annecy, Amélie et la métaphysique des tubes possède deux atouts qui enthousiasmeront petits et grands : une animation féérique, haute en couleurs, et une musique spécialement composée pour l’occasion par Mari Fukuhara, qui fusionne les sonorités asiatiques et occidentales.