 Depuis près de quarante ans, Maguy Marin occupe une place bien à elle dans la danse contemporaine française. Formée à Bruxelles par Maurice Béjart, elle dirige le Centre chorégraphique national de Créteil puis de Lyon.
Depuis près de quarante ans, Maguy Marin occupe une place bien à elle dans la danse contemporaine française. Formée à Bruxelles par Maurice Béjart, elle dirige le Centre chorégraphique national de Créteil puis de Lyon.
Son style s’inspire de la Tanztheater de Pina Bausch.
Fille d’immigrés espagnols, elle a sa vie durant pratiqué une forme d’art engagé. Sa danse est le reflet de son époque et le documentaire que lui consacre son fils Daniel Mambouch, né en 1981, qui a passé son enfance avec sa mère dans les coulisses des théâtres et qui joue désormais dans sa compagnie, est l’occasion de revisiter l’histoire contemporaine.
Il a pour fil directeur May B, une pièce pour dix interprètes grimés d’argile inspirée des textes de Samuel Beckett.
La danse est un art profondément cinématographique. Art visuel, art cinétique, la danse n’est jamais mieux représentée que par l’œil de la caméra. Aussi ne s’étonnera-t-on pas que de nombreux documentaires lui soient consacrés. Avant ou après sa mort, Pina Bausch en a eu son lot : Les Rêves dansants en 2010, Pina de Wim Wenders filmé en 3D en 2011. Le ballet de l’Opéra de Paris a eu aussi les siens : sous l’œil du grand documentariste américain Frederick Wiseman (La Danse, le ballet de l’Opéra de Paris en 2009) ou sous ceux de Thierry Demaizière et Alban Teurlai (Relève en 2017).
Le documentaire de Daniel Mambouch ne révolutionnera pas le genre. Son originalité tient à l’identité de son réalisateur et à son lien avec son sujet. Maguy Marin : l’urgence d’agir montre autant une chorégraphe qu’une femme. Il enchantera les amateurs de danse contemporaine. Il émouvra les fils et les mères.

 La propagande soviétique a longtemps fait du Donbass, une région minière située à l’est de l’Ukraine, une terre de cocagne. Ses travailleurs étaient des demi-dieux prolétariens. Stakhanov, qui en une nuit d’août 1935 abattit la tâche normale de sept de ses collègues, en devint le mythique porte-drapeau. Ils étaient les héros du film La Symphonie du Donbass réalisé en 1930 par Dziga Vertov.
La propagande soviétique a longtemps fait du Donbass, une région minière située à l’est de l’Ukraine, une terre de cocagne. Ses travailleurs étaient des demi-dieux prolétariens. Stakhanov, qui en une nuit d’août 1935 abattit la tâche normale de sept de ses collègues, en devint le mythique porte-drapeau. Ils étaient les héros du film La Symphonie du Donbass réalisé en 1930 par Dziga Vertov.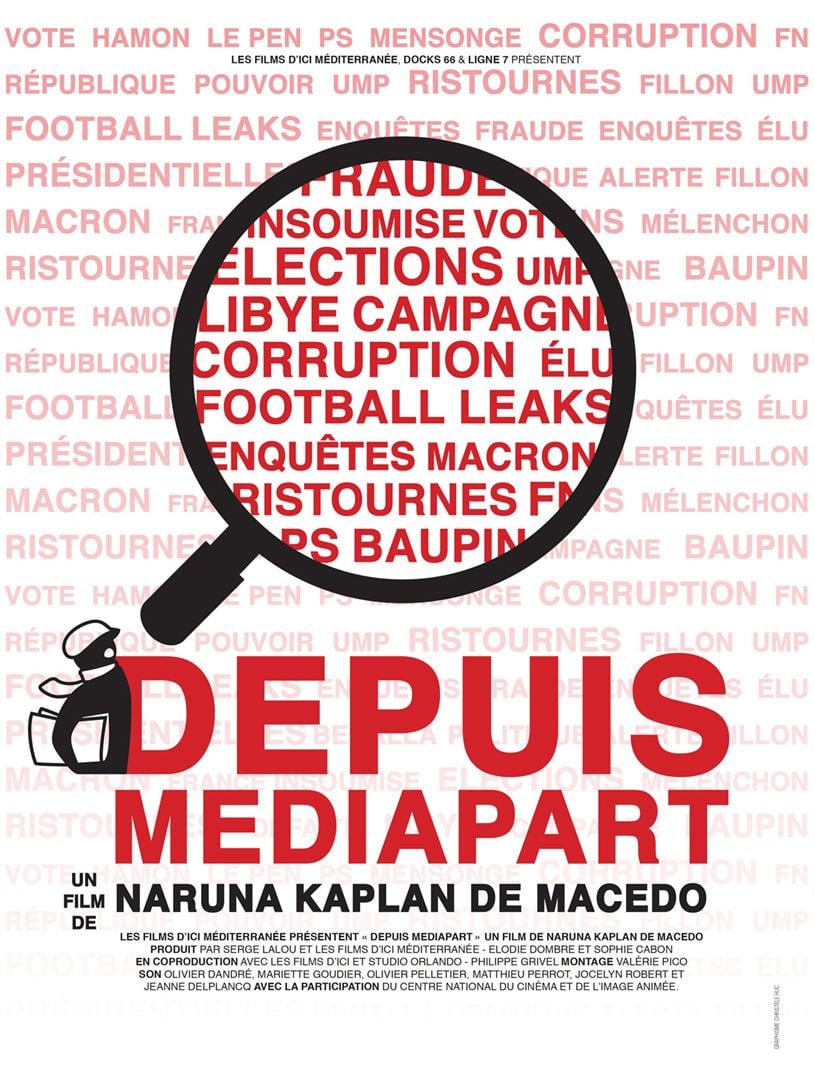 La documentariste Naruna Kaplan de Macedo a été embedded pendant un an dans la rédaction de Médiapart. Des centaines d’heures de rush qu’elle y a tournées, elle en a gardé avec sa monteuse cent minutes principalement consacrées à la campagne présidentielle de 2017 et à la victoire inattendue d’Emmanuel Macron.
La documentariste Naruna Kaplan de Macedo a été embedded pendant un an dans la rédaction de Médiapart. Des centaines d’heures de rush qu’elle y a tournées, elle en a gardé avec sa monteuse cent minutes principalement consacrées à la campagne présidentielle de 2017 et à la victoire inattendue d’Emmanuel Macron. Roman (Pio Marmaï) est dentiste à Paris. Il forme avec Camille (Céline Sallette) et leurs deux filles une famille unie. Mais Roman cache un lourd secret : il est cocaïnomane. Un jour, lorsque sa fille cadette prise de convulsion est hospitalisée, des analyses révèlent la présence de cocaïne dans ses urines. Le résultat des tests capillaires ne lui permet plus de se dérober.
Roman (Pio Marmaï) est dentiste à Paris. Il forme avec Camille (Céline Sallette) et leurs deux filles une famille unie. Mais Roman cache un lourd secret : il est cocaïnomane. Un jour, lorsque sa fille cadette prise de convulsion est hospitalisée, des analyses révèlent la présence de cocaïne dans ses urines. Le résultat des tests capillaires ne lui permet plus de se dérober.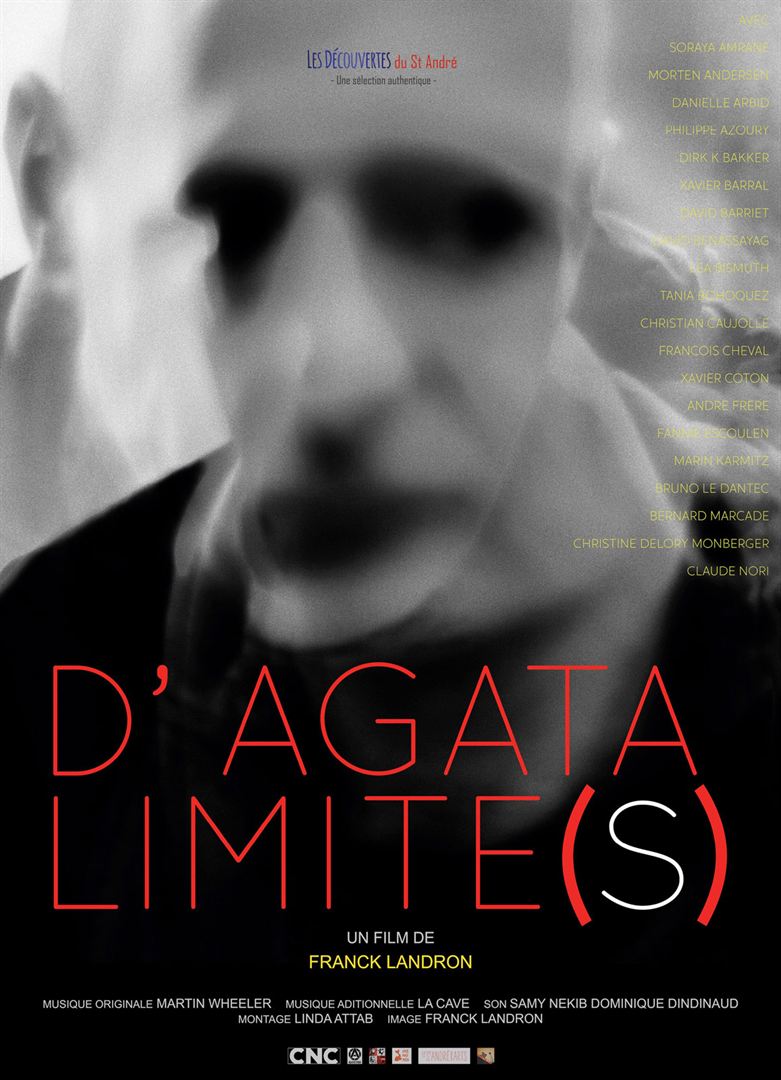 Originaire de Marseille, Antoine d’Agata est un des photographes les plus radicaux et les plus célèbres de sa génération. Franck Landron le suit dans ses voyages, en France et en Thaïlande, et interroge une œuvre qui repousse les limites.
Originaire de Marseille, Antoine d’Agata est un des photographes les plus radicaux et les plus célèbres de sa génération. Franck Landron le suit dans ses voyages, en France et en Thaïlande, et interroge une œuvre qui repousse les limites. Sofia et Paul sont de gauche. Résolument. Lui est un vieux punk anarchiste, batteur dans un groupe dont la célébrité se résume à un clip sobrement intitulé « J’encule le pape ». Elle est une jeune beurette de banlieue qui, à force de travail, est parvenue à intégrer un brillant cabinet parisien d’avocats.
Sofia et Paul sont de gauche. Résolument. Lui est un vieux punk anarchiste, batteur dans un groupe dont la célébrité se résume à un clip sobrement intitulé « J’encule le pape ». Elle est une jeune beurette de banlieue qui, à force de travail, est parvenue à intégrer un brillant cabinet parisien d’avocats. À Los Angeles, au milieu des années quatre-vingt-dix, Stevie, treize ans, n’est plus tout à fait un enfant, pas encore un adolescent. Coincé entre une mère célibataire et un grand frère violent, il se rapproche d’une bande de quatre skateurs : Ray, grand frère de substitution, Fuckshit, bogosse et déconneur, Ruben, enfant battu, et Fourth Grade, l’œil vissé derrière sa caméra vidéo.
À Los Angeles, au milieu des années quatre-vingt-dix, Stevie, treize ans, n’est plus tout à fait un enfant, pas encore un adolescent. Coincé entre une mère célibataire et un grand frère violent, il se rapproche d’une bande de quatre skateurs : Ray, grand frère de substitution, Fuckshit, bogosse et déconneur, Ruben, enfant battu, et Fourth Grade, l’œil vissé derrière sa caméra vidéo. Raoul Taburin (Benoît Poelvoorde) est réparateur de vélos à Saint-Céron. Il est si doué dans son travail qu’on ne dit plus un vélo mais un « taburin ». Mais, depuis sa prime enfance, il cache un inavouable secret : il ne sait pas monter à vélo. Il a réussi à le dissimuler à son père (Grégory Gadebois), à une première fiancée puis à Madeleine (Aurore Clément).
Raoul Taburin (Benoît Poelvoorde) est réparateur de vélos à Saint-Céron. Il est si doué dans son travail qu’on ne dit plus un vélo mais un « taburin ». Mais, depuis sa prime enfance, il cache un inavouable secret : il ne sait pas monter à vélo. Il a réussi à le dissimuler à son père (Grégory Gadebois), à une première fiancée puis à Madeleine (Aurore Clément). Robert et Elena sont frère et sœur. Elena prépare son bac de philosophie. Dans la campagne, à deux pas d’une station service, au bord d’une route déserte, les adolescents révisent.
Robert et Elena sont frère et sœur. Elena prépare son bac de philosophie. Dans la campagne, à deux pas d’une station service, au bord d’une route déserte, les adolescents révisent. Vincent (Guillaume Gouix, incroyable de rage rentrée) a trente ans. Il n’a guère connu que la prison où il a été incarcéré après une adolescence violente et d’où il vient d’être libéré après avoir purgé une peine de douze ans. Sans formation, sans travail, sans argent, il n’a d’autre solution que de demander à sa sœur cadette de l’héberger.
Vincent (Guillaume Gouix, incroyable de rage rentrée) a trente ans. Il n’a guère connu que la prison où il a été incarcéré après une adolescence violente et d’où il vient d’être libéré après avoir purgé une peine de douze ans. Sans formation, sans travail, sans argent, il n’a d’autre solution que de demander à sa sœur cadette de l’héberger.