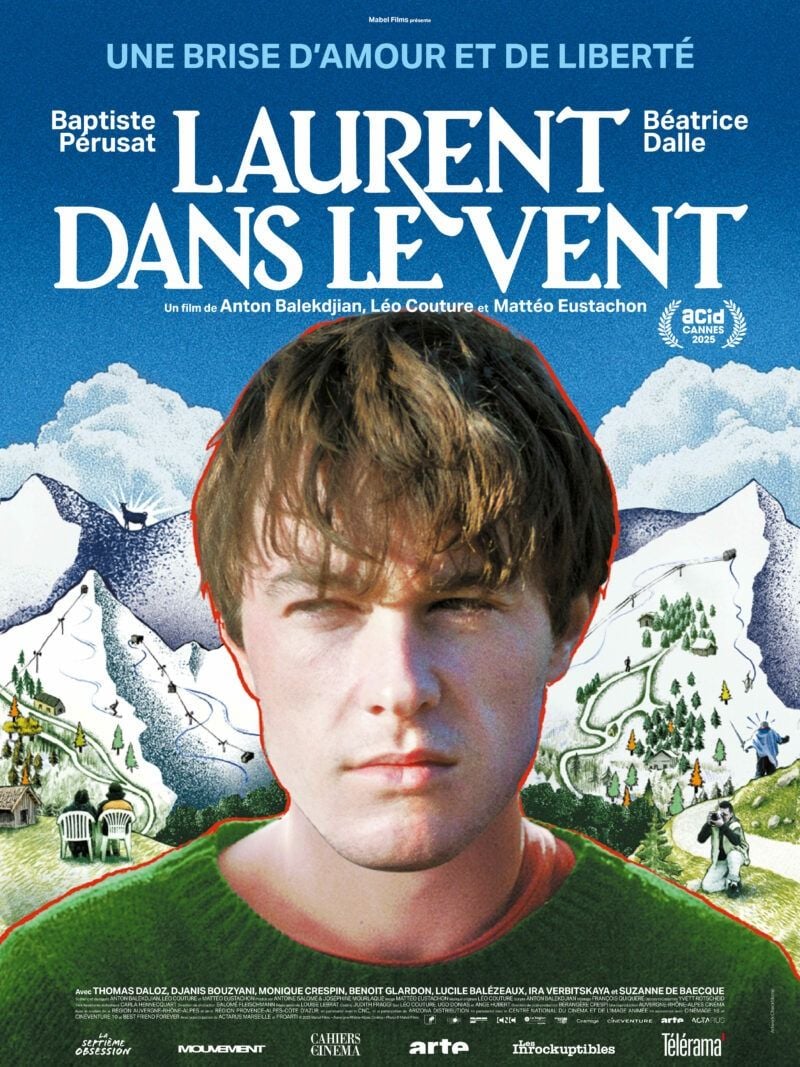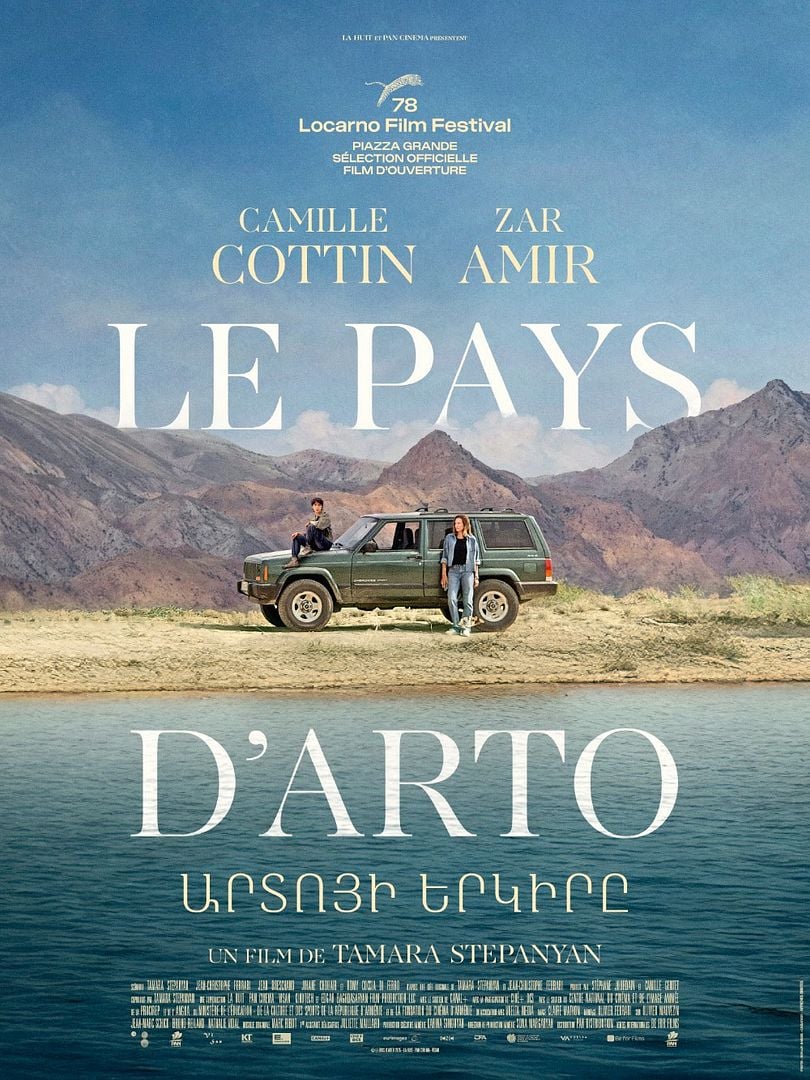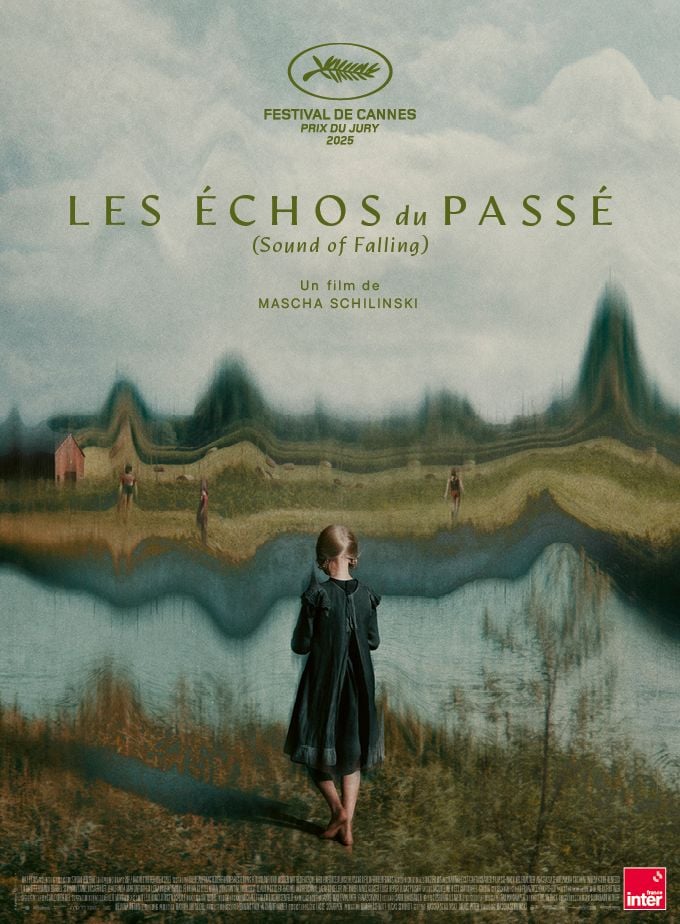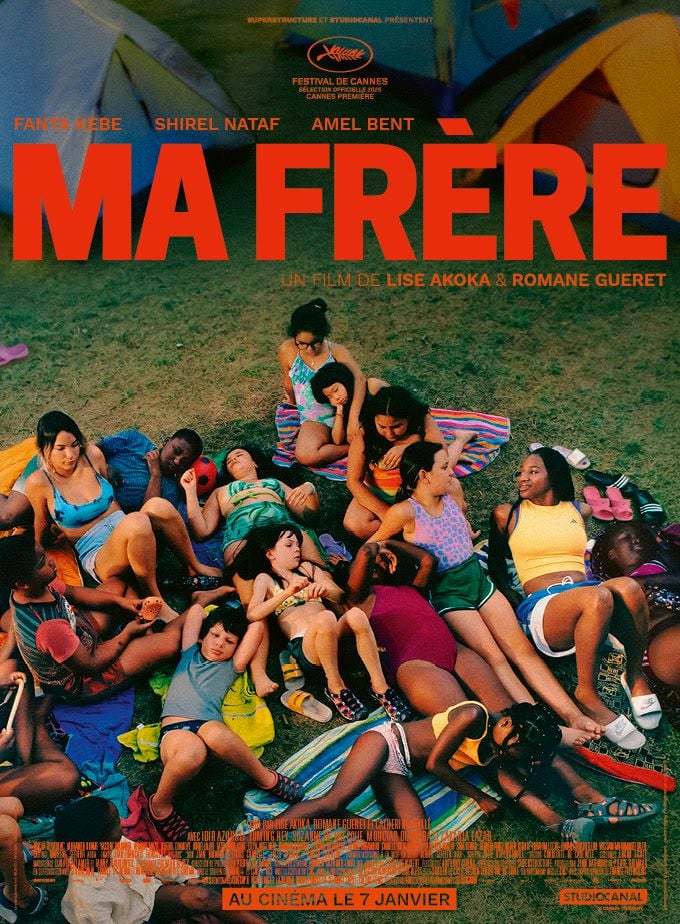Né en 1912 en Pologne, Ceslaw Bojarski, diplômé de l’Ecole polytechnique de Lwów (Lviv en Ukraine aujourd’hui), est officier de l’armée polonaise pendant la Seconde Guerre mondiale. Il est fait prisonnier par les Allemands, s’évade et se réfugie en France. Après guerre, il devient faux monnayeur d’abord pour le compte d’un gang de voyous puis, après son démantèlement, à son propre compte. Il contrefait d’abord des billets de mille ensuite de cinq mille francs enfin, en 1960, avec le passage au nouveau franc, des coupures Bonaparte de cent francs. Ces falsifications font l’admiration des experts de la Banque de France qui peinent à les détecter et qui ont longtemps pensé qu’ils étaient l’œuvre d’une puissante organisation criminelle.
Jean-Paul Salomé, vieux routier du cinéma français (Belphégor, le fantôme du Louvre, La Daronne, La Syndicaliste…) utilise un croustillant fait divers. L’histoire de ce faux-monnayeur de génie qui, pendant plus de dix ans, a fabriqué des faux billets et déjoué toutes les polices de France constituait en effet un fantastique matériau. Le film le montre, dans l’atelier qu’il s’était construit, rassembler l’équipement nécessaire, procéder à des essais longtemps infructueux et, à force de patience, atteindre un résultat quasi-parfait.
Pour pimenter son sujet, le scénario adjoint à Bojarski trois personnages secondaires qui éclairent chacun à leur façon des facettes du héros. Le premier est la femme de Bojarski, Suzanne (Sara Giraudeau) à laquelle Bojarski a longtemps caché ses activités clandestines, lui faisant croire que ses rentrées de fonds étaient le fruit de ses brevets. Le deuxième est le commissaire de police Mattéi (Bastien Bouillon) qui, pendant plus de dix ans, a obsessionnellement traqué Bojarski. Le troisième est un ami polonais de régiment (Pierre Lottin).
Reda Kateb porte à bout de bras le film. Il est, comme toujours, parfait. Je lui ferais toutefois un reproche. Le film veut peindre un criminel génial, un « Cézanne de la fausse monnaie » qui s’est livré à son activité non seulement par appât du gain mais aussi par amour de l’art et par orgueil, mettant au défi les experts de différencier ses billets des vrais et la police de l’arrêter. Cet hubris explose dans la scène qui confronte Bojarski au commissaire Mattéi à Vichy, sans doute la meilleure du film.
Mais si le taiseux Reda Kateb, au jeu tout intérieur, est particulièrement convaincant pour donner à voir la froide méticulosité et la maîtrise que Bojarski déploie pour passer inaperçu, il n’a pas la flamboyance de l’escroc de génie que nous vend le scénario. Un Romain Duris, un Raphaël Quénard, un Pierre Niney auraient été plus incandescents dans ce rôle.