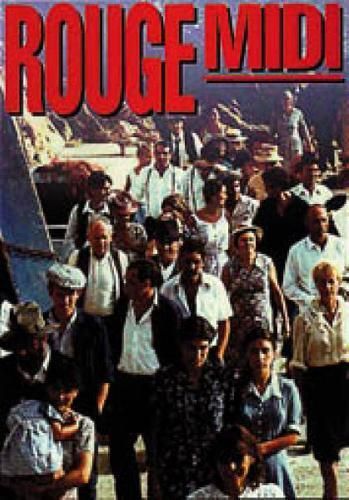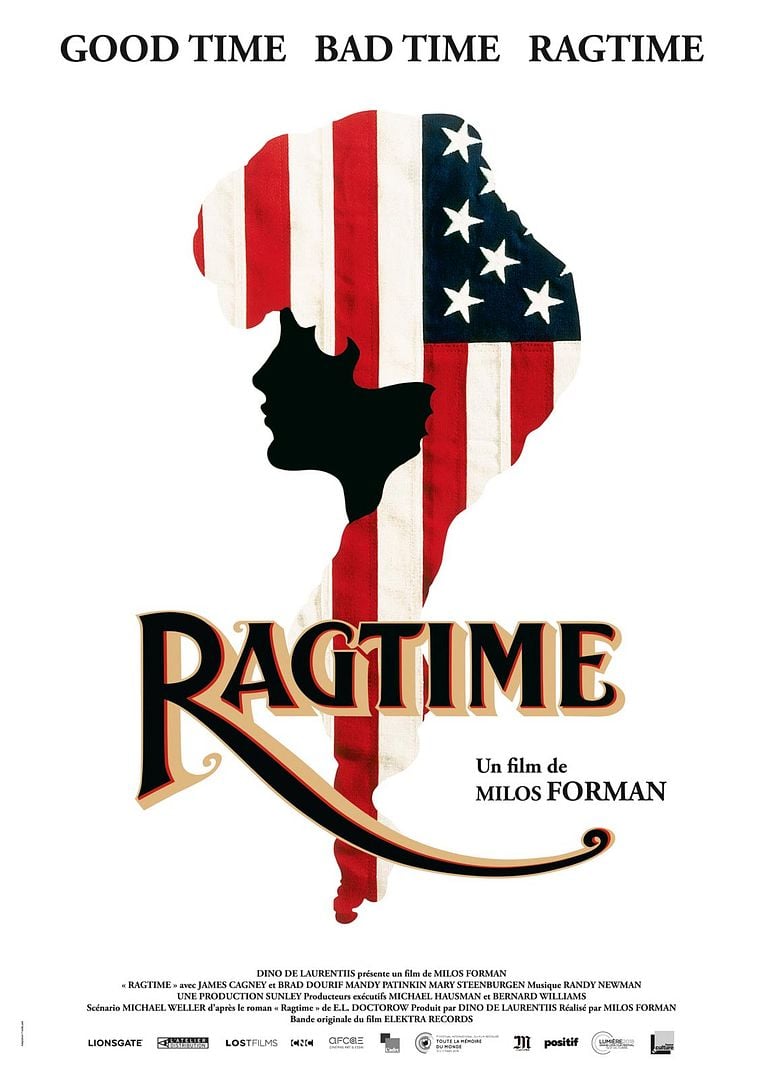 Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.
Une famille bourgeoise de New Rochelle, dans l’Etat de New York, au tout début du vingtième siècle, dont l’un des membres s’est amouraché d’une midinette, découvre dans son jardin un bébé noir abandonné. Le père du bébé, Coalhouse Walker Jr., un pianiste de ragtime, revient bientôt le chercher. Mais la Ford-T qu’il conduit est bloquée près d’une caserne de pompiers et endommagée. Coalhouse ne se remet pas de cet affront. Il exige réparation et s’engage dans une folle spirale de violence qui le conduira, avec une bande de complices, à se retrancher dans la Pierpont Morgan Library et à menacer de la faire exploser si le chef des pompiers qui l’a insulté ne lui présente pas des excuses.
Le ragtime est d’abord une musique populaire, ancêtre du jazz, jouée par des musiciens afro-américains au tout début du XXème siècle. C’est aussi le titre d’un roman historique écrit en 1975 par Edgar Lawrence Doctorow. Ce livre foisonnant entrelace plusieurs histoires, la principale étant celle de ce pianiste noir qui, comme le Michael Kohlhaas de Kleist veut que justice lui soit rendue, quel qu’en soit le prix. C’est bien le fil principal que finit par suivre le film, foisonnant lui aussi (il dure deux heures et trente cinq minutes) de Forman. Mais auparavant, il en avait tiré d’autres et nous avait entraîné sur de fausses pistes. En effet, plus que le livre, il donne une grande place au personnage d’Evelyn Nesbit dont le mari, à moitié fou, avait assassiné l’architecte Stanford White auquel il reprochait d’avoir eu une relation alors que sa femme était âgée de seize ans à peine.
Milos Forman ne lésine pas sur les moyens pour reconstituer luxueusement le New York de la Belle Époque, ses avenues grouillantes où les premières automobiles se faufilent au milieu des fiacres, ses bals endiablés où l’alcool coule à flot au son du ragtime des orchestres noirs. Il nous introduit à une galerie de personnages hauts en couleurs, le plus attachant n’étant pas hélas, le héros Coalhouse Walker Jr., mais plutôt la charmante Evelyn que l’histoire hélas délaisse en chemin.
On aurait aimé que le film garde sa structure chorale et continue, comme il l’avait fait dans sa première moitié, à nous balader d’un personnage à l’autre, d’une histoire à l’autre. Mais il fait le choix de se focaliser sur une seule histoire et sur le long siège de la Morgan Library par les forces de police dirigées par Rhinelander Walod qu’interprète dans son tout dernier rôle, à quatre-vingts ans passés, le légendaire James Cagney.



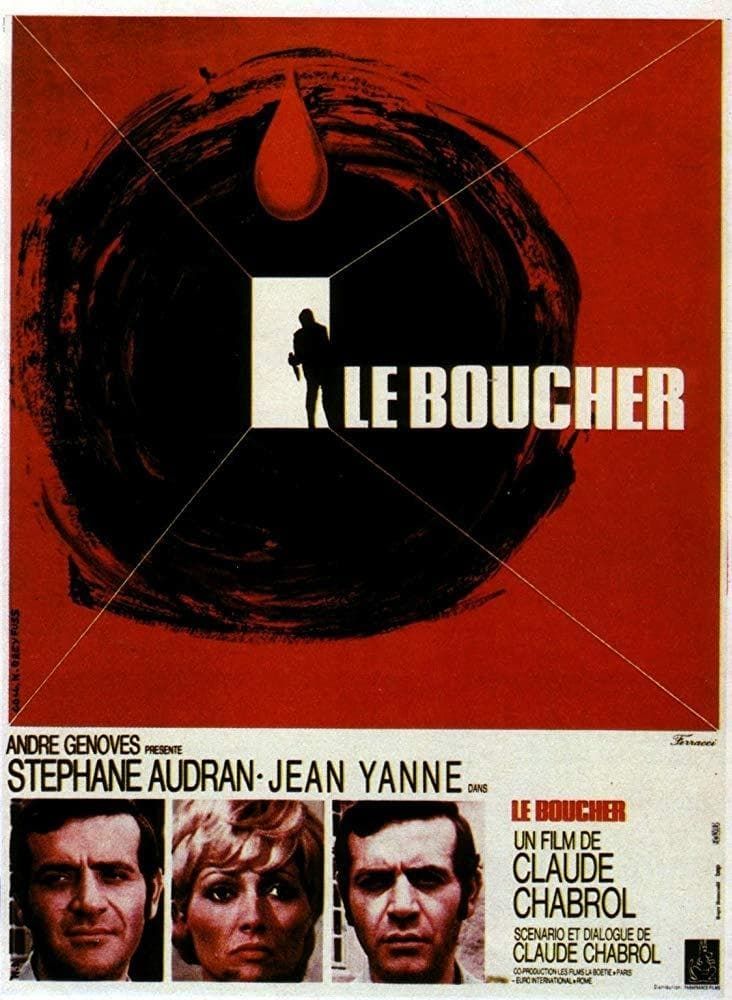 Dans une petite commune du Périgord, une romance se noue, malgré leur différence de classe, entre la directrice de l’école, l’élégante Hélène Davile (Stéphane Audran), et le boucher, Paul Thomas dit Popaul (Jean Yanne). Ils partagent des confidences : Hélène lui dit qu’elle tente d’oublier une rupture douloureuse, Popaul qu’il s’est engagé dans l’armée et a combattu en Indochine et en Algérie pour fuir un père violent.
Dans une petite commune du Périgord, une romance se noue, malgré leur différence de classe, entre la directrice de l’école, l’élégante Hélène Davile (Stéphane Audran), et le boucher, Paul Thomas dit Popaul (Jean Yanne). Ils partagent des confidences : Hélène lui dit qu’elle tente d’oublier une rupture douloureuse, Popaul qu’il s’est engagé dans l’armée et a combattu en Indochine et en Algérie pour fuir un père violent.
 Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.
Jill (Brigitte Bardot) est une jeune fille genevoise de bonne famille qui monte à Paris et y devient une star de cinéma. Amoureuse de Fabio (Marcello Mastroianni), elle l’accompagne à Spolète en Italie où il monte une pièce méconnue de Kleist. Mais la vie du couple est rendue impossible par la foule des paparazzis qui harcèlent Jill.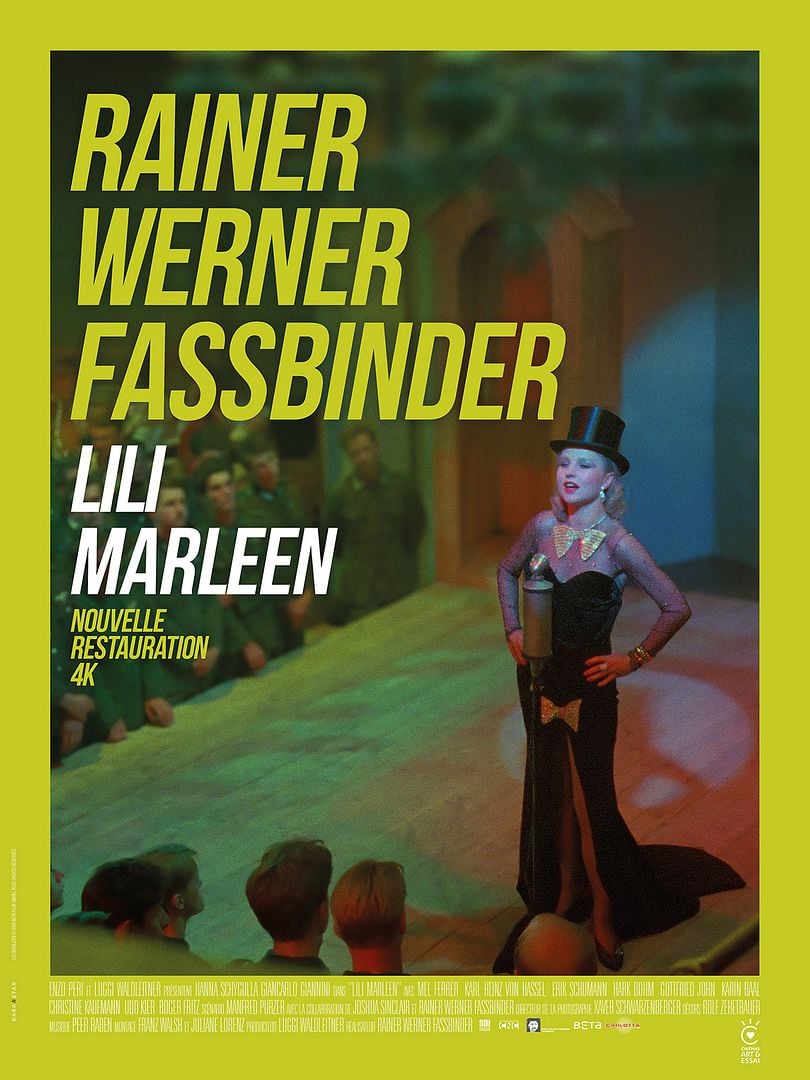
 À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite.
À l’occasion de vacances chez des amis au Nouveau-Mexique, le romancier à succès Richard Harland (Cornel Wilde) rencontre Ellen Berrent (Gene Tierney) et en tombe immédiatement amoureux. La jeune femme rompt ses fiançailles pour épouser Richard mais se révèle vite d’une jalousie maladive. En particulier elle supporte mal l’attention que son mari porte à Danny, son jeune frère frappé par la poliomyélite. Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.
Le baron Ferdinando Cefalù (Marcello Mastroianni) n’est pas heureux en mariage avec Rosalia (Daniela Rocca), une matrone hommasse. Il n’a d’yeux que pour sa jeune cousine, la virginale Angela (Stefania Sandrelli). Mais, dans l’Italie de l’époque, le divorce lui est interdit. Pour épouser Angela, il conçoit un plan machiavélique : pousser Rosalia dans les bras d’un autre homme, surprendre le couple adultère, tuer l’amant et n’écoper que d’une peine légère au titre d’un crime d’honneur.