 Après un vol intercontinental en classe affaires, agrémenté d’un passage aux toilettes, l’héroïne anonyme (Noémie Merlant) atterrit à Hong-Kong. Elle y loge dans un palace dont elle doit évaluer la qualité des prestations dans le but bientôt révélé d’en licencier la directrice (Naomi Watts).
Après un vol intercontinental en classe affaires, agrémenté d’un passage aux toilettes, l’héroïne anonyme (Noémie Merlant) atterrit à Hong-Kong. Elle y loge dans un palace dont elle doit évaluer la qualité des prestations dans le but bientôt révélé d’en licencier la directrice (Naomi Watts).
Un Emmanuelle 2024 ? Soixante ans après la publication du roman d’Emmanuelle Arsan qui fit scandale et surtout cinquante après l’incroyable succès du film de Justin Jaeckin qui attira près de dix millions de spectateurs en salles et dont la légende affirme qu’il resta treize ans à l’affiche sur les Champs-Elysées ? Voilà un pari bien risqué. Mais un pari alléchant quand on voit le trio féminin et féministe qui l’a relevé. Audrey Diwan à la réalisation, auréolée du succès, ô combien mérité, de son précédent film, L’Evénément, Lion d’or à Venise en 2021, l’adaptation glaçante du roman autobiographique d’Annie Ernaux qui y racontait son avortement clandestin au début des années soixante à Rouen. Rebecca Zlotowski pour l’épauler au scénario, l’intello du cinéma français (Normale Sup, agrégation, Fémis), dont les films (Belle Épine, Une fille facile, Les Enfants des autres) peuvent se lire comme un projet de déconstruction des représentations genrées. Et enfin Noémie Merlant, la star qui, depuis son second rôle dans Portrait de la jeune fille en feu, enflamme tout sur son passage.
Emmanuelle 2024 courait le risque de décevoir tout le monde. Les vieux messieurs libidineux qui, comme moi, seraient allés le voir en espérant à tort y retrouver les émotions érotiques ressenties une cinquantaine d’années plus tôt. Et les jeunes Femen scandalisées par la réhabilitation de cette figure honnie de femme-objet.
Avec 44.000 entrées en première semaine, il a fait un bide retentissant. J’aurais pourtant imaginé qu’il suscite, au moins en première semaine, la curiosité d’un public plus nombreux.
La raison en est tout simplement que c’est un film calamiteux. On dirait une longue pub pour un parfum de luxe, ou pour une compagnie aérienne extrême-orientale. À chaque plan, on se demande si Charlize Theron ne va pas surgir d’une piscine dorée ou si une hôtesse en talons hauts ne va pas nous tendre un oshibori.
Audrey Diwan fait du neuf avec du vieux et voudrait nous faire penser que les choses ont changé. L’Emmanuelle de 1974 était une épouse oisive. Celle de 2024 (mais s’appelle-t-elle seulement Emmanuelle ?) est une cost killeuse célibataire. Sylvia Kristel évoluait à Bangkok, Noémie Merlant à Hong Kong, dans un hôtel dont elle ne franchit quasiment jamais les portes. La première était cornaquée par Alain Cuny ; la seconde court après un métis chinois, d’autant plus désirable qu’il se refuse obstinément à elle. Seul trait commun, tout bien considéré, entre les deux femmes : elles explorent leur sexualité à la recherche d’un impossible orgasme qu’elles finiront par atteindre dans un final explosif (spoiler !)
Je n’ai pas trouvé sensuelle le moins du monde l’esthétique léchée (sic) de ce film. Elle n’a suscité en moi aucun trouble. Aurais-je eu la même réaction si je l’avais vu à vingt ans, les hormones bouillonnantes ? En tout état de cause, hormones bouillonnantes ou pas, je n’y ai pas vu non plus une réflexion très stimulante sur la femme, son empowerment, son agency et la réappropriation de son plaisir.

 Iman vient d’obtenir une promotion dans l’appareil répressif iranien. Ce mari aimant, ce père dévoué va pouvoir offrir à sa femme Najmeh et à ses deux filles, l’aînée Rezvan étudiante et la cadette Sana encore lycéenne, de meilleures conditions de vie. Mais sa promotion fait désormais peser sur sa famille des obligations supplémentaires. Elle se doit d’être irréprochable alors que la mort brutale de Mahsa Amini, après son arrestation par la « police de la moralité » pour port du voile inapproprié jette la population iranienne à la rue au cri de « Femme, Vie, Liberté ».
Iman vient d’obtenir une promotion dans l’appareil répressif iranien. Ce mari aimant, ce père dévoué va pouvoir offrir à sa femme Najmeh et à ses deux filles, l’aînée Rezvan étudiante et la cadette Sana encore lycéenne, de meilleures conditions de vie. Mais sa promotion fait désormais peser sur sa famille des obligations supplémentaires. Elle se doit d’être irréprochable alors que la mort brutale de Mahsa Amini, après son arrestation par la « police de la moralité » pour port du voile inapproprié jette la population iranienne à la rue au cri de « Femme, Vie, Liberté ». Convaincu de l’innocence de son client, maître Jean Monier (Daniel Auteuil) accepte de défendre Nicolas Milik (Grégory Gadebois) accusé d’avoir assassiné sa femme. Après trois ans d’instruction, le procès commence….
Convaincu de l’innocence de son client, maître Jean Monier (Daniel Auteuil) accepte de défendre Nicolas Milik (Grégory Gadebois) accusé d’avoir assassiné sa femme. Après trois ans d’instruction, le procès commence…. Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion.
Trois femmes travaillent ensemble à l’hôpital et vivent des amours empêchées. Le mari de Prabha est parti travailler en Allemagne et n’a plus donné signe de vie depuis un an. Celui de Parvaty vient de mourir, la laissant sans domicile. La jeune Anu, elle, n’est pas mariée. Elle entretient une relation clandestine avec un jeune homme, Shiaz, malgré leur différence de religion. Amina, Djeneba et Zineb sont trois collégiennes inséparables malgré leurs différences. Amina est issue d’un milieu aisé qui accepte avec réticence ses fréquentations. Djeneba se rêve influenceuse. Zineb est harcelée par Zakaria, un ami de son frère. Les trois filles réussissent à piéger le garçon trop entreprenant. Mais la mise en ligne de leur vidéo met leur amitié en péril.
Amina, Djeneba et Zineb sont trois collégiennes inséparables malgré leurs différences. Amina est issue d’un milieu aisé qui accepte avec réticence ses fréquentations. Djeneba se rêve influenceuse. Zineb est harcelée par Zakaria, un ami de son frère. Les trois filles réussissent à piéger le garçon trop entreprenant. Mais la mise en ligne de leur vidéo met leur amitié en péril. L’action de Ni chaînes ni maîtres se déroule dans l’Isle de France, l’actuelle Île-Maurice en 1759. Eugène Larcenet (Benoît Magimel) y cultive avec son fils (Felix Lefebvre) la canne à sucre. Il emploie une colonie d’esclaves. Massamba alias Ciceron (Ibrahima Mbaye), un Wolof originaire du Sénégal, lui fait office de contremaître. Massamba rêve d’émancipation pour sa fille qui, elle, n’aspire qu’à s’enfuir vers une terre mythique où la légende raconte que les esclaves y sont affranchis. Lorsqu’elle réussit à prendre la fuite, Madame La Victoire (Camille Cottin), une chasseuse d’esclaves redoutable, se lance à sa poursuite. Pour protéger sa fille, Massamba n’a d’autre ressource que de s’enfuir à son tour pour devenir un « marron ».
L’action de Ni chaînes ni maîtres se déroule dans l’Isle de France, l’actuelle Île-Maurice en 1759. Eugène Larcenet (Benoît Magimel) y cultive avec son fils (Felix Lefebvre) la canne à sucre. Il emploie une colonie d’esclaves. Massamba alias Ciceron (Ibrahima Mbaye), un Wolof originaire du Sénégal, lui fait office de contremaître. Massamba rêve d’émancipation pour sa fille qui, elle, n’aspire qu’à s’enfuir vers une terre mythique où la légende raconte que les esclaves y sont affranchis. Lorsqu’elle réussit à prendre la fuite, Madame La Victoire (Camille Cottin), une chasseuse d’esclaves redoutable, se lance à sa poursuite. Pour protéger sa fille, Massamba n’a d’autre ressource que de s’enfuir à son tour pour devenir un « marron ».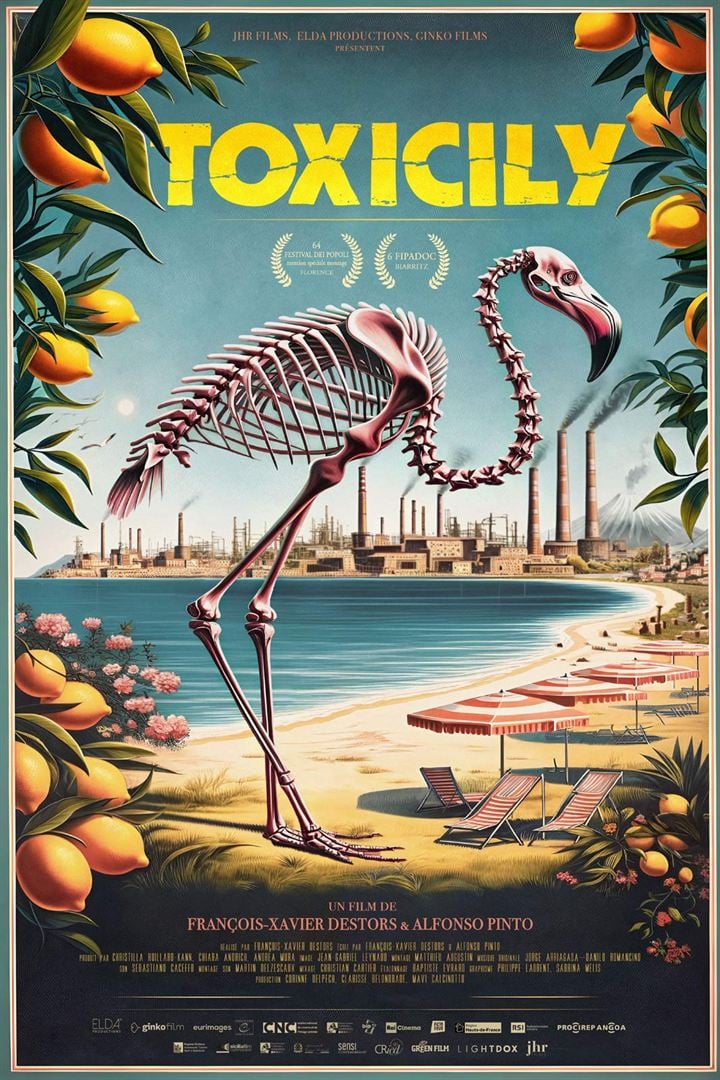
 Barberie Bichette (Agnès Jaoui), la cinquantaine bien (ou plutôt mal) entamée. Elle est poète, mais gâche son talent dans une agence de communication. Elle a connu de grandes histoires d’amour mais vit désormais séparée. Elle a eu deux enfants, Rose et Junior, mais ils ont quitté le nid et l’ont laissée seule.
Barberie Bichette (Agnès Jaoui), la cinquantaine bien (ou plutôt mal) entamée. Elle est poète, mais gâche son talent dans une agence de communication. Elle a connu de grandes histoires d’amour mais vit désormais séparée. Elle a eu deux enfants, Rose et Junior, mais ils ont quitté le nid et l’ont laissée seule. Un an après les attentats contre le World Trade Center, trois jeunes Suisses visitent l’Afghanistan.
Un an après les attentats contre le World Trade Center, trois jeunes Suisses visitent l’Afghanistan. Une équipe de télévision locale vient filmer un fait divers dans une ferme retirée des hauts plateaux tibétains. Un léopard des neiges a pénétré nuitamment dans un enclos et y a tué neuf béliers castrés. Le fermier, furieux, refuse de le relâcher, en violation de la législation sur les espèces protégées, et réclame de l’administration d’être indemnisé pour la perte de ses bêtes.
Une équipe de télévision locale vient filmer un fait divers dans une ferme retirée des hauts plateaux tibétains. Un léopard des neiges a pénétré nuitamment dans un enclos et y a tué neuf béliers castrés. Le fermier, furieux, refuse de le relâcher, en violation de la législation sur les espèces protégées, et réclame de l’administration d’être indemnisé pour la perte de ses bêtes.