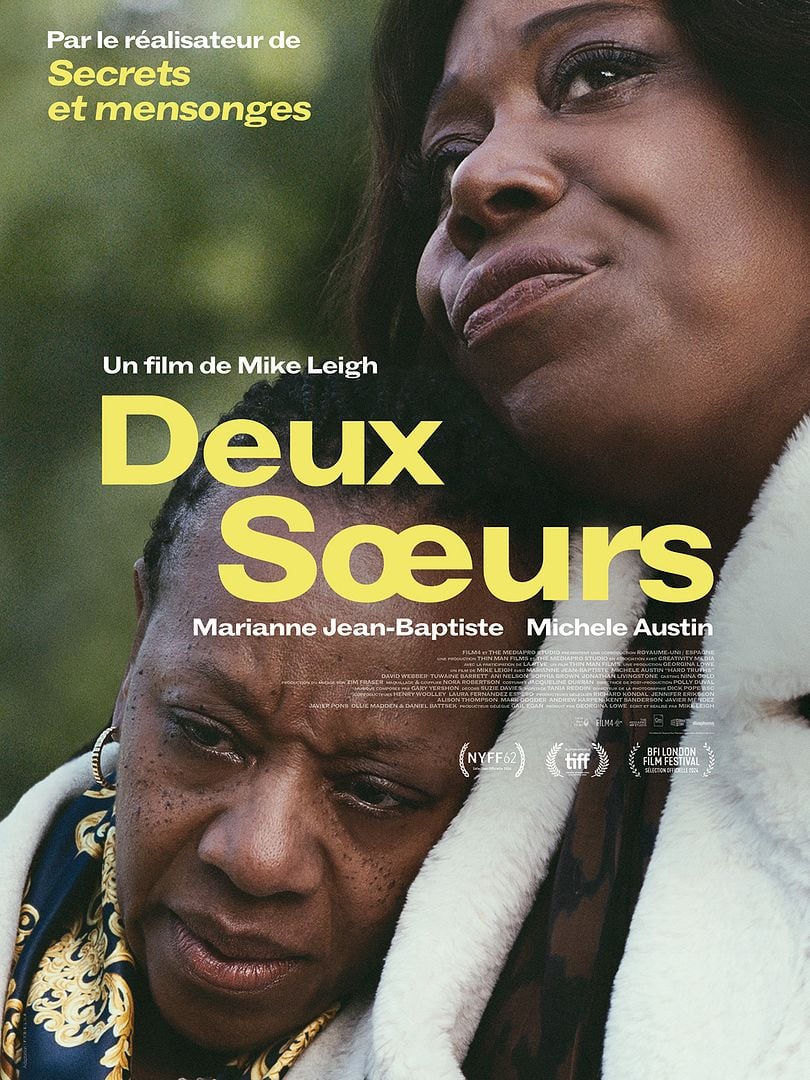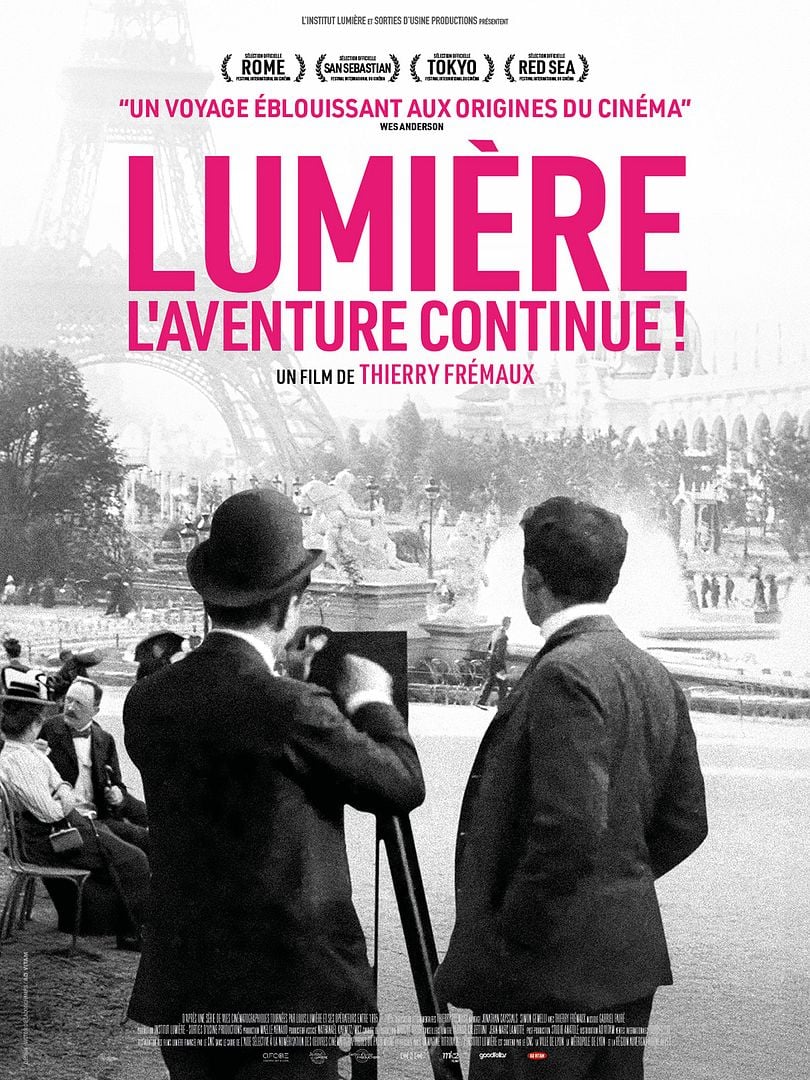Tardes de Soledad (littéralement : un après-midi de solitude) est un documentaire consacré au jeune matador péruvien Andrés Roca Rey. Le réalisateur Albert Serra l’a suivi pendant une tournée en Espagne. Sa caméra ne le quitte pas et le filme en plans serrés dans trois endroits exclusivement : sa chambre d’hôtel où il se prépare avec un soin maniaque, le minibus qui le conduit et le ramène de l’arène, et l’arène enfin face au taureau.
Albert Serra est un cinéaste excentrique dont l’œuvre ambitieuse étonne et détonne. Ses premiers films (Le Chant des oiseaux, La Mort de Louis XIV), terriblement exigeants, semblaient le condamner à une audience confidentielle. Mais il a élargi sa renommée avec Pacifiction, qui a valu à Benoît Magimel le césar du meilleur acteur.
Les partis-pris radicaux de ses films m’avaient radicalement déplu. J’avais détesté La Mort de Louis XIV et Pacifiction. Aussi ai-je bien failli faire l’impasse sur Tardes de Soledad, dont le sujet au surplus ne m’attirait guère. C’est la critique toute en finesse d’une amie – qui se reconnaîtra – qui m’a incité à le voir avec quelques semaine de retard.
Bien m’en a pris ! Car Tardes de Soledad est un film passionnant qui ne s’oublie pas de sitôt. Certes, c’est un film exigeant et ingrat, sans commentaires, sans voix off, sans interview qui permettraient de mieux comprendre ce qu’on nous donne à voir. Sa durée n’est guère comestible : il dure plus de deux heures et aurait pu fort bien être amputé d’un bon quart sans perdre en efficacité.
Mais il donne un point de vue unique sur la corrida. Un avertissement s’impose : Serra n’est pas pro- ou anti-. Son film n’est pas politique. Son objectif n’est pas partisan. Albert Serra est un cinéaste esthétisant. Ses films ressemblent à des peintures. Et le travail de son chef opérateur et de son monteur sont exceptionnels, qui nous donnent des images incroyables. Tout est filmé en plans serrés. Aucun plan large, aucune image de la foule dont on entend seulement le lointain murmure. La caméra se focalise sur le matador et sur le taureau qu’il affronte dans un combat à mort.
Pour autant, rien n’est jamais exclusivement esthétique. Tout est toujours, quoi qu’on en dise, politique. Tardes de Soledad nous montre le matador et l’équipe qui l’entoure. Il s’agit d’hommes exclusivement (on ne voit pas une seule femme pendant tout le film, sinon une admiratrice qui pose avec Andrés Roca pour un selfie crispé). Ils entretiennent leur chef dans une idéologie viriliste, vantant la grosseur de ses « c*uilles » à tout bout de champ, dénigrant à la fois le taureau qu’il affronte (on escomptait plus de respect pour l’adversaire) et le public hostile, qui n’a plus guère la cote à notre époque. S’ajoute à cette ambiance machiste un vieux fond de superstition qui s’exprime à travers une bimbeloterie d’images saintes et de gris-gris, pieusement baisées à chaque entrée en lice.
Tardes de Soledad est un film hypnotisant, dérangeant, désagréable. Un film à voir pour toutes ces (bonnes) raisons.