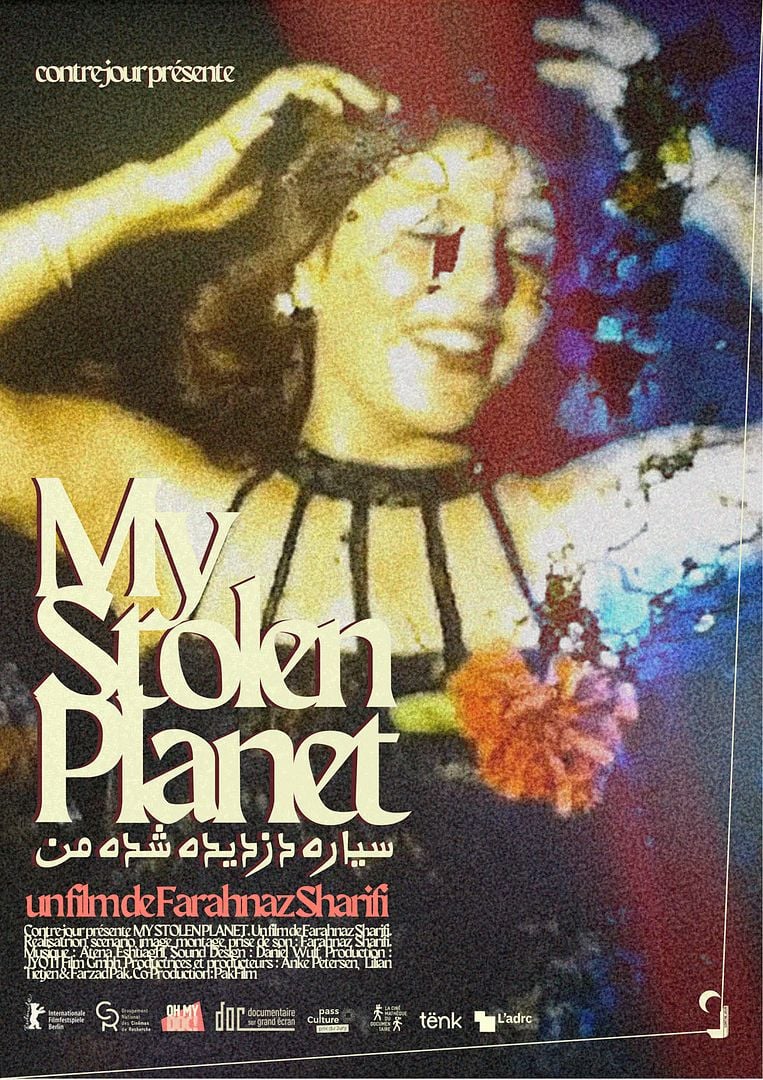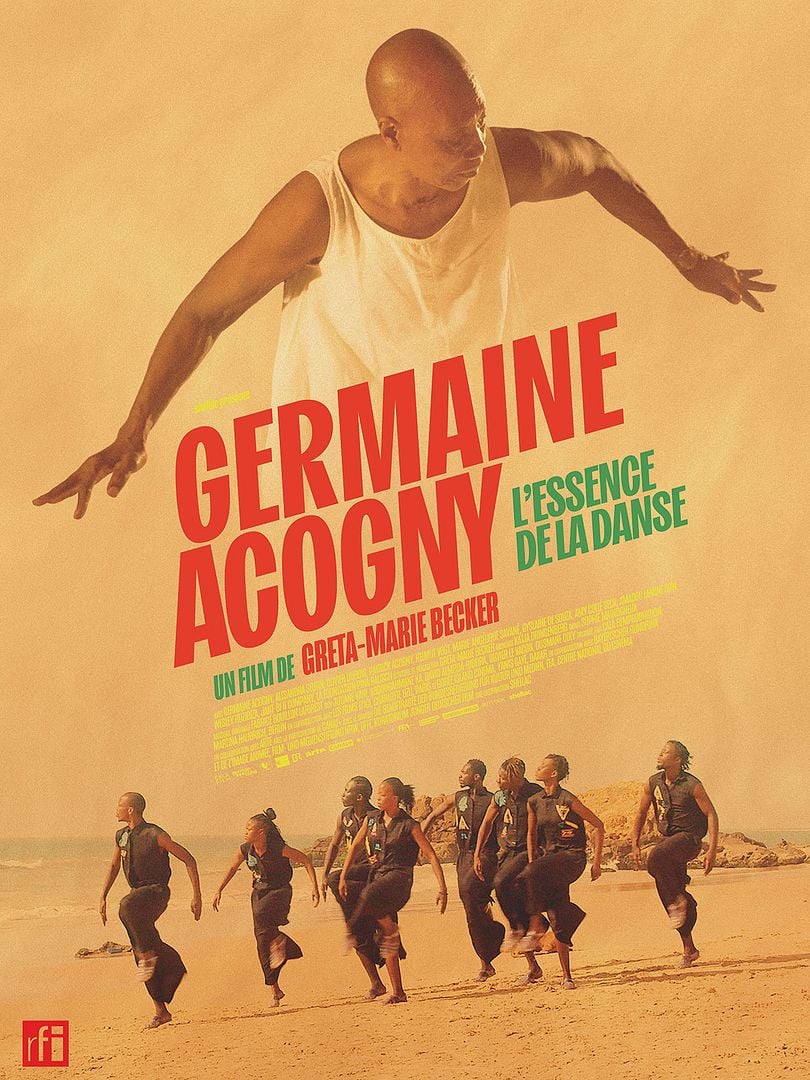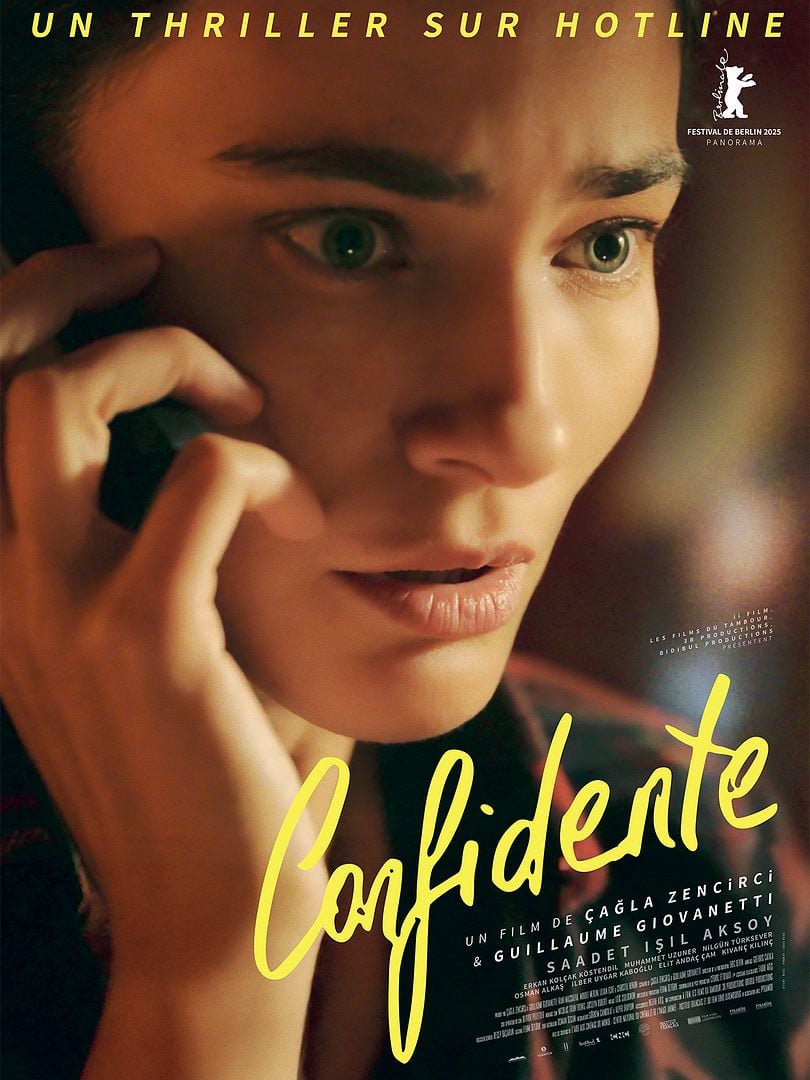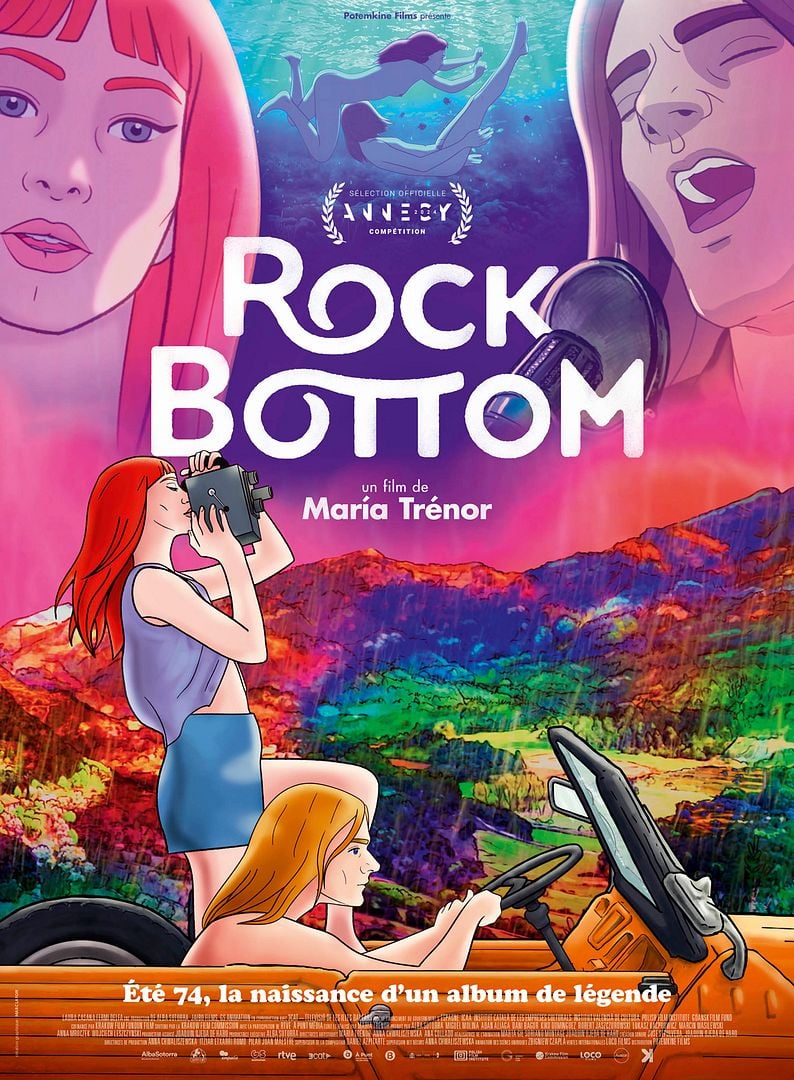:quality(50)/2025/08/11/valeur-sentimentale-affiche-6899a1438fb86438448998.jpg)
Gustav Borg (Stellan Skarsgård) est un grand réalisateur suédois au crépuscule de sa vie. Il revient à Oslo pour les funérailles de sa première femme et la vente de sa maison. C’est là qu’il a élevé ses deux filles avant de les quitter, les laissant à jamais frustrées de l’amour paternel. L’aînée Nora (Renate Reinsve) est devenue une actrice de théâtre renommée ; mais elle est dévorée par un trac maladif et traversée de pulsions suicidaires. La cadette Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), mariée et mère de famille, mène une vie plus équilibrée.
Nora refuse de tenir le rôle principal du prochain film de son père qui se tourne alors vers une star hollywoodienne Rachel Kemp (Elle Fanning).
Valeur sentimentale a raté de peu la Palme d’or à Cannes, décernée à un film iranien. Il en est reparti avec un prix de consolation et un bouche-à-oreille élogieux. La renommée de son auteur, de son actrice principale, prix d’interprétation féminine à Cannes en 2021, ajoutés à l’engouement saisonnier pour les films scandinaves (Loveable, la trilogie d’Oslo…) en faisaient un des films les plus attendus de l’été.
Je suis resté sur ma faim. Force est de reconnaître à Joachim Trier d’indéniables qualités. La principale est peut-être sa direction d’acteurs. Stellan Skarsgård, Renate Reinsve, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning y sont chacun à leur façon extraordinaires. Ils campent des personnages d’une grande complexité. Le père volage est étonnamment attachant ; les filles traumatisées (traumatisées par quoi au juste ?) ne se réduisent pas à une posture victimaire.
Ma déception a deux causes. La première vient du scénario et du montage. Bizarrement introduite par une voix off – dont on ne connaitra jamais l’identité – le récit se présente comme une saga dont la maison familiale constitue peut-être le personnage principal, avant de changer de direction et de se focaliser sur Gustav et ses filles. On perd même de vue en cours de route le partage de l’héritage de la mère, censé donner sa signification au titre du film, pour se concentrer sur la préparation du tournage de Gustav.
Plus grave à mes yeux : je n’ai rien ressenti. Je dois avouer, le rouge au front, que c’est aussi mon problème face aux grands films de Bergman. Ses longues scènes de ménage m’ont toujours laissé insensible. On a dit que Valeur sentimentale était un grand film bergmanien qui disséquait les traumas enfouis d’une famille. C’est sans doute un compliment. Mais hélas pour moi, cette qualité n’en est pas une.