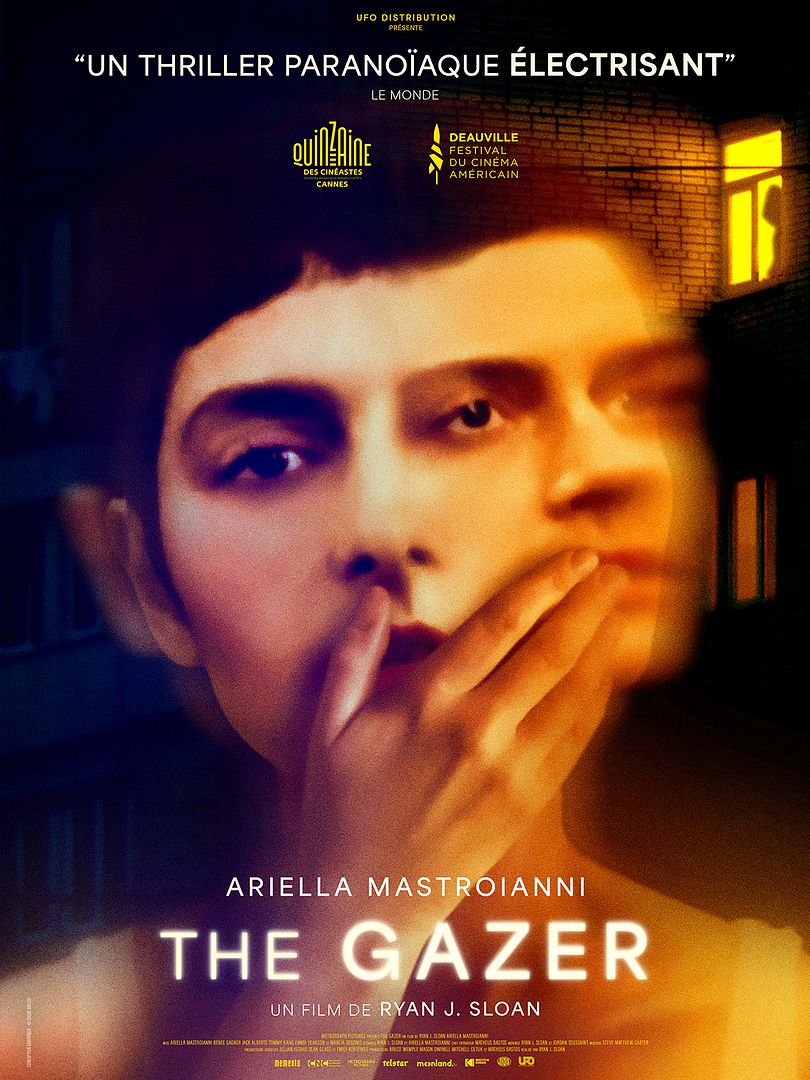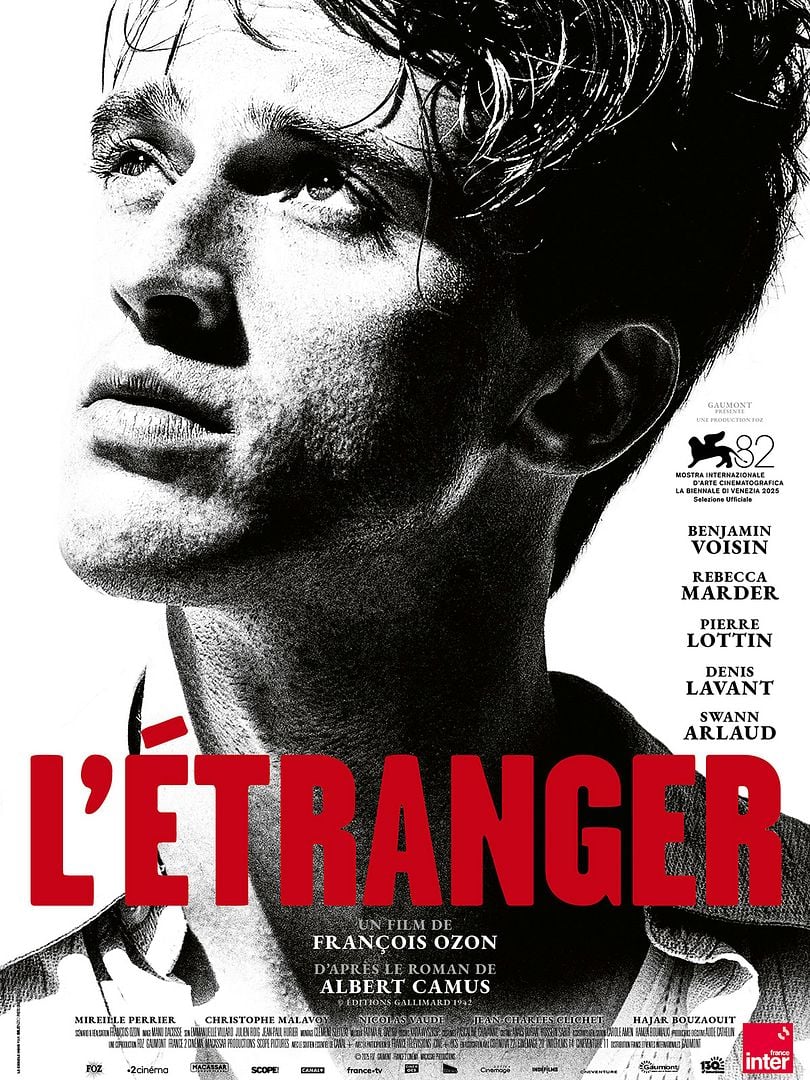En 1983, un concours d’architecture est lancé pour la construction du bâtiment destiné à clore la perspective royale qui part du Louvre vers l’ouest via l’Arc de triomphe. Un architecte inconnu l’emporte. Il est danois, a la cinquantaine bien entamée et n’a quasiment rien construit sinon sa propre maison et quatre églises. Il avance une proposition audacieuse : un cube de cent mètres de côté de verre et de marbre.
Stéphane Demoustier (frère de) se frotte décidément à des sujets intéressants et sait les traiter avec intelligence. Après La Fille au bracelet, sur l’insondable culpabilité d’une jeune femme, après Borgo, sur l’acclimation compliquée dans une prison corse d’une jeune surveillante venue du continent, voilà qu’il se lance dans l’adaptation du récit que Laurence Cossé a consacré en 2016 à des événements vieux de plus de trente ans : la réalisation compliquée de la Grande Arche de la Défense.
Un architecte scandinave un peu lunaire s’est retrouvé aux manettes d’un projet pharaonique par la seule volonté du prince, le président Mitterrand (Michel Fau, sphinxial), qui s’est personnellement impliqué dans sa sélection et l’a constamment soutenu. Le problème est que l’intégrité artistique de Johan Otto von Spreckelsen (Claes Bang) s’est vite heurtée au mur des réalités, à la réglementation tatillonne qui l’empêche d’utiliser telle ou telle colle pour joindre ses vitres, aux restrictions budgétaires qui le privent du marbre de Carrare qu’il souhaite utiliser et qu’il va lui-même acheter en Toscane, aux rivalités politiques qui menacent le projet lorsque la gauche perd les élections législatives de 1986.
Les résistances que rencontre Spreckelsen sont incarnées par deux personnages que le film a l’intelligence de ne pas caricaturer. D’une part Subilon, un conseiller présidentiel vibrionnant, interprété par Xavier Dolan. D’autre part Paul Andreu (Swann Arlaud), l’architecte surdoué qui avait signé l’aérogare de Roissy à vingt-neuf ans à peine et qui accepte modestement de se mettre au service de son collègue. Un autre personnage de fiction a été rajouté, celui de l’épouse de Spreckelsen (Sidse Babett Knudsen) qui essaie, sans guère de succès, de ramener son mari à la raison quand il s’arc-boute sur ses principes.
Un moment, j’ai cru que le film allait être celui que j’aurais aimé voir : un éloge du compromis. J’espérais que l’architecte intraitable accepterait de faire quelques concessions pour sauver son projet et que les résistances technocratiques qui le brimaient finiraient par céder pour laisser son art s’exprimer. Patatras ! la réalité s’est rappelée à moi et aux protagonistes et le film a pris une autre direction.
Cette absence de happy end m’a frustré. Mais, tout bien considéré, il faut y voir plus une qualité qu’un défaut. Le film, comme le livre qu’il adapte, est fidèle aux faits, lesquels, on le sait hélas, ne sont pas toujours ceux qu’on espère.



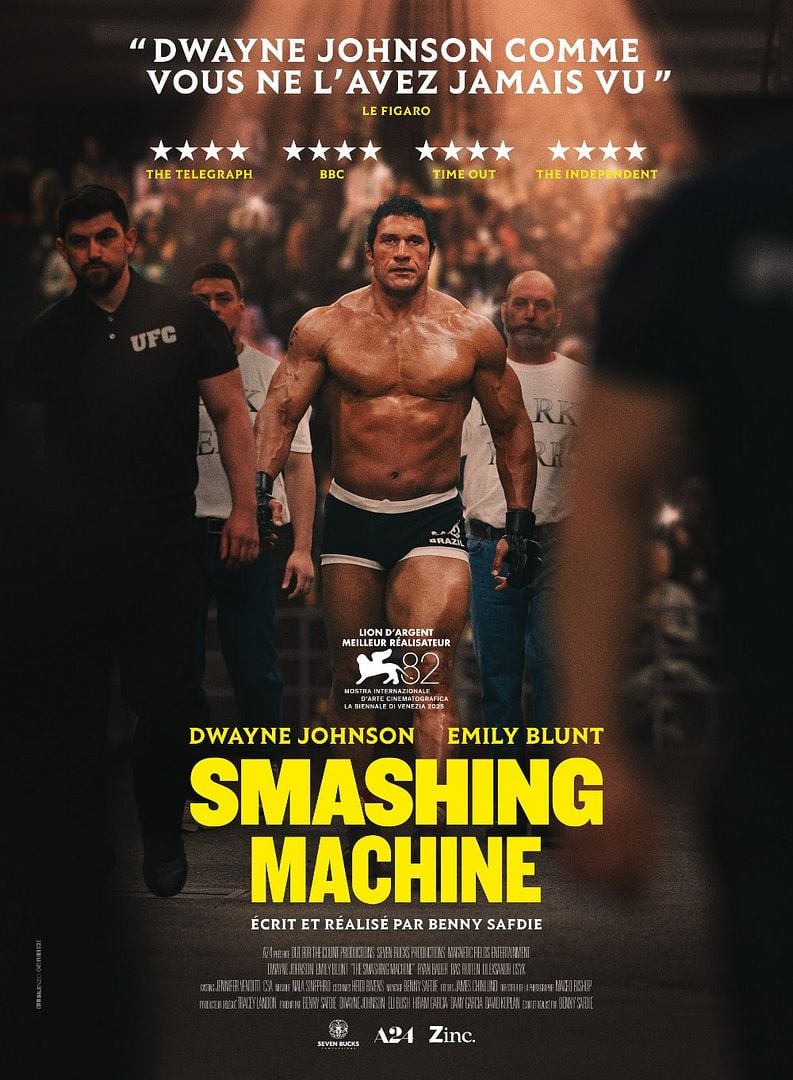

 Née en 1999, Gena Marvin a grandi au bord de la mer d’Okhotsk, à Magadan, à plusieurs milliers de kilomètres de la Russie européenne. Elle a été élevée par ses grands-parents, de modestes pêcheurs. Dans la Russie homophobe et conservatrice de Poutine, elle a essayé d’exprimer son mal-être, sa non-binarité dans des performances artistiques audacieuses, se mettant en scène dans des costumes d’une folle excentricité : le crâne et les sourcils entièrement rasés, le visage entièrement grimé, juchée sur des talons plateformes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, moulée dans des combinaisons en latex. Rejetée par ses grands-parents, exclue de son école d’art à Moscou, Gena manifeste contre l’entrée en guerre de la Russie en 2022 et décide de quitter son pays.
Née en 1999, Gena Marvin a grandi au bord de la mer d’Okhotsk, à Magadan, à plusieurs milliers de kilomètres de la Russie européenne. Elle a été élevée par ses grands-parents, de modestes pêcheurs. Dans la Russie homophobe et conservatrice de Poutine, elle a essayé d’exprimer son mal-être, sa non-binarité dans des performances artistiques audacieuses, se mettant en scène dans des costumes d’une folle excentricité : le crâne et les sourcils entièrement rasés, le visage entièrement grimé, juchée sur des talons plateformes de plusieurs dizaines de centimètres de hauteur, moulée dans des combinaisons en latex. Rejetée par ses grands-parents, exclue de son école d’art à Moscou, Gena manifeste contre l’entrée en guerre de la Russie en 2022 et décide de quitter son pays.