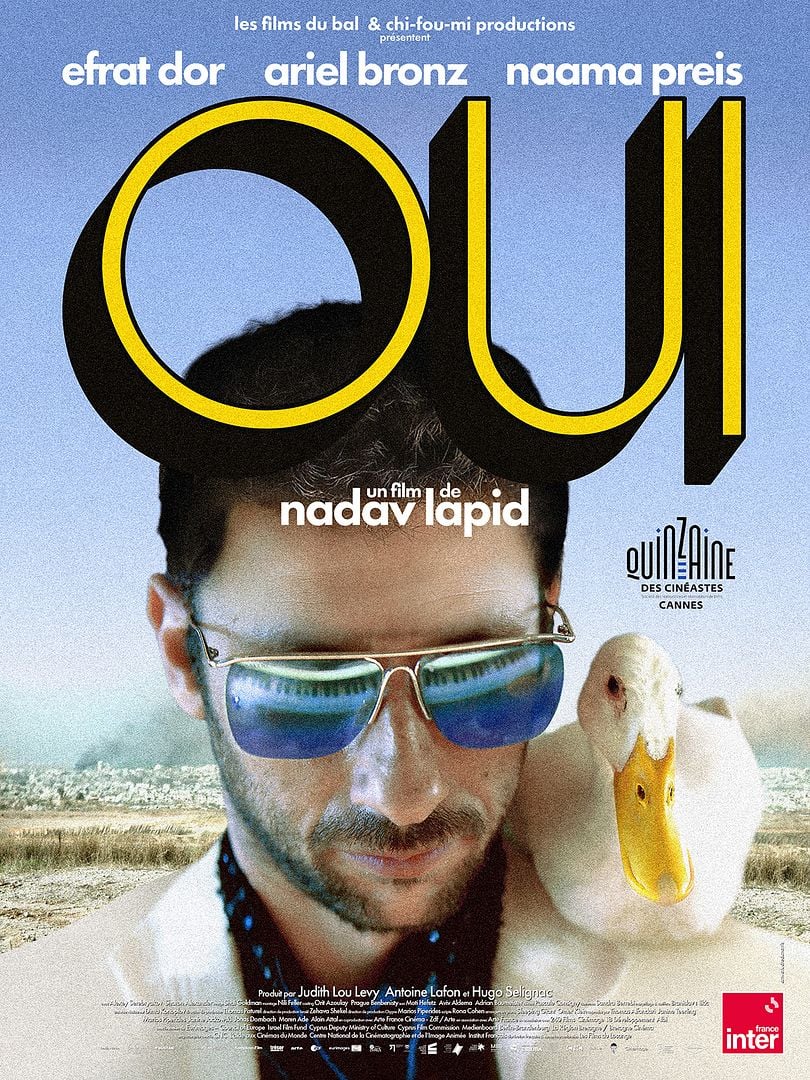Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) est un militant d’extrême gauche qui met au service d’un groupe paramilitaire, les French 75, ses talents d’artificier. Sa compagne, Perfidia Beverly Hills (Teyana Taylor) fait partie du groupuscule qui, lors d’une opération musclée dans un centre de rétention de réfugiés, humilie le commandant de la base, le colonel Lockjaw (Sean Penn) et noue avec lui une relation SM. Perfidia tombe enceinte et accouche d’une petite fille juste avant qu’un braquage qui tourne mal oblige le groupe à se dissoudre et ses membres à disparaître aux quatre coins de l’Amérique sous de fausses identités.
Bob élève seul sa fille Willa (Chase Infiniti) dans la paranoia de ses poursuivants. Seize ans plus tard, aiguillonné par une confrérie suprémaciste blanche, le colonel Lockjaw retrouve leur trace. Pour lui échapper Bob peut compter sur le professeur de karaté de sa fille, Sensei Giorgio (Benicio Del Toro).
Paul Thomas Anderson s’est affirmé comme l’un des plus importants réalisateurs du cinéma américain contemporain avec des films aussi marquants que Magnolia, There Will Be Blood ou Phantom Thread (wink Berthe Edelstein). Adapté d’un roman de Thomas Pynchon, l’un des plus grands et des plus mystérieux écrivains du vingtième siècle, avec son casting trois étoiles, il constituait l’un des films les plus attendus de l’année.
Le film est à la hauteur des attentes qu’il a fait naître. C’est un « grand » film dans tous les sens du terme : par sa durée qui flirte avec les trois heures, par son style flamboyant et classique à la fois, par son ambition enfin : offrir, comme Eddington sorti juste avant lui, une radioscopie de l’Amérique schizophrène écartelée entre ses deux extrêmes de droite et de gauche.
Ses acteurs sont épatants. Tout le film repose sur Leonardo DiCaprio, qui constitue, pour tous les spectateurs de mon âge, un marqueur : on l’a découvert, ado, sublimement beau et romantique, avant de le voir lentement vieillir et s’empâter. Son rôle aurait pu sombrer dans la caricature : celui d’un vieux révolutionnaire en robe de chambre, dont les vieux idéaux se sont envolés dans la fumée de la marie-jeanne et dont l’amour pour sa fille est devenue sa seule boussole. À ses côtés, Sean Penn signe une performance incroyable. Lui aussi aurait pu sombrer dans la caricature : celle du militaire guindé à la mâchoire serrée, aux cheveux et aux idées courts. Mais ces deux immenses acteurs arrivent à donner vie à leurs personnages caricaturaux et on passe le film à se pincer devant ce qu’ils osent faire. Cerise sur le gâteau : Benicio Del Toro dans le rôle improbable d’un professeur mexicain de karaté. On imagine que la jeune Chase Infiniti ne devait pas en mener large entre ces trois monstres sacrés et on admire d’autant plus son cran.
Une bataille après l’autre se regarde comme un thriller ample et puissant avec un final d’anthologie, dans un décor tellement américain.
C’est aussi un film d’une brûlante actualité, qui, s’il évoque les groupuscules terroristes des années 70, résonne avec les dérives suprémacistes du trumpisme et la criminalisation des mouvements antifa.