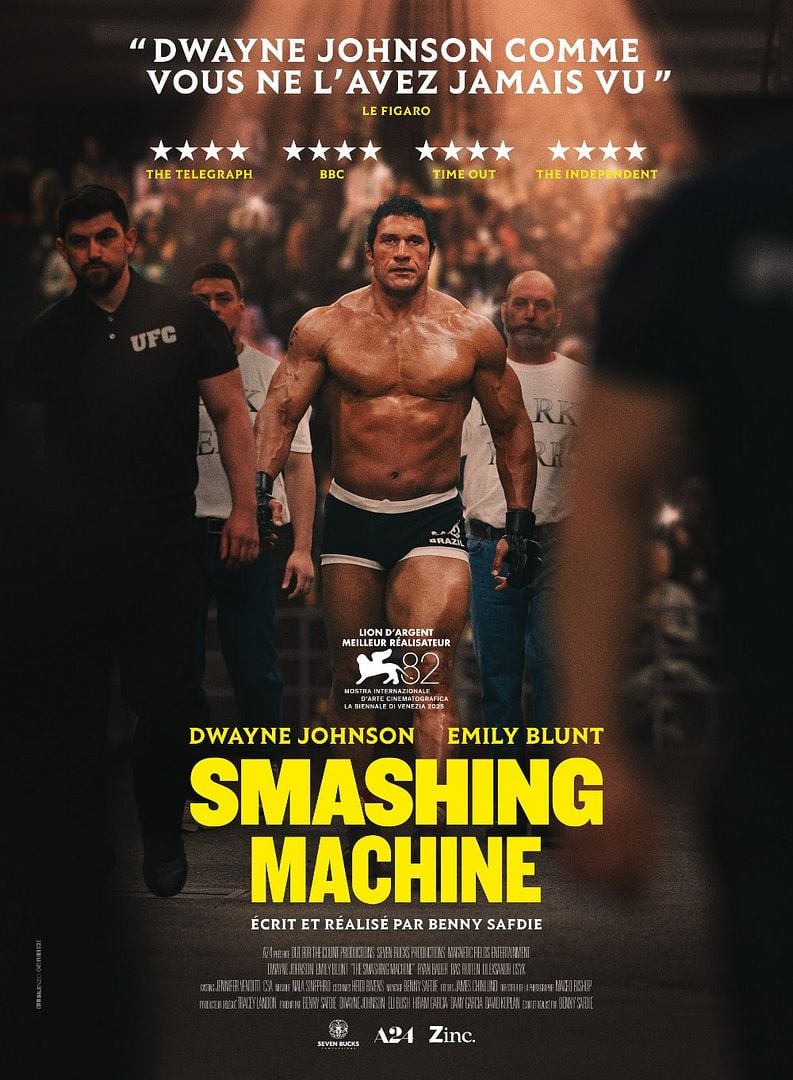Aurora (Joana Santos) est portugaise. Elle travaille en Ecosse dans une immense plateforme de distribution. Sa scannette au poing, elle arpente inlassablement les allées de l’entrepôt pour y trouver les produits qui doivent être expédiés. Sa productivité et la moindre de ses haltes sont contrôlées à distance. Le soir, Aurora regagne la colocation anonyme qu’elle partage avec d’autres travailleurs immigrés comme elle.
On Falling pourrait être un documentaire sur l’aliénation au travail. C’est une oeuvre de fiction. Son statut ambigu m’a rappelé le livre de Joseph Ponthus au succès amplifié par la disparition précoce de son auteur, À la ligne, et un documentaire sorti en salles en 2013 qui instruisait le procès du travail en abattoir, Entrée du personnel.
Mieux encore qu’un documentaire à charge l’aurait montré, On Falling raconte le quotidien des employés des grandes entreprises de logistique : les cadences débilitantes, la surveillance permanente, la solitude…. Il le fait sans sombrer dans la caricature comme parfois les films de Ken Loach auxquels On Falling fait penser : ici il n’y a pas de « méchant » patron ni de « gentil » travailleur. Le management est aimable et compréhensif. Aurora a le droit de quitter la réunion à laquelle elle est pourtant tenue d’assister. Si elle n’obtient pas une autorisation d’absence pour aller passer un entretien d’embauche, car elle en a fait la demande trop tardivement, elle pourra sans préjudice, le matin même, feindre d’être malade. Mais cette tutelle cauteleuse est peut-être plus terrifiante encore que le serait une direction caricaturalement abusive : ainsi de la barre de chocolat paternaliste offerte à Aurora pour ses bons résultats.
Le scénario multiplie les non-dits. On ne saura rien des motifs qui ont poussé Aurora à venir travailler en Ecosse. On ne saura rien non plus de ses attaches au Portugal, de sa famille, de ses amis qu’elle y a laissés. On comprend qu’elle tire le diable par la queue et qu’une dépense imprévue suffit à mettre l’équilibre de son budget en péril. Dans sa colocation, elle essaie timidement de retrouver un peu de la chaleur humaine qui lui fait si douloureusement défaut. Elle y fait la connaissance d’un autre travailleur immigré comme elle, venu de Pologne. La romance qui se noue, avant de se dénouer bien vite dans un plan muet que je n’oublierai pas de sitôt, est déchirante.
Certes, on pourra reprocher à On Falling son minimalisme. Cinq fois, six fois, sept fois, la même scène se répète. Mais cette répétition a un sens : comme dans le livre de Ponthus, elle nous fait ressentir l’abrutissement causé par la répétition sempiternelle des mêmes gestes au travail.

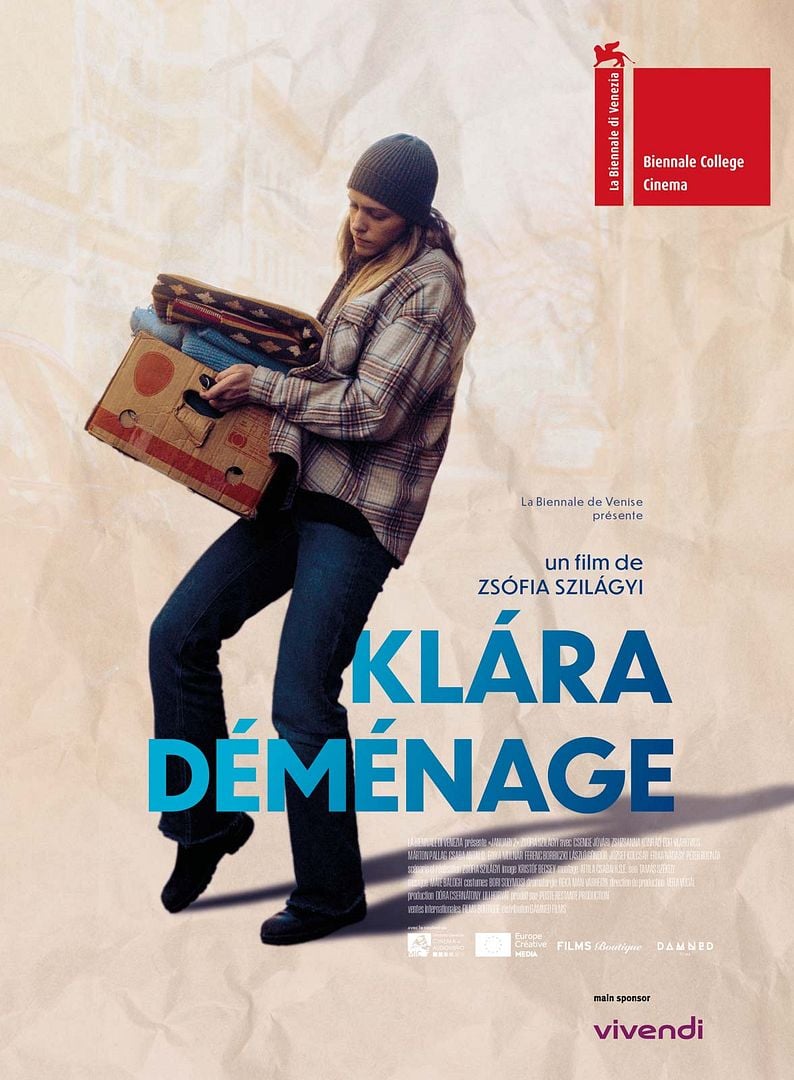


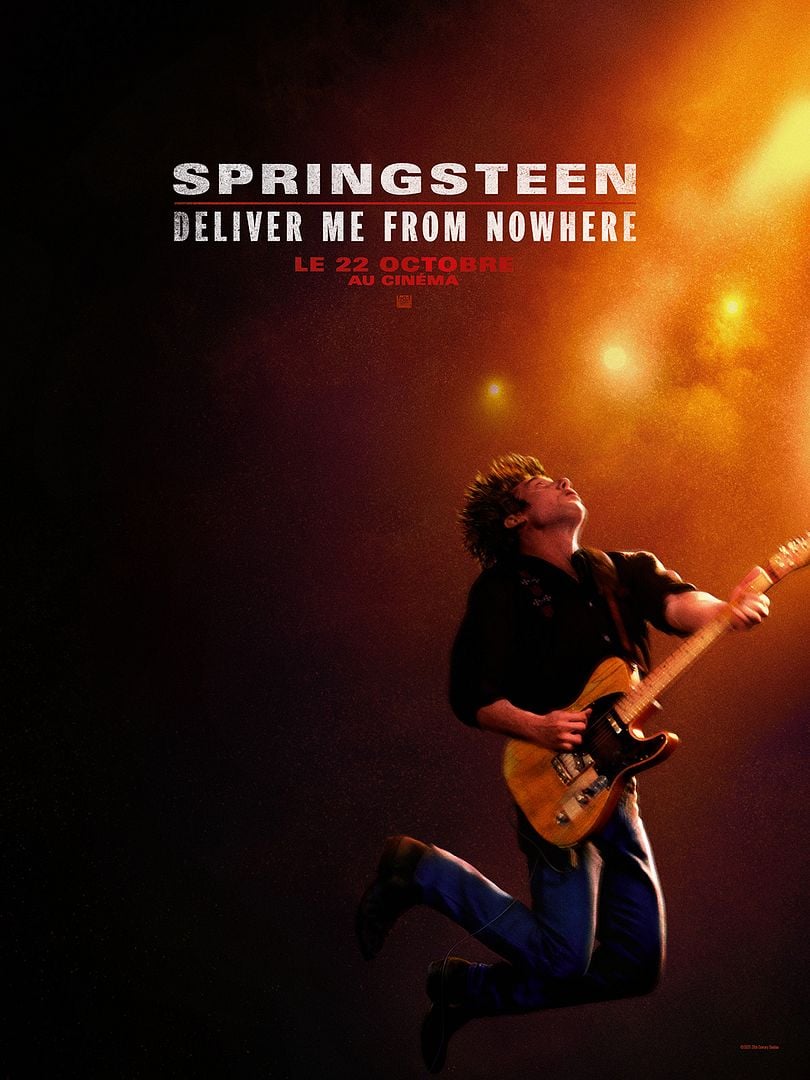
 Karine et Jimmy forment un couple uni et aimant. Karine (Virgine Efira) travaille dans une pâtisserie industrielle. Jimmy (Arieh Worthalter) dirige une petite entreprise familiale de transport routier. En couple depuis une vingtaine d’années, ils ont eu un garçon et une fille désormais lycéens l’un et l’autre. Quand éclate fin 2018 le mouvement des Gilets jaunes, Karine en devient l’une des militantes les plus enflammées alors que Jimmy n’y croit pas.
Karine et Jimmy forment un couple uni et aimant. Karine (Virgine Efira) travaille dans une pâtisserie industrielle. Jimmy (Arieh Worthalter) dirige une petite entreprise familiale de transport routier. En couple depuis une vingtaine d’années, ils ont eu un garçon et une fille désormais lycéens l’un et l’autre. Quand éclate fin 2018 le mouvement des Gilets jaunes, Karine en devient l’une des militantes les plus enflammées alors que Jimmy n’y croit pas.