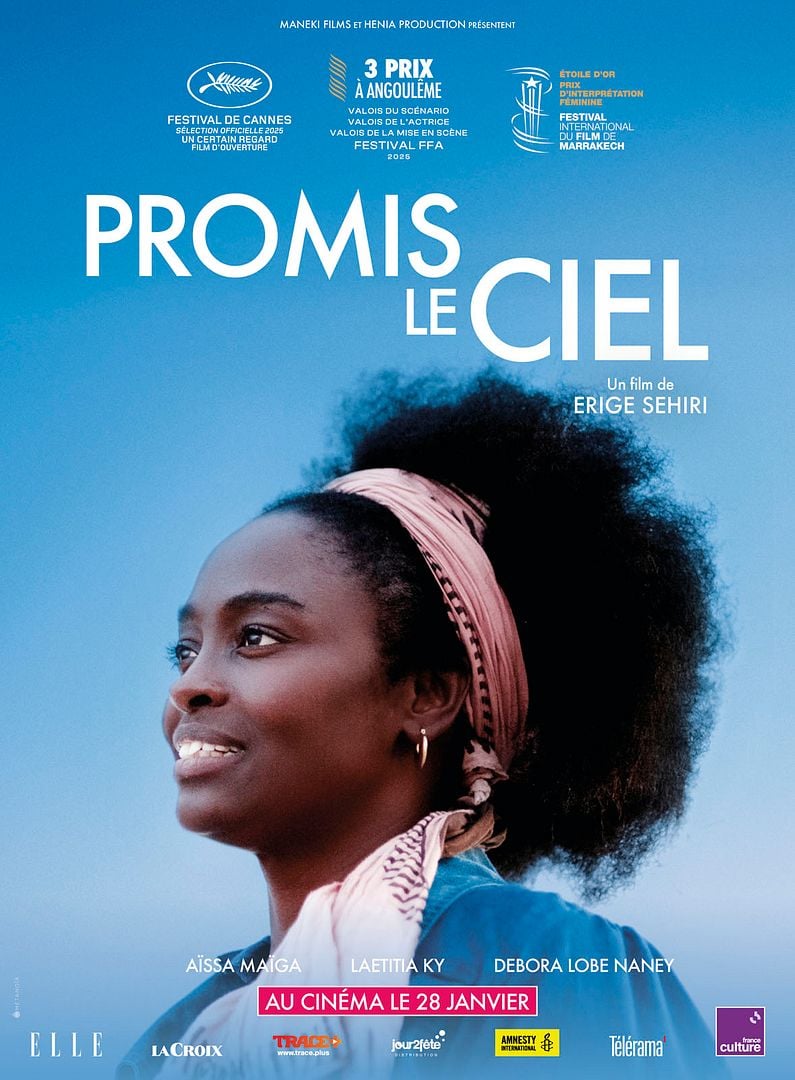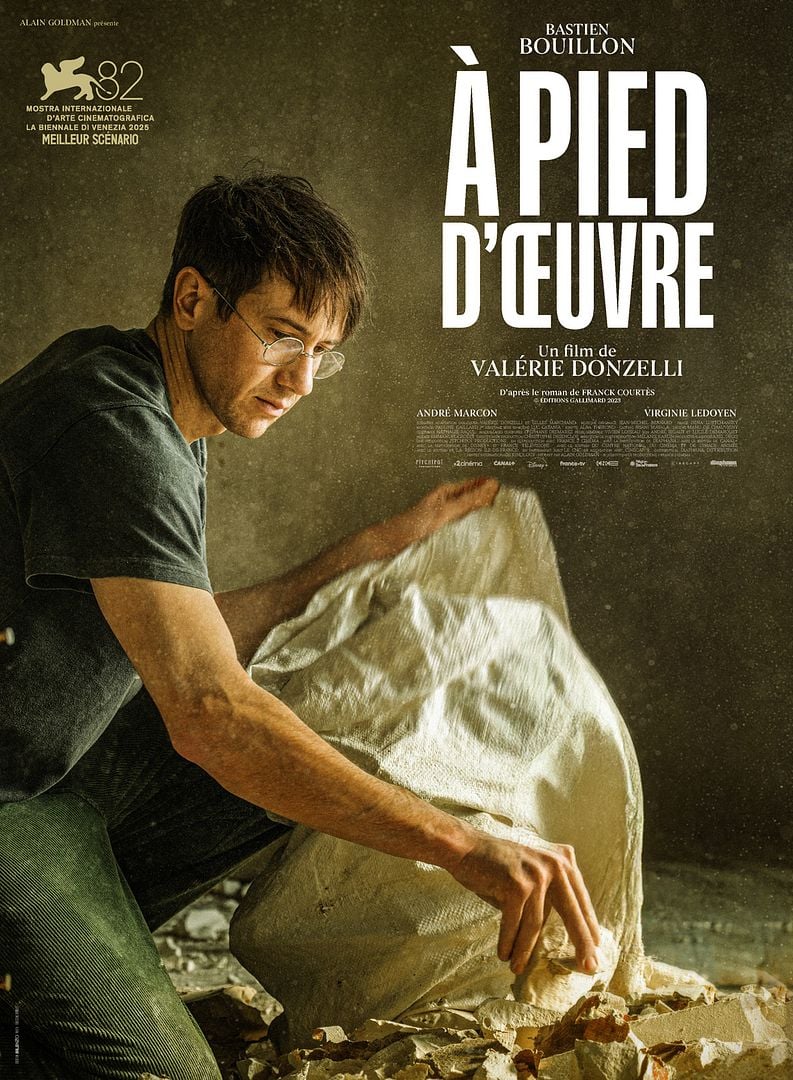Ainara a dix-sept ans. Intimement attirée par la vie monastique, elle hésite à prendre le voile. Mais sa vocation religieuse se heurte à bien des résistances. La société la considère comme une bizarrerie anachronique. Sa famille y voit le risque d’un endoctrinement sectaire.
Ce film est un bijou qui décevra à la fois les bigots qui, à son pitch, escomptaient un film de la même veine que Sacré Cœur, et les laïcards forcenés qui dégainent leurs revolvers dès qu’ils entendent le mot religion. Car Les Dimanches réussit miraculeusement à tenir la balance égale entre les deux extrêmes, celui d’une religiosité pure de tout questionnement et celui d’un sécularisme qui considère toute pratique religieuse comme une dangereuse dérive sectaire.
Comment peut-on devenir religieuse aujourd’hui ? C’est sur un mode presqu’ironique que la question est posée tant elle peut sembler anachronique. Comment diable (!) une jeune adolescente en pleine possession de ses moyens pourrait-elle être attirée de nos jours par une vie de réclusion et de silence entre les quatre murs d’un couvent glacial au milieu de vieilles filles voilées et velues ?
Alors que le lycée se termine, la vie offre tous ses possibles à Ainara : l’université, les études, les voyages, les fêtes… Son père, endetté jusqu’au cou par l’ouverture de son restaurant, sa tante, qui sert à Ainara de mère de substitution depuis la mort de sa génitrice, et sa grand-mère l’incitent à croquer la vie. Ils réagissent très mal quand Ainara s’ouvre à eux de son projet. Certes, en bons Espagnols, ils ont été élevés dans la foi catholique mais ne sont plus guère pratiquants. Ils craignent pour leur fille/nièce/petite-fille chérie qu’elle se fasse embrigader et ne puisse faire machine arrière. Que doivent-ils faire ? la laisser partir au risque de la perdre ou qu’elle se perde ? la retenir contre sa volonté ?
La jeune actrice Blanca Soroa oppose son visage de madone et son épaisse chevelure à la Mona Lisa coupée par une sage raie au milieu à tout le tohu-bohu qui règne autour d’elle. Elle n’entretient pas de relation malsaine au corps ou à la chasteté. Il n’y a chez elle aucun manque à combler, aucun traumatisme à soigner, juste un appel qui se fera peut-être entendre et auquel elle est prête à répondre. C’est peut-être la partie la plus difficile à comprendre pour ceux qui, comme moi, n’ont pas la foi : l’entrée dans les ordres n’est pas une décision souveraine mais la réponse à un appel transcendant.


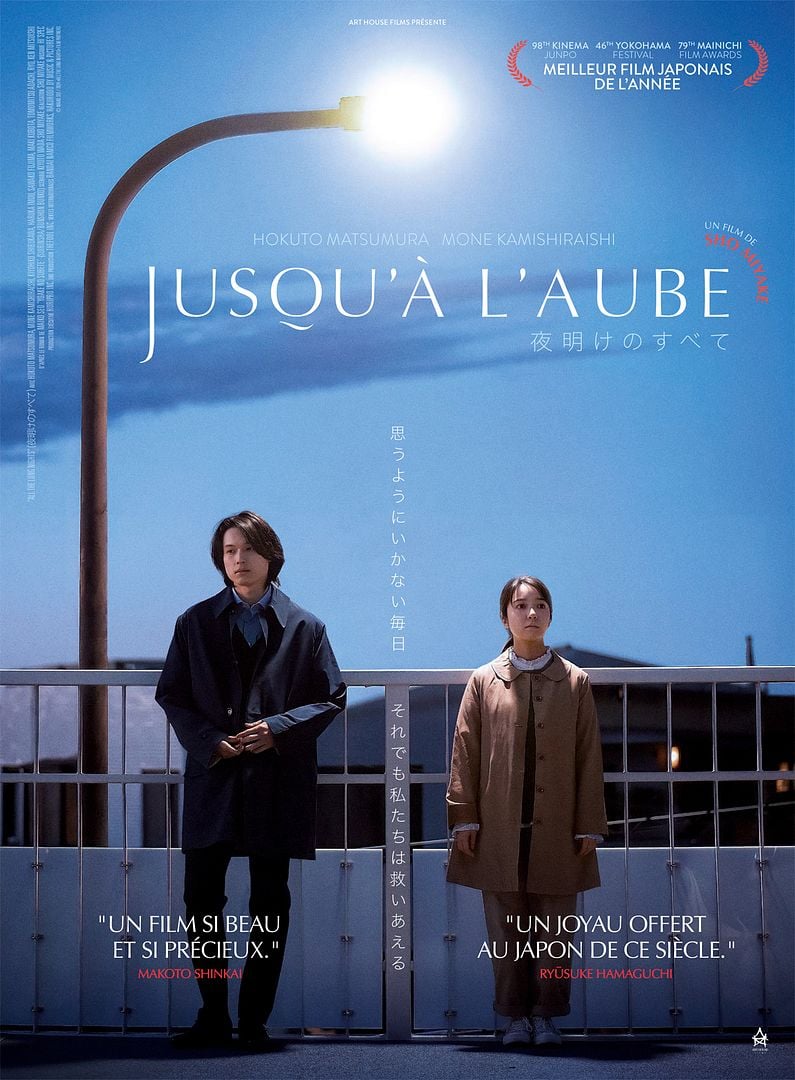
 Phillip Vanderploeg
Phillip Vanderploeg