 Avant son mariage, Jeanne (Noémie Merlant) part avec trois amies en Roumanie enterrer sa vie de jeune fille. À une station-service, leur voiture leur est volée. Les jeunes filles sont recueillies par Nino, un jeune Gitan, et par sa famille qui accepte de les héberger. Entre Jeanne et Nino naît une attirance trouble.
Avant son mariage, Jeanne (Noémie Merlant) part avec trois amies en Roumanie enterrer sa vie de jeune fille. À une station-service, leur voiture leur est volée. Les jeunes filles sont recueillies par Nino, un jeune Gitan, et par sa famille qui accepte de les héberger. Entre Jeanne et Nino naît une attirance trouble.
Noémie Merlant est une étoile montante du cinéma français. Elle a été nommée aux Césars en 2017 pour Le ciel attendra et en 2020 pour Portrait de la jeune fille en feu. On l’a vu dans Les Olympiades, un des tout meilleurs films de l’année dernière. Elle crevait l’écran dans A Good Man où elle interprétait une femme transgenre.
À l’instar de Luàna Bajrami, une autre actrice dans le vent, qui a tourné son premier film au Kosovo, Noémie Merlant a embarqué une bande de copines et une équipe technique minimaliste pour le village natal de son amoureux, Gimi Covaci, en Roumanie. On imagine la part d’autobiographie que ce récit comprend, cette histoire d’amour improbable entre une Française pur jus et un Gitan qui partage sa vie entre Paris et la Roumanie.
On est touchés de partager cette intimité-là. On en est aussi vaguement gênés, craignant de commettre une intrusion dans un cercle où nous n’avons pas été invités. Ce malaise culmine dans la (très belle) scène de sexe qui réunit les deux amoureux : quand on sait que les deux acteurs sont (ou ont été ?) en couple, on se demande où commence le cinéma, où s’arrête le voyeurisme.
On pourra trouver l’intrigue un peu courte, construite autour d’un principe simpliste et bien-pensant : « il faut aller au-delà de ses préjugés ». On sent aussi que le scénario ne sait pas comment se dépêtrer de l’intrigue qu’il a nouée : Jeanne renoncera-t-elle à son mariage pour le beau Nino ? Mais on se laisse emporter par l’élan de vie qu’insuffle Noémie Merlant à son film et à ses acteurs.

 Deux jeunes femmes, l’une brune, l’autre blonde, toutes deux prénommées Marie, vivent un rêve éveillé où elles s’autorisent une vie « dépravée ». Elles se font inviter au restaurant par de vieux messieurs libidineux, dînent à l’œil dans un dancing dont elles se font expulser, barbotent dans une baignoire remplie de lait, saccagent un buffet, dont elles essaient vainement de recoller les débris…
Deux jeunes femmes, l’une brune, l’autre blonde, toutes deux prénommées Marie, vivent un rêve éveillé où elles s’autorisent une vie « dépravée ». Elles se font inviter au restaurant par de vieux messieurs libidineux, dînent à l’œil dans un dancing dont elles se font expulser, barbotent dans une baignoire remplie de lait, saccagent un buffet, dont elles essaient vainement de recoller les débris…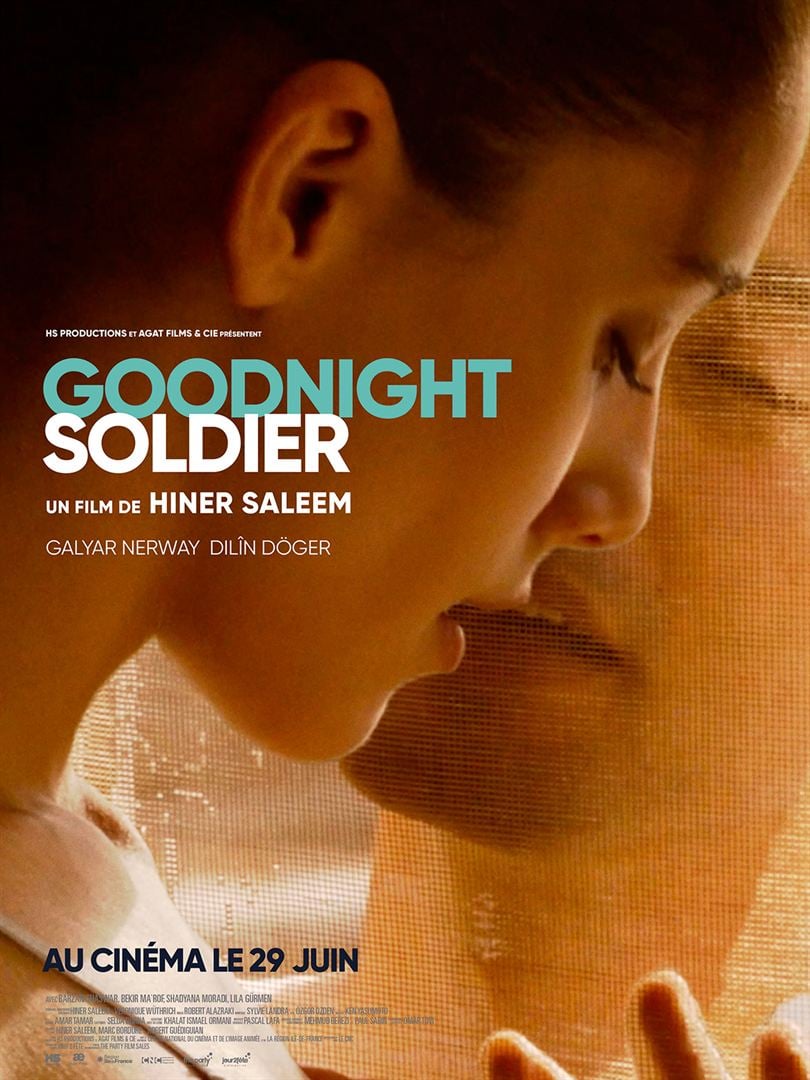 Au Kurdistan irakien, Ziné et Avdal sont les deux enfants de deux familles déchirées par une haine atavique. Mais Ziné et Avdal s’aiment et rien ne pourra empêcher leur mariage.
Au Kurdistan irakien, Ziné et Avdal sont les deux enfants de deux familles déchirées par une haine atavique. Mais Ziné et Avdal s’aiment et rien ne pourra empêcher leur mariage. Castagliano (Gert Fröbe), le directeur d’une compagnie de transport installée dans le Sud marocain a embauché un nouveau chauffeur pour lui confier la responsabilité d’un poids lourd à la cargaison mystérieuse. Flairant un bon coup, Rocco (Jean-Paul Belmondo), un autre routier, en prend le volant et s’enfuit avec le précieux chargement en compagnie de Pepa (Andréa Parisy), sa maîtresse. Fou de colère, Castagliano missionne Marec (Lino Ventura) pour le rattraper. S’engage une course poursuite dans l’Atlas marocain.
Castagliano (Gert Fröbe), le directeur d’une compagnie de transport installée dans le Sud marocain a embauché un nouveau chauffeur pour lui confier la responsabilité d’un poids lourd à la cargaison mystérieuse. Flairant un bon coup, Rocco (Jean-Paul Belmondo), un autre routier, en prend le volant et s’enfuit avec le précieux chargement en compagnie de Pepa (Andréa Parisy), sa maîtresse. Fou de colère, Castagliano missionne Marec (Lino Ventura) pour le rattraper. S’engage une course poursuite dans l’Atlas marocain. David Gulpilil est un acteur australien aborigène né en 1953 dans un territoire quasiment inaccessible sans contact avec le monde moderne. Repéré encore adolescent, il joue à seize ans dans le film La Randonnée et devient immédiatement célèbre. Pendant quarante ans on le retrouve à l’affiche des plus grands films australiens où il tient immanquablement le rôle de l’aborigène de service, fier, nu et authentique : Crocodile Dundee, Le Chemin de la Liberté, Australia, Charlie’s Country….
David Gulpilil est un acteur australien aborigène né en 1953 dans un territoire quasiment inaccessible sans contact avec le monde moderne. Repéré encore adolescent, il joue à seize ans dans le film La Randonnée et devient immédiatement célèbre. Pendant quarante ans on le retrouve à l’affiche des plus grands films australiens où il tient immanquablement le rôle de l’aborigène de service, fier, nu et authentique : Crocodile Dundee, Le Chemin de la Liberté, Australia, Charlie’s Country…. Une jeune femme (Sara Giraudeau) est assise sur un banc à Montmartre. Elle a perdu la mémoire et son téléphone portable. Pour l’aider à les retrouver, elle pourra compter sur Sonia (Sarah Succo), une collègue de travail, et Moby Dick, un Géo Trouvetou de l’informatique (Pierre Deladonchamps)
Une jeune femme (Sara Giraudeau) est assise sur un banc à Montmartre. Elle a perdu la mémoire et son téléphone portable. Pour l’aider à les retrouver, elle pourra compter sur Sonia (Sarah Succo), une collègue de travail, et Moby Dick, un Géo Trouvetou de l’informatique (Pierre Deladonchamps)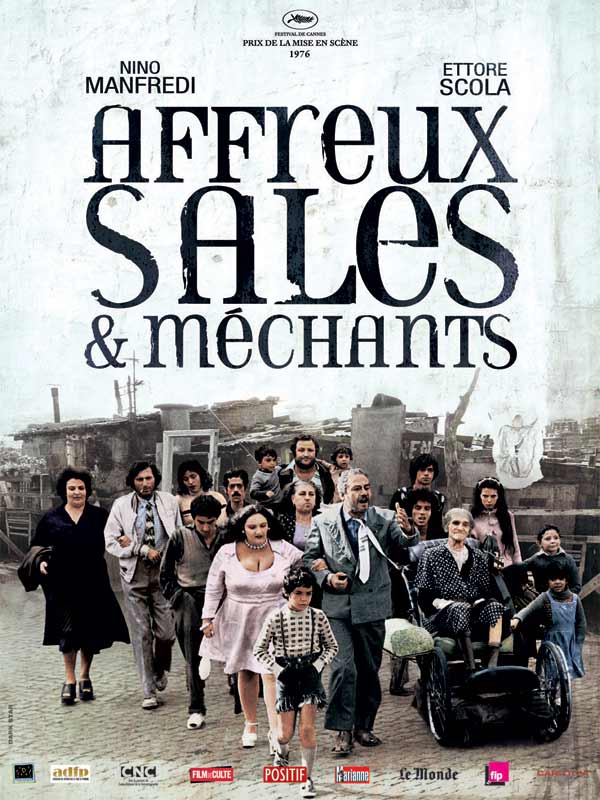 Une vingtaine de gueux s’entassent dans un minuscule taudis d’un bidonville à Rome. Giacinto (Nino Manfredi) y règne en despote, assis sur le magot qui lui a été versé par son employeur après la perte de son oeil gauche. Sa femme, sa mère impotente, ses enfants et ses beaux-enfants vivent ou survivent dans un bruit insupportable et une crasse répugnante : les garçons volent, les filles se prostituent tandis que les plus jeunes sont parqués dans un enclos pour éviter de se dissiper.
Une vingtaine de gueux s’entassent dans un minuscule taudis d’un bidonville à Rome. Giacinto (Nino Manfredi) y règne en despote, assis sur le magot qui lui a été versé par son employeur après la perte de son oeil gauche. Sa femme, sa mère impotente, ses enfants et ses beaux-enfants vivent ou survivent dans un bruit insupportable et une crasse répugnante : les garçons volent, les filles se prostituent tandis que les plus jeunes sont parqués dans un enclos pour éviter de se dissiper.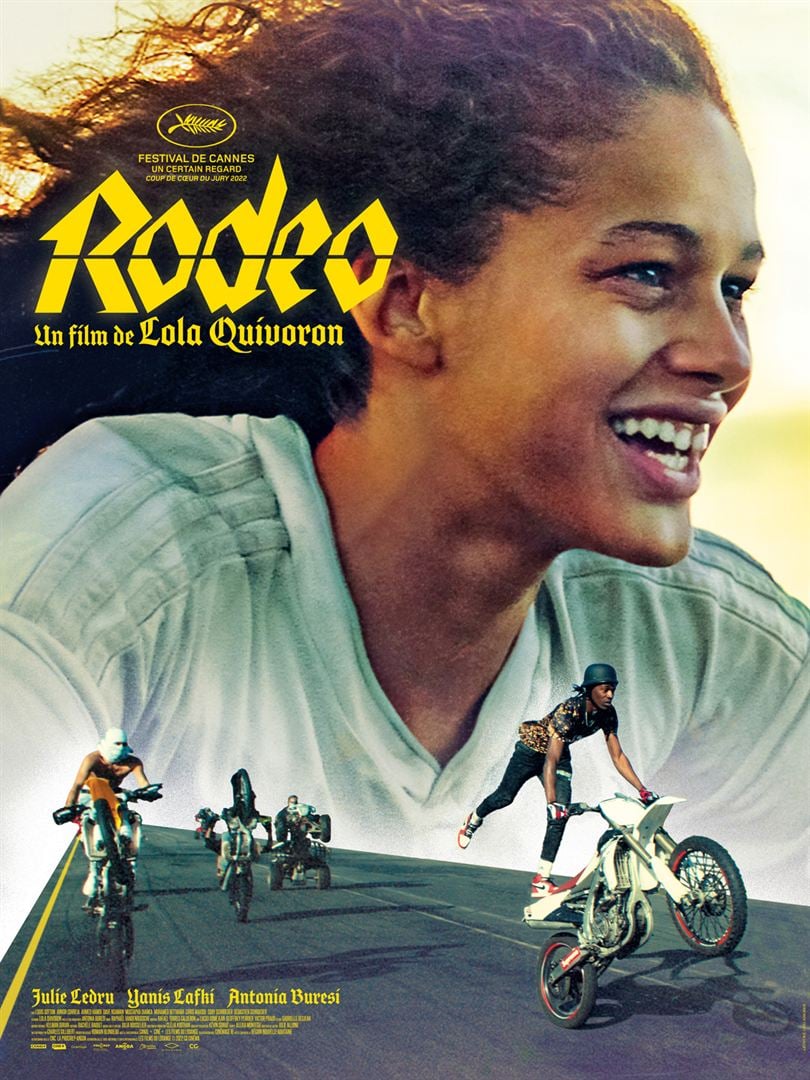 Julia (Julie Ledru) est une jeune femme sans toit ni loi, qui ne vit dans la banlieue bordelaise que pour sa seule passion : le cross-bitume. Sur une « ligne », après un accident dramatique qui emportera l’un de ses membres, elle réussit à s’incruster dans une bande de motards dirigée d’une main de fer depuis sa cellule de prison par Domino. Tandis que Julia se rapproche d’Ophélie, la compagne de Domino, elle tente non sans mal de se faire une place dans la bande, exclusivement masculine.
Julia (Julie Ledru) est une jeune femme sans toit ni loi, qui ne vit dans la banlieue bordelaise que pour sa seule passion : le cross-bitume. Sur une « ligne », après un accident dramatique qui emportera l’un de ses membres, elle réussit à s’incruster dans une bande de motards dirigée d’une main de fer depuis sa cellule de prison par Domino. Tandis que Julia se rapproche d’Ophélie, la compagne de Domino, elle tente non sans mal de se faire une place dans la bande, exclusivement masculine. Jeanne Mayer (Blanche Gardin) est une jeune start-upeuse propulsée sur le devant de la scène médiatique pour une invention de génie – un filtre biodégradable capable de nettoyer les océans de leur plastique – et rapidement déchue de sa gloire éphémère après le naufrage de son projet. Sa situation financière ayant du plomb dans l’aile, elle n’a d’autre solution que d’aller vendre l’appartement que sa mère (Marthe Keller), suicidée l’an dernier, a légué à Lisbonne, à elle et à son frère (Maxence Tual).
Jeanne Mayer (Blanche Gardin) est une jeune start-upeuse propulsée sur le devant de la scène médiatique pour une invention de génie – un filtre biodégradable capable de nettoyer les océans de leur plastique – et rapidement déchue de sa gloire éphémère après le naufrage de son projet. Sa situation financière ayant du plomb dans l’aile, elle n’a d’autre solution que d’aller vendre l’appartement que sa mère (Marthe Keller), suicidée l’an dernier, a légué à Lisbonne, à elle et à son frère (Maxence Tual). Pour lutter contre le vieillissement de sa population qui obère ses finances publiques, le Japon a mis en place un plan d’accompagnement à l’euthanasie dénommé Plan 75 destiné – comme son nom l’indique – aux plus de soixante-quinze ans. Michi, une octogénaire, qui vient de perdre son emploi de femme de ménage dans un grand hôtel et dont le logement va être détruit sans espoir d’en retrouver un rapidement, se résout à y souscrire. Hiromi, un jeune cadre, a été embauché par l’organisation en charge du Plan 75 et a la responsabilité de convaincre des retraités de signer ces contrats. Maria enfin est une Philippine, émigrée au Japon et travaillant au chevet des personnes âgées pour y économiser la somme nécessaire à l’opération de sa petite fille de cinq ans, atteinte d’une grave malformation cardiaque.
Pour lutter contre le vieillissement de sa population qui obère ses finances publiques, le Japon a mis en place un plan d’accompagnement à l’euthanasie dénommé Plan 75 destiné – comme son nom l’indique – aux plus de soixante-quinze ans. Michi, une octogénaire, qui vient de perdre son emploi de femme de ménage dans un grand hôtel et dont le logement va être détruit sans espoir d’en retrouver un rapidement, se résout à y souscrire. Hiromi, un jeune cadre, a été embauché par l’organisation en charge du Plan 75 et a la responsabilité de convaincre des retraités de signer ces contrats. Maria enfin est une Philippine, émigrée au Japon et travaillant au chevet des personnes âgées pour y économiser la somme nécessaire à l’opération de sa petite fille de cinq ans, atteinte d’une grave malformation cardiaque.