 Le jeune André Merlaux (Hugo Becker) vient d’être recruté à la DGSE. Le service, dirigé d’une main de fer par le colonel Mercaillon (Wilfred Benaïche), un grand résistant, doit faire face à bien des défis : la décolonisation de l’Afrique noire, les « événements en Algérie, la Guerre froide…
Le jeune André Merlaux (Hugo Becker) vient d’être recruté à la DGSE. Le service, dirigé d’une main de fer par le colonel Mercaillon (Wilfred Benaïche), un grand résistant, doit faire face à bien des défis : la décolonisation de l’Afrique noire, les « événements en Algérie, la Guerre froide…
Comme Le Bureau des légendes, Au service de la France se déroule dans les couloirs de la DGSE. Mais la comparaison s’arrête là. Si la série de Canal embrasse, avec le succès que l’on sait, le parti du réalisme, celle produite par Arte, avec un budget autrement plus limité, prend celui de la parodie. À la façon de OSS 117, Au service … se moque de la France du général de Gaulle, de son patriotisme désuet, de son machisme hors d’âge…
La série est élégante et drôle. L’atmosphère des années soixante, ses costumes, ses expressions et jusqu’à son phrasé sont méticuleusement reconstitués – même si le manque de budget se ressent dans les scènes d’extérieur.
Les personnages sont truculents, qui, comme Hubert Bonisseur de La Bath dans OSS 117, font preuve d’une incompétence désopilante à la mesure de leur arrogance et de leur machisme. C’est le cas notamment des trois pieds nickelés chefs de département. Mention spéciale à Jean-Edouard Bodziak dans le rôle d’un kremlinologue passablement schizophrène
L’humour fait souvent mouche. On rit au « Messieurs » lancé systématiquement par un directeur sexiste à une assemblée composée de cadres masculins et de secrétaires féminines, à l’évocation de Vichy qu’il ne faudrait pas jeter avec l’eau de Vichy (1.7.) ou à celle des électeurs fantômes du cinquième arrondissement (2.1.) – d’autant plus volontiers qu’on y vote.
Mais l’enchaînement des calembours ne suffit pas à construire un récit. L’ennui s’installe et le naufrage est évité de justesse à la fin de la première saison par l’esquisse d’une intrigue qui donne soudainement plus d’envergure aux personnages. Le falot Merlaux se révèle plus courageux qu’on le pensait et l’héroïque Mercaillon moins irréprochable qu’il n’y paraît. On se laisse du coup convaincre de regarder les douze épisodes de la saison suivante. Leur rythme enlevé (vingt-six minutes seulement) rend leur visionnage plus rapide et plus agréable. Mais quand se termine cette seconde saison, on comprend la décision des producteurs de renoncer à en réaliser une troisième.

 Le Président des États-Unis, sentant sa fin prochaine, inquiet de la politique que suivra après sa mort son vice-président, décide de remplacer son Secrétaire d’État par Robert Leffingwell (Henry Fonda). Mais son choix doit être approuvé par le Sénat. Sa nomination se heurte à l’opposition vindicative du vieux sénateur Seabright Cooley (Charles Laughton) qui reproche à Leffingwell ses sympathies pro-communistes.
Le Président des États-Unis, sentant sa fin prochaine, inquiet de la politique que suivra après sa mort son vice-président, décide de remplacer son Secrétaire d’État par Robert Leffingwell (Henry Fonda). Mais son choix doit être approuvé par le Sénat. Sa nomination se heurte à l’opposition vindicative du vieux sénateur Seabright Cooley (Charles Laughton) qui reproche à Leffingwell ses sympathies pro-communistes. Dans un futur proche, en Norvège. Après que le Premier ministre écologiste a annoncé sa décision de substituer le thorium aux énergies fossiles, la Russie intervient pour forcer la Norvège à reprendre sa production de pétrole. Chaque Norvégien est placé face à un dilemme : coopérer avec le nouvel occupant ou résister ?
Dans un futur proche, en Norvège. Après que le Premier ministre écologiste a annoncé sa décision de substituer le thorium aux énergies fossiles, la Russie intervient pour forcer la Norvège à reprendre sa production de pétrole. Chaque Norvégien est placé face à un dilemme : coopérer avec le nouvel occupant ou résister ?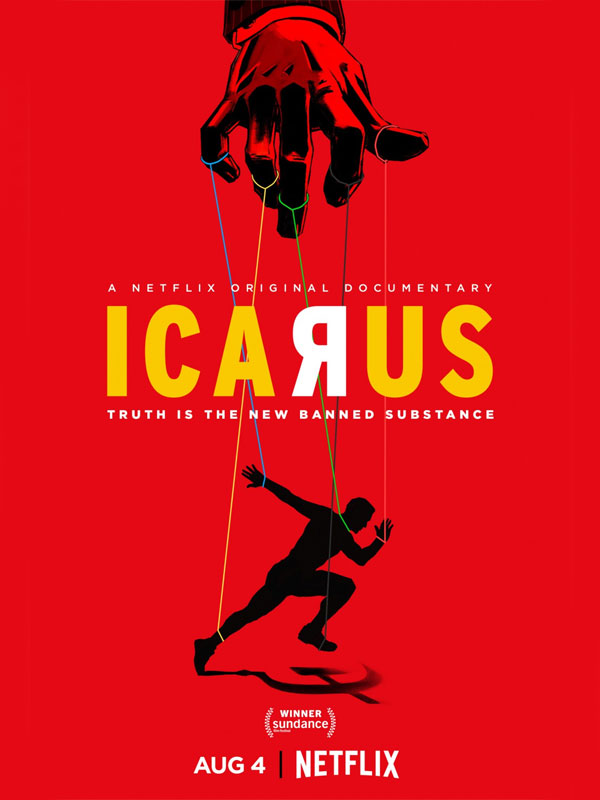 Documentariste et cycliste amateur, Bryan Fogel avait décidé de mener une enquête sur le dopage sportif en utilisant son propre corps comme cobaye. Un peu comme Morgan Spurlock dans Super Size Me, qui mesura les effets de la malbouffe en se nourrissant uniquement de McBurgers. Pour mener à bien son enquête, le cycliste est entré un contact avec Gregory Rodchenkov, un chimiste russe qui dirigeait à l’époque le laboratoire de Moscou référent de l’Agence mondiale antidopage. Avec sa complicité active, Bryan Fogel a suivi un programme anabolisant censé développer ses performances.
Documentariste et cycliste amateur, Bryan Fogel avait décidé de mener une enquête sur le dopage sportif en utilisant son propre corps comme cobaye. Un peu comme Morgan Spurlock dans Super Size Me, qui mesura les effets de la malbouffe en se nourrissant uniquement de McBurgers. Pour mener à bien son enquête, le cycliste est entré un contact avec Gregory Rodchenkov, un chimiste russe qui dirigeait à l’époque le laboratoire de Moscou référent de l’Agence mondiale antidopage. Avec sa complicité active, Bryan Fogel a suivi un programme anabolisant censé développer ses performances.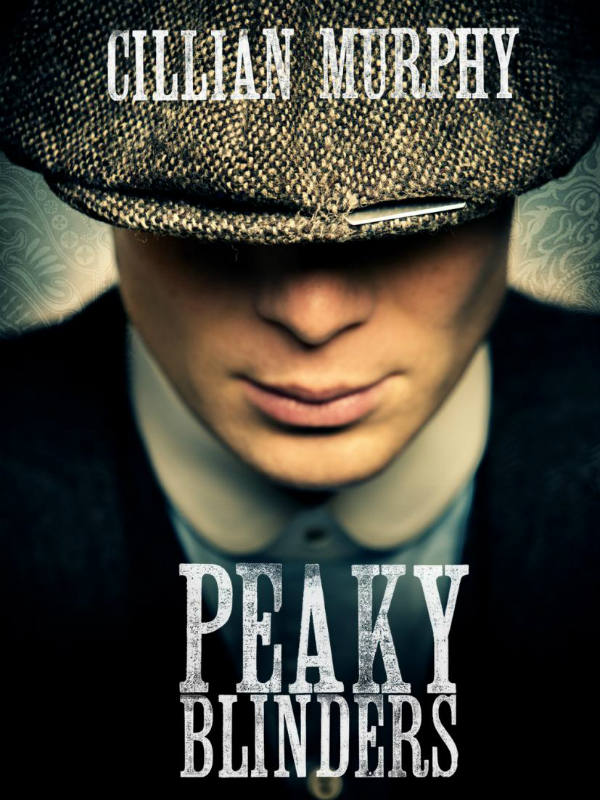 À Birmingham, dans les années vingt, un gang de gitans, les Peaky Blinders, pratique le racket et l’extorsion. À sa tête Tommy Shelby, un ancien soldat démobilisé, et ses trois frères.
À Birmingham, dans les années vingt, un gang de gitans, les Peaky Blinders, pratique le racket et l’extorsion. À sa tête Tommy Shelby, un ancien soldat démobilisé, et ses trois frères. Lucy Cola (Natalie Portman) rêvait depuis l’enfance de voyager dans l’espace. Son rêve est devenu réalité à force de travail et de sacrifices. Après une mission spatiale, elle doit se réacclimater à la banalité du quotidien. Lucy n’a qu’une seule obsession : repartir.
Lucy Cola (Natalie Portman) rêvait depuis l’enfance de voyager dans l’espace. Son rêve est devenu réalité à force de travail et de sacrifices. Après une mission spatiale, elle doit se réacclimater à la banalité du quotidien. Lucy n’a qu’une seule obsession : repartir. Épouse aimante du procureur de Chicago, mère de famille attentionnée, Alicia Florrick voit sa vie exploser quand l’adultère de son mari est révélé et quand des accusations de corruption conduisent à son incarcération. L’ancienne avocate qui avait arrêté de travailler pour se consacrer à sa famille se voit obligée à la quarantaine de reprendre du service. Elle est recrutée dans une grande firme de Chicago dont l’un des deux associés est un ancien camarade d’université.
Épouse aimante du procureur de Chicago, mère de famille attentionnée, Alicia Florrick voit sa vie exploser quand l’adultère de son mari est révélé et quand des accusations de corruption conduisent à son incarcération. L’ancienne avocate qui avait arrêté de travailler pour se consacrer à sa famille se voit obligée à la quarantaine de reprendre du service. Elle est recrutée dans une grande firme de Chicago dont l’un des deux associés est un ancien camarade d’université. Rémi (Patrick Dewaere), la quarantaine, est un pianiste d’hôtel dépressif sans talent. Il vit en couple avec Martine (Nicole Garcia) et sa fille Marion (Ariel Besse), une adolescente un peu rebelle. Quand Martine meurt accidentellement, quand Charly (Maurice Ronet), le père de Marion, refuse d’en assurer la garde, c’est à Rémi qu’il incombe de prendre l’adolescente sous sa coupe. Mais la situation devient bientôt intenable pour lui quand la jeune fille se déclare follement amoureuse de lui et se jette à son cou.
Rémi (Patrick Dewaere), la quarantaine, est un pianiste d’hôtel dépressif sans talent. Il vit en couple avec Martine (Nicole Garcia) et sa fille Marion (Ariel Besse), une adolescente un peu rebelle. Quand Martine meurt accidentellement, quand Charly (Maurice Ronet), le père de Marion, refuse d’en assurer la garde, c’est à Rémi qu’il incombe de prendre l’adolescente sous sa coupe. Mais la situation devient bientôt intenable pour lui quand la jeune fille se déclare follement amoureuse de lui et se jette à son cou.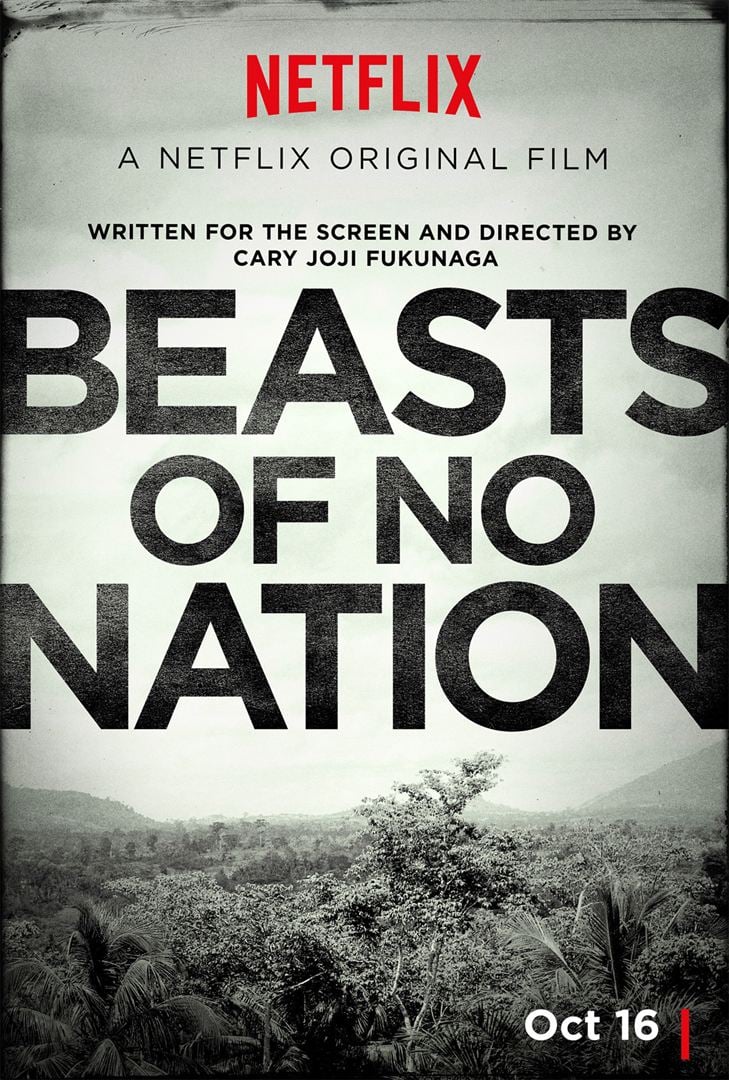 Le jeune Agu coule des jours heureux dans une petite ville d’Afrique de l’Ouest entre son père, sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Mais la guerre civile menace cet Eden. Sa mère et sa sœur doivent s’enfuir à la capitale. Quand l’armée régulière exécute sous ses yeux son père et son frère, Agu n’a d’autre alternative que de s’enfuir dans la jungle. Il y est recueilli par un bataillon d’enfants-soldats dirigé par un « commandant (Idris Elba) aussi charismatique que violent.
Le jeune Agu coule des jours heureux dans une petite ville d’Afrique de l’Ouest entre son père, sa mère, son frère aîné et sa petite sœur. Mais la guerre civile menace cet Eden. Sa mère et sa sœur doivent s’enfuir à la capitale. Quand l’armée régulière exécute sous ses yeux son père et son frère, Agu n’a d’autre alternative que de s’enfuir dans la jungle. Il y est recueilli par un bataillon d’enfants-soldats dirigé par un « commandant (Idris Elba) aussi charismatique que violent. Alors que la crise des missiles de Cuba place États-Unis et URSS au bord du gouffre fin 1962, un match d’échecs se déroule à Varsovie entre un grand maître soviétique et un génie des mathématiques, appelé à la dernière minute pour remplacer le joueur américain qui vient d’être mystérieusement assassiné.
Alors que la crise des missiles de Cuba place États-Unis et URSS au bord du gouffre fin 1962, un match d’échecs se déroule à Varsovie entre un grand maître soviétique et un génie des mathématiques, appelé à la dernière minute pour remplacer le joueur américain qui vient d’être mystérieusement assassiné.