 Harry Rawlins (Liam Neeson) et ses trois complices disparaissent dans un braquage qui tourne mal. Leur butin part en fumée. Problème : ces deux millions de dollars appartenaient à Jamal Manning, un parrain de la mafia qui les réclame illico à Veronica Rawlins.
Harry Rawlins (Liam Neeson) et ses trois complices disparaissent dans un braquage qui tourne mal. Leur butin part en fumée. Problème : ces deux millions de dollars appartenaient à Jamal Manning, un parrain de la mafia qui les réclame illico à Veronica Rawlins.
Celle-ci, uniquement guidée par les plans d’un casse lucratif laissés par son mari, n’a d’autre ressource que de réunir les veuves de ses complices pour organiser ce braquage et rembourser sa dette. Son objectif : le siège de campagne de Jack Mulligan.
Steve McQueen est désormais lesté d’une réputation encombrante. L’ancien plasticien a en effet signé quelques uns des films les plus marquants de la décennie : Hunger, Shame et Twelve Years A Slave, Oscar 2014 du meilleur film. Autant dire que son dernier film était attendu au tournant.
C’est tout le problème de ces Veuves, un thriller malin, largement au-dessus de la moyenne, mais qui n’atteint pas le niveau des précédents films de McQueen. Avec son twist étonnant, au beau milieu du film, on y retrouve la patte de Gillian Flyn, qui avait utilisé le même procédé dans le scénario de Gone Girl réalisé par David Fincher.
Les Veuves a un sous-texte féministe un peu trop dans l’air du temps pour ne pas être un tantinet suspect. Car c’est l’histoire de quatre femmes minorisées (une femme noire, une femme battue, une mère célibataire…) joliment interprétées par un carré de talents prometteurs (Viola Davis en route vers les Oscars, Elizabeth Debicki et son 1m90, Cynthia Erivo récemment remarquée dans Sale temps à l’hôtel El Royale, Carrie Coon révélée dans The Leftovers). Mais ça n’en reste pas moins une mécanique bien écrite, bien filmée, bien jouée, qui se laisse consommer sans déplaisir.

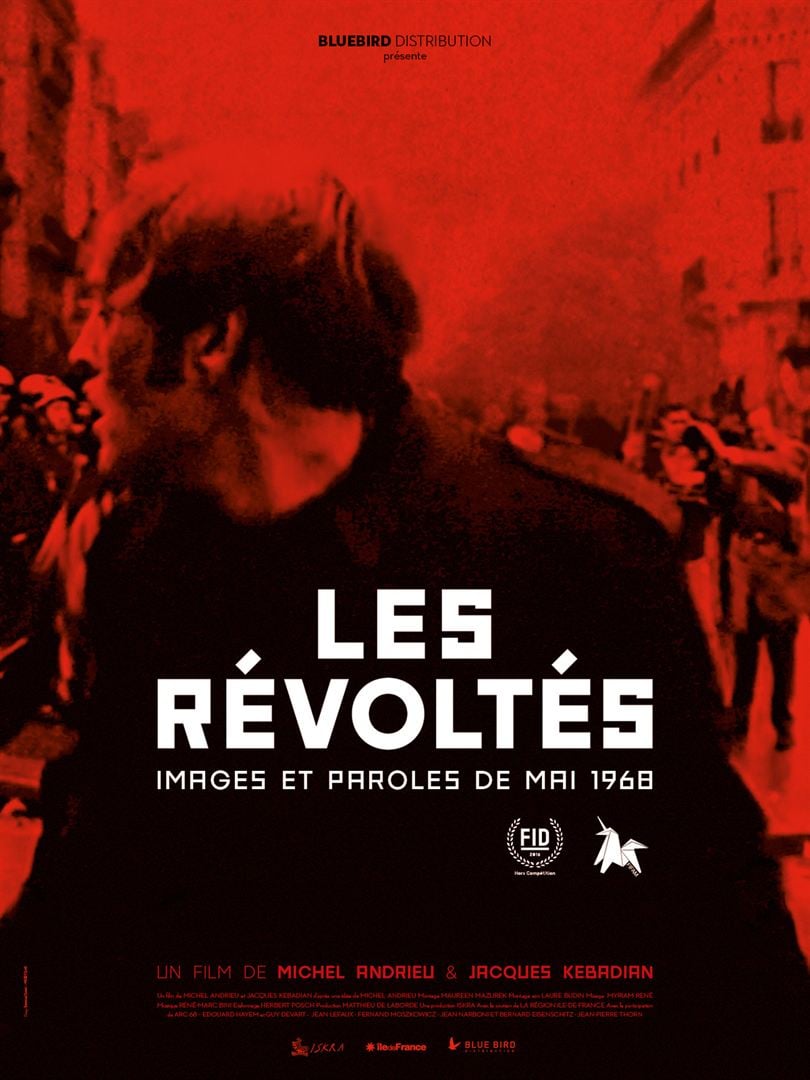 Michel Andrieu et Jacques Kebadian avaient réalisé en 1968 plusieurs courts-métrages au sein du collectif ARC 68. Certains étaient même sortis en salles en 1978 sous le titre Mai par lui-même.
Michel Andrieu et Jacques Kebadian avaient réalisé en 1968 plusieurs courts-métrages au sein du collectif ARC 68. Certains étaient même sortis en salles en 1978 sous le titre Mai par lui-même. Tom est anorexique. Neil est psychotique. Ils se rencontrent, tombent amoureux, s’enfuient de l’institution spécialisée où Tom est placée sous un étroit régime de surveillance. Ils rêvent de quitter Israël pour l’Europe.
Tom est anorexique. Neil est psychotique. Ils se rencontrent, tombent amoureux, s’enfuient de l’institution spécialisée où Tom est placée sous un étroit régime de surveillance. Ils rêvent de quitter Israël pour l’Europe.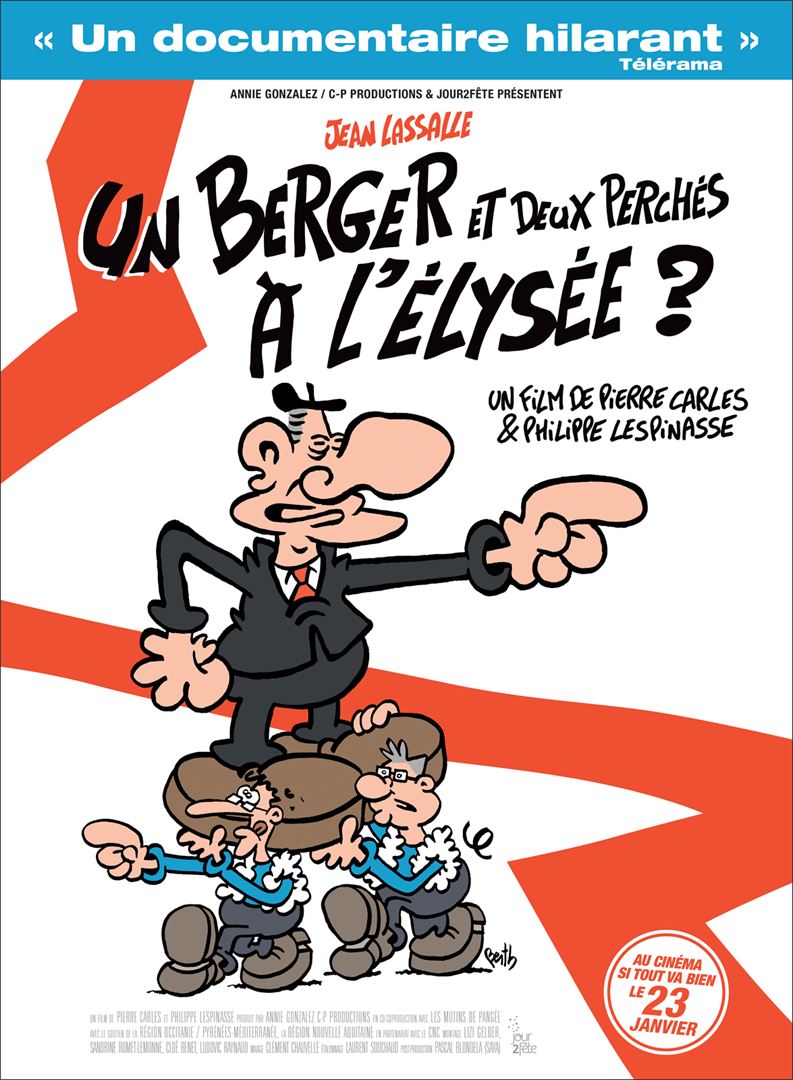 En 2016, Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques décide de se lancer dans la course à la présidence de la République. Deux réalisateurs l’accompagnent.
En 2016, Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques décide de se lancer dans la course à la présidence de la République. Deux réalisateurs l’accompagnent. Earl Stone (Clint Eastwood) a consacré sa vie à son entreprise d’horticulture quitte à y sacrifier sa famille : sa femme (Dianne Wiest), sa fille (Alison Eastwood) ne le lui ont pas pardonné. Mais, avec le développement du commerce en ligne, son entreprise périclite. Aussi accepte-t-il sans trop y regarder la proposition que lui fait un cartel mexicain : convoyer des livraisons de drogue de plus en plus importantes entre le Texas et l’Illinois.
Earl Stone (Clint Eastwood) a consacré sa vie à son entreprise d’horticulture quitte à y sacrifier sa famille : sa femme (Dianne Wiest), sa fille (Alison Eastwood) ne le lui ont pas pardonné. Mais, avec le développement du commerce en ligne, son entreprise périclite. Aussi accepte-t-il sans trop y regarder la proposition que lui fait un cartel mexicain : convoyer des livraisons de drogue de plus en plus importantes entre le Texas et l’Illinois. En 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen), un Italien du Bronx, est embauché comme chauffeur par Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste de concert, pour une tournée dans le Sud ségrégationniste.
En 1962, Tony Lip (Viggo Mortensen), un Italien du Bronx, est embauché comme chauffeur par Don Shirley (Mahershala Ali), un pianiste de concert, pour une tournée dans le Sud ségrégationniste. C’est l’été dans un camping au bord de la Dordogne. Une rumeur court : une panthère en liberté dans les bois s’attaque aux hommes. Elle en aurait déjà tué un l’an passé et serait peut-être la cause de la disparition de deux autres.
C’est l’été dans un camping au bord de la Dordogne. Une rumeur court : une panthère en liberté dans les bois s’attaque aux hommes. Elle en aurait déjà tué un l’an passé et serait peut-être la cause de la disparition de deux autres.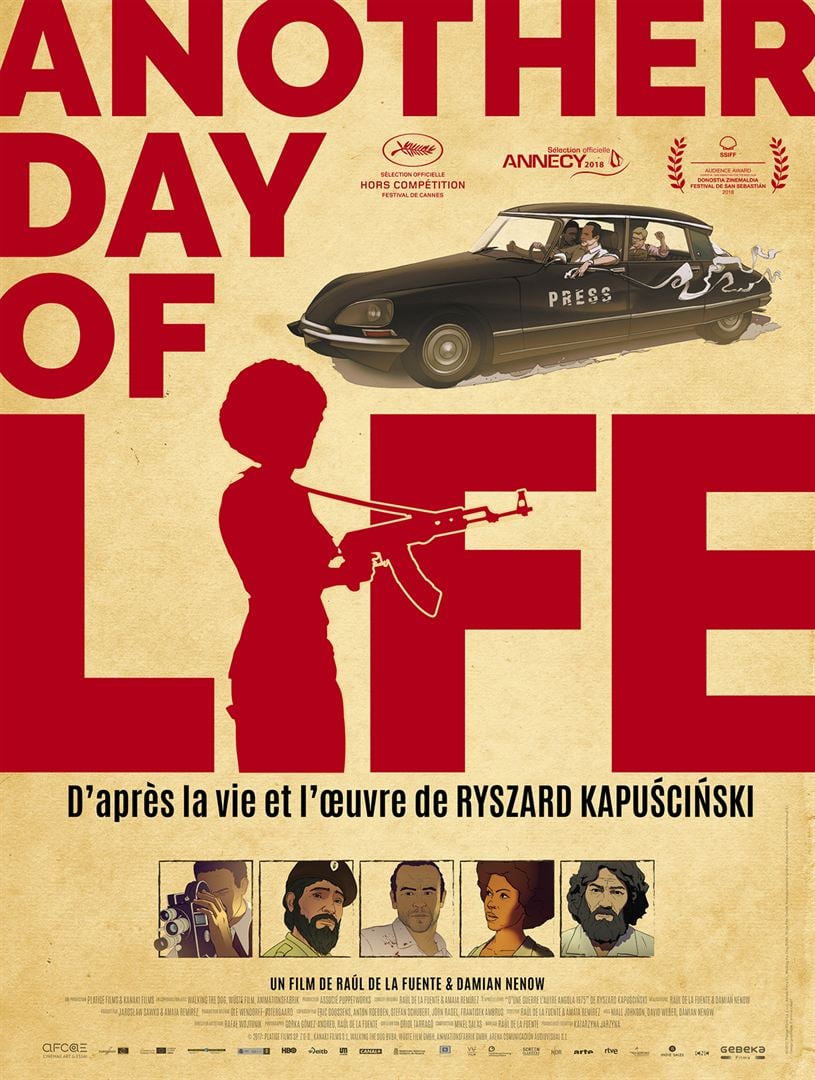 En 1975, le Portugal quitte ses colonies africaines. La date de l’indépendance de l’Angola est fixée au 11 novembre. Deux mouvements se disputent le pouvoir : le MPLA d’obédience communiste et l’UNITA soutenue par les Américains.
En 1975, le Portugal quitte ses colonies africaines. La date de l’indépendance de l’Angola est fixée au 11 novembre. Deux mouvements se disputent le pouvoir : le MPLA d’obédience communiste et l’UNITA soutenue par les Américains. Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène.
Simon (Jérémie Renier) est pneumologue à l’hôpital. Il est aimé et respecté de tous : de ses collègues qui admirent son professionnalisme, des malades avec qui il sait garder la bonne distance, du personnel soignant dont il partage les conditions de travail pas toujours faciles, de l’interne (Zita Henrot) qui a pour lui les yeux de Chimène. Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte.
Un savant fou (Michel Fau) terré dans un sous-marin veut créer « l’androgyne », l’homme et la femme réunis dans un couple idéal. Il a identifié deux cobayes : Dolorès Rivers (Arielle Dombasle), une réalisatrice de films, et Nicolas Atlante (Nicolas Ker), un chanteur de rock. Avec l’aide de trois producteurs, il convainc la première de recruter le second pour son prochain film qui sera tourné à Venise et en Égypte.