
André Gil Mata est un réalisateur portugais formé à la Film Factory de Béla Tarr, l’immense réalisateur hongrois aux films aussi longs (Le Tango de Satan dure sept heures trente) qu’hypnotisants. Si on rajoute que Mata se revendique des influences d’Andrei Tarkovski, de Chantal Akerman et de Manoel de Oliveira, son célèbre compatriote, on imagine à quel niveau d’exigence son cinéma se hisse.
À la lueur de la chandelle m’a inspiré des sentiments radicalement contradictoires. La lecture de l’excellente critique de Mathieu Macheret (c’est un pléonasme car toutes les critiques de Mathieu Macheret sont excellentes et leurs lectures sont pour moi une leçon d’humilité) m’avait mis en garde. N’étant pas un grand fan du cinéma contemplatif, j’aurais dû me méfier d’un film « presque impossible à raconter tant il se refuse à toute certitude narrative » et je n’aurais pas dû conclure trop vite « l’étrange et stimulant pacte d’hermétisme (au sens ésotérique) que le cinéaste noue avec son spectateur ».
Le visionnage fut une purge. De la première à la dernière minute, je me suis ennuyé comme un rat mort (comment diable un rat mort peut-il s’ennuyer ?). Chaque plan, étendu jusqu’au sadisme, a produit sur moi une irritation croissante, voire une hilarité difficilement contenue. Chaque silence d’un film quasiment muet – c’est le chat qu’on entend le plus – m’a semblé peser des tonnes. Paradoxalement, dans un film où il ne se passe quasiment rien, je n’ai pas compris grand chose, ne réussissant pas à identifier les différents personnages ni à saisir à quel âge de leur vie ils étaient filmés. Bref, je suis sorti de la salle en fulminant et en jurant qu’on ne m’y reprendrait pas (même si, évidemment, je suis allé voir dès le lendemain un film ouzbek sur un couple de vieux paysans).
Mais, après y avoir réfléchi, après m’être documenté, après avoir laissé mon irritation retomber, j’ai changé d’avis sur ce film exigeant. J’ai compris l’intention proustienne de l’auteur : faire revivre, sans s’attacher à la linéarité du récit, sans rien corriger de la confusion nébuleuse dans laquelle ils persistent, les souvenirs d’une vie attachée à la maison qui en fut le cadre.
Car – j’aurais peut-être dû commencer par là – À la lueur de la chandelle est une biographie. Celle de la propre grand-mère du réalisateur, prénommée Alziria. Toute sa vie durant, jusqu’à sa mort en 2008, cette femme très pieuse a habité dans une grande maison bourgeoise du nord du Portugal. Une domestique brésilienne, Beatriz, l’a servie pendant près de soixante ans. Pour raconter cette vie immobile, Mata use d’un procédé exigeant et déroutant. Sans jamais quitter cette maison, sinon pour quatre promenades circulaires dans le jardin qui rythment le temps qui passe au clocher de l’église et les saisons qui se succèdent, il filme de longs plans silencieux des deux vieilles femmes qui se regardent en chiens de faïence et auxquelles reviennent des souvenirs enfouis.
On voit Alziria plus jeune, avec ses parents, pratiquant le piano et la peinture, mais sacrifiant toute ambition artistique et professionnelle, à un mariage sans amour et à l’éducation de ses enfants.
Vu sous cet angle, À la lueur de la chandelle est autrement plus intelligent et stimulant que l’impression que j’en avais en sortant de la salle. Il n’en reste pas moins que son visionnage fut une épreuve douloureuse dont je peinerai à me remettre.


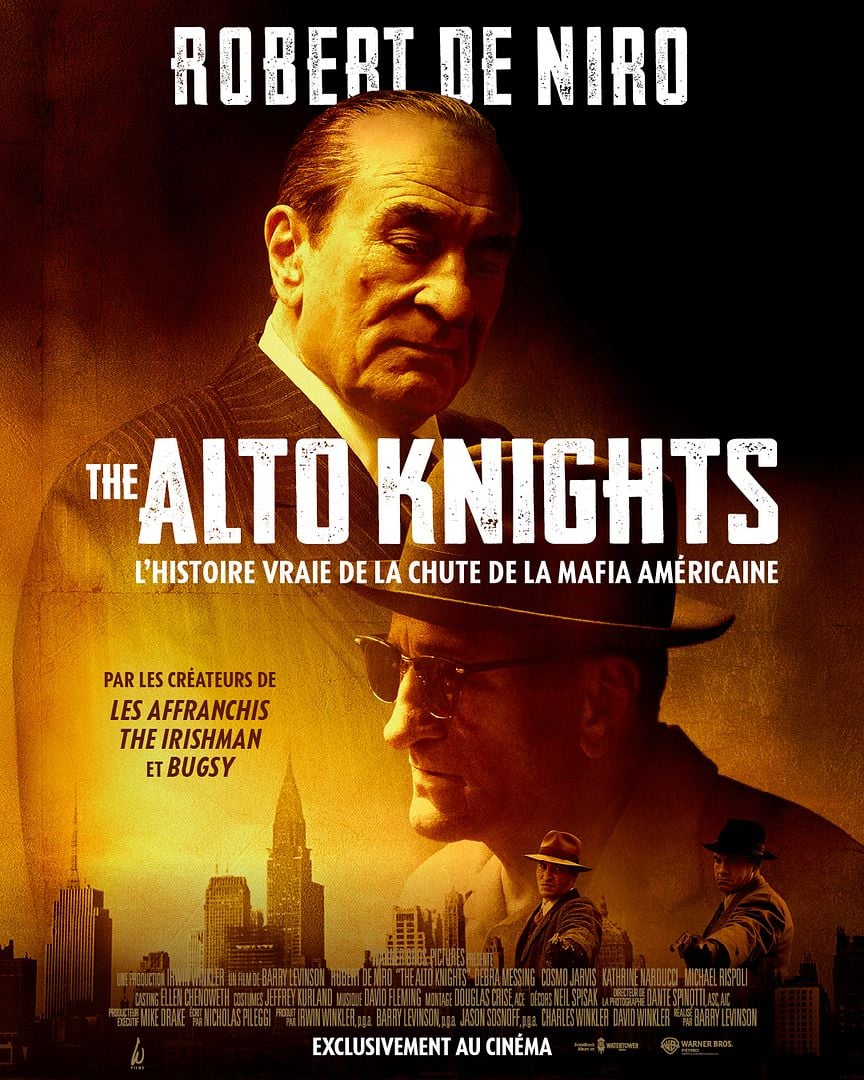
 Elisabeth est convoquée à l’école de son fils, Armand, six ans. Sarah et Anders accusent l’enfant d’avoir agressé leur fils Jon. La maîtresse des deux enfants est une jeune institutrice inexpérimentée et pleine de bonnes intentions qui essaie d’assurer une médiation entre les trois adultes. Vite dépassée par leur hostilité, elle passe le relais au directeur de l’école.
Elisabeth est convoquée à l’école de son fils, Armand, six ans. Sarah et Anders accusent l’enfant d’avoir agressé leur fils Jon. La maîtresse des deux enfants est une jeune institutrice inexpérimentée et pleine de bonnes intentions qui essaie d’assurer une médiation entre les trois adultes. Vite dépassée par leur hostilité, elle passe le relais au directeur de l’école.
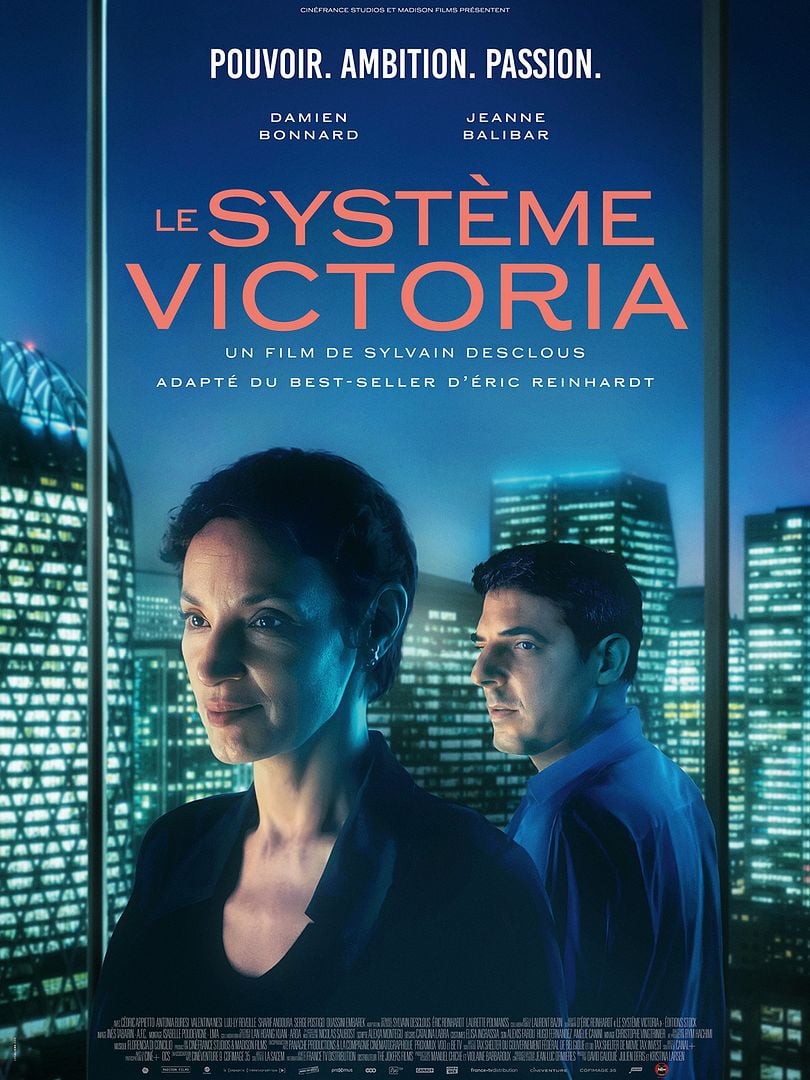

 Inquiet d’une tache qu’un premier IRM a révélée, le célèbre essayiste Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) en passe un deuxième dans un grand hôpital parisien. Il y croise le professeur Augustin Masset qui lui fait visiter le service de soins palliatifs qu’il dirige. Il lui raconte les patients qui y ont défilé. Entre l’homme de lettres et le médecin pétri d’humanisme, une amitié se noue.
Inquiet d’une tache qu’un premier IRM a révélée, le célèbre essayiste Fabrice Toussaint (Denis Podalydès) en passe un deuxième dans un grand hôpital parisien. Il y croise le professeur Augustin Masset qui lui fait visiter le service de soins palliatifs qu’il dirige. Il lui raconte les patients qui y ont défilé. Entre l’homme de lettres et le médecin pétri d’humanisme, une amitié se noue. Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés.
Obstétricienne dans un petit hôpital au fin fond de la Géorgie, Nina voit sa responsabilité mise en cause après le décès d’un nouveau-né. Une enquête administrative est confiée à l’un de ses collègues qui se révèle avoir été son amant. Parallèlement, Nina se déplace dans les campagnes et y pratique des avortements clandestins lorsque les délais légaux de l’IVG sont dépassés. Cathy Tuche (Isabelle Nanty) est fascinée par la famille royale. L’occasion lui est enfin donnée de se rendre en Angleterre lorsque son petit-fils est sélectionné par la pépinière de jeunes talents d’Arsenal. Son mari, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa mère et ses trois enfants l’accompagnent dans ce nouveau voyage.
Cathy Tuche (Isabelle Nanty) est fascinée par la famille royale. L’occasion lui est enfin donnée de se rendre en Angleterre lorsque son petit-fils est sélectionné par la pépinière de jeunes talents d’Arsenal. Son mari, Jeff Tuche (Jean-Paul Rouve), sa mère et ses trois enfants l’accompagnent dans ce nouveau voyage.