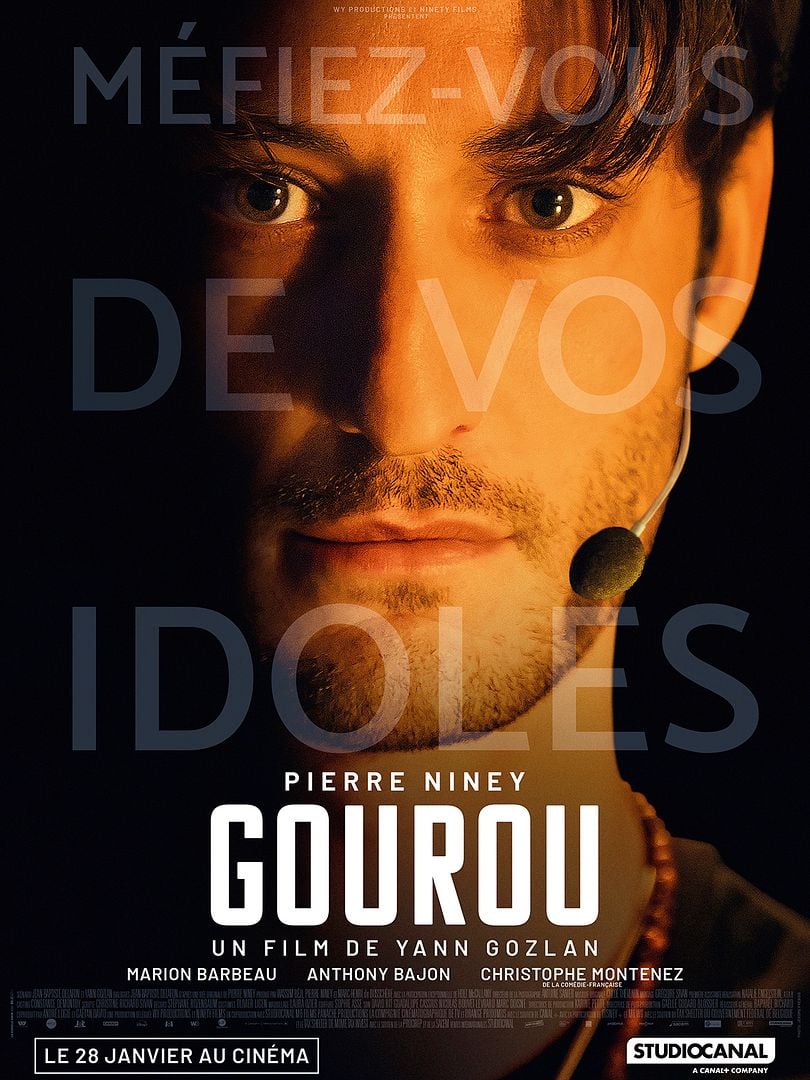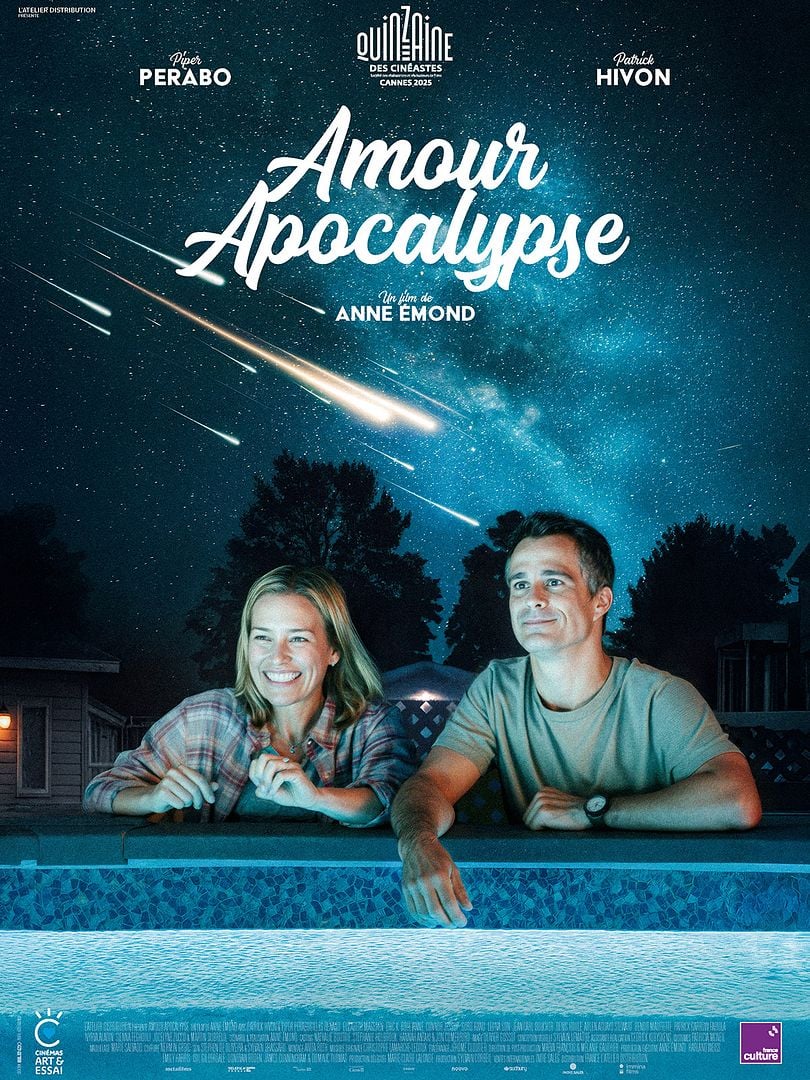Mariano De Santis (Toni Servillo) vit les derniers mois de son mandat à la présidence de l’Italie. Cet éminent juriste, immensément respecté, a perdu sa femme et en nourrit un inconsolable chagrin. Il se repose sur sa fille qui travaille à ses côtés au Quirinal. Avant de quitter ses fonctions, il doit encore prendre trois décisions : signer ou pas la loi sur l’euthanasie qui choque ses convictions catholiques, accorder ou pas la grâce à deux meurtriers, un homme qui a abrégé les souffrances de sa femme atteinte d’Alzheimer et une femme qui a assassiné de sang-froid son mari qui la battait.
Paolo Sorrentino est de retour avec son acteur fétiche, Toni Servillo. Voilà de quoi mettre l’eau à la bouche à tous ceux – et ils sont nombreux – qui ont aimé Il Divo (2008), La grande bellezza (2013) ou Silvio et les autres (2018). Certes le grand réalisateur italien avait eu un gros coup de mou avec son dernier film Parthenope, long clip vidéo sur papier glacé co-réalisé par l’office de tourisme de Naples et Esquire. Mais, comme la bande-annonce de La grazia l’avait laissé augurer, il revient en grande forme.
Si on n’y accroche pas ses deux heures treize pourront sembler bien ennuyeuses. Mais je suis vite tombé sous le charme de ce film immobile et en suis ressorti hypnotisé et ravi.
À rebours de l’image qu’on se fait de la vie d’un chef de l’Etat, celle que mène Mariano De Santis est d’un profond ennui. Pas de voyages à l’étranger, de discussions politiques enfiévrées, de dîners officiels, rien que les couloirs silencieux du Quirinal où ce bourreau de travail a arrêté de travailler, laissant à sa fille et à quelques hauts fonctionnaires dévoués les rênes de l’Etat. Son intelligence adamantine lui suffit pour comprendre les dossiers les plus complexes et lui laisse du temps pour se perdre dans ses souvenirs et fumer en cachette de sa fille une cigarette sur la terrasse du Quirinal. Tout au plus s’autorise-t-il une sortie à la Scala où il est ovationné.
J’ai reproché par le passé l’outrance de Sorrentino. Ainsi, je fais partie de ceux, peu nombreux, qui trouvent à redire à La grande bellezza. On retrouve la trace de ce cinéma dans La grazia, par exemple dans sa musique. Mais ici, tout est plus feutré, plus sobre, moins tapageur. L’exercice de l’Etat – pour reprendre le titre d’un film français à mon sens surcoté – y est décrit sinon avec plus de réalisme du moins avec moins d’esbrouffe.
Ce qui m’a particulièrement touché dans La grazia est une forme de réhabilitation discrète du politique. Ce film réhabilite la fonction présidentielle, loin des caricatures qu’on en voit ces temps-ci de l’autre côté de l’Atlantique, une manière de l’exercer élégante, intelligente, soucieuse de l’intérêt général, dénuée de vulgarité et de démagogie.