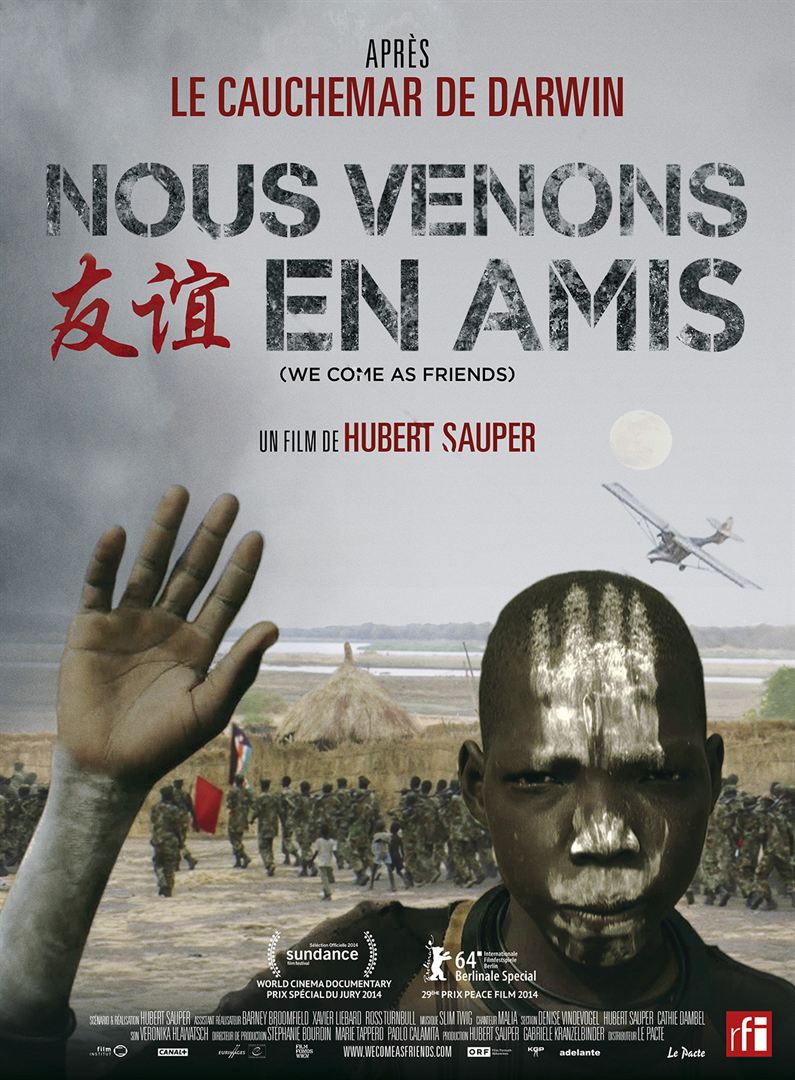Je place les frères Dardenne au sommet. Au sommet de mon palmarès personnel : « Rosetta », « Le Silence de Lorna », « Le Gamin au vélo » figurent parmi mes films préférés. Au sommet, je crois aussi, de la cinématographie de ce début de siècle. Je prends le pari que, dans un siècle, leurs noms seront cités parmi la dizaine de réalisateurs marquants de notre temps.
Je place les frères Dardenne au sommet. Au sommet de mon palmarès personnel : « Rosetta », « Le Silence de Lorna », « Le Gamin au vélo » figurent parmi mes films préférés. Au sommet, je crois aussi, de la cinématographie de ce début de siècle. Je prends le pari que, dans un siècle, leurs noms seront cités parmi la dizaine de réalisateurs marquants de notre temps.
Aussi chacun de leur film est-il un événement que j’attends avec une impatience joyeuse.
Celui-ci ne m’a pas étonné tant il ressemble aux précédents.
Par son cadre d’abord : les bords de la Meuse à Liège, une fois encore, gris et laids, mais filmés sans misérabilisme.
Par son héroïne ensuite : une femme, seule, de chaque plan, constamment en mouvement, souvent filmée de dos, mue par une idée fixe. Emilie Duquenne dans « Rosetta », Cécile de France dans « Le Gamin au vélo », Marion Cotillard dans « Deux jours, une nuit ».
Par son titre également : un titre court, qui claque et qui prétend, par sa brièveté même, à l’universel.
Par le dilemme moral qu’il pose : Olivier Gourmet acceptera-t-il l’apprenti qui a provoqué la mort de son fils (« Le Fils ») ? Lorna abusera-t-elle l’homme qu’elle doit épouser pour régulariser sa situation administrative (« Le Silence de Lorna ») ? Marion Cotillard convaincra-t-elle ses collègues de renoncer à leur prime pour qu’elle garde leur emploi (« Deux jours, une nuit ») ?
Dans « La Fille inconnue », les frères Dardenne posent une question pour y répondre immédiatement. Pouvons-nous rester indifférents à la misère du monde ? La réponse est évidemment négative. La mystérieuse inconnue, qui vient frapper à vingt heures passé à la porte du cabinet du docteur Davin et qui trouve porte close, va obséder la jeune praticienne qui s’estime coupable de sa mort.
Mais « La Fille inconnue » est moins un film sur les réfugiés qui meurent anonymes dans nos rues, que sur la médecine et sa pratique. « Le Docteur » ou « La Consultation » – le titre d’un livre de Martin Winckler auquel le film des Dardenne emprunte énormément – aurait été plus approprié. Car c’est l’éthique du médecin que le film questionne : sa porte ouverte à la détresse physique et morale, ses gestes patients et compatissants, les connaissances qu’il doit mobiliser pour établir un diagnostic exact, la disponibilité de chaque instant.
« La Fille inconnue » est un film à montrer à tous ceux et celles qui se destinent au beau métier de médecin.
La bande-annonce
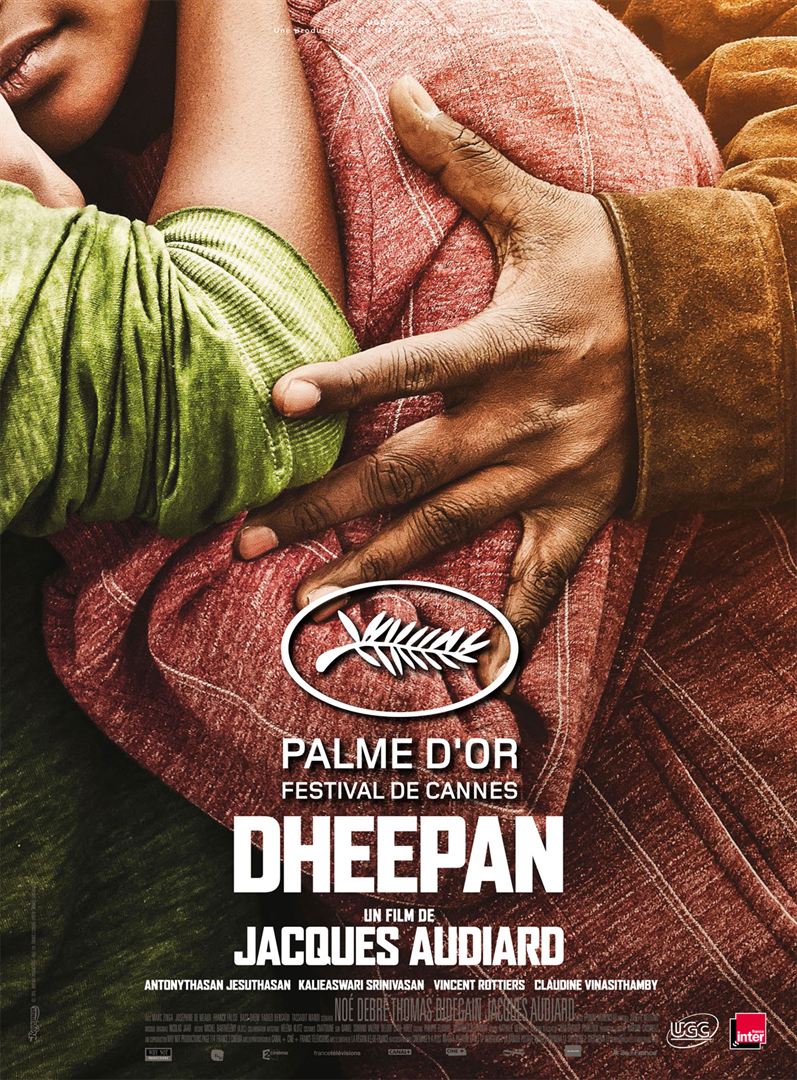 Le premier quart d’heure de Dheepan annonce un grand film. Jacques Audiard plante le décor et nous prend aux tripes en quelques plans : un rebelle tamoul démobilisé trouve dans un camp de réfugié une femme et une fille pour demander l’asile familial en France.
Le premier quart d’heure de Dheepan annonce un grand film. Jacques Audiard plante le décor et nous prend aux tripes en quelques plans : un rebelle tamoul démobilisé trouve dans un camp de réfugié une femme et une fille pour demander l’asile familial en France.
 Deux migrants (réfugiés ?) burkinabés traversent le Sahara et la Méditerranée au péril de leurs vies. Ils débarquent en Sicile et y survivent tant bien que mal. L’un se fond dans le système, acceptant un logement insalubre, un travail au noir et les railleries racistes des Italiens ; l’autre ne l’accepte pas et se révolte.
Deux migrants (réfugiés ?) burkinabés traversent le Sahara et la Méditerranée au péril de leurs vies. Ils débarquent en Sicile et y survivent tant bien que mal. L’un se fond dans le système, acceptant un logement insalubre, un travail au noir et les railleries racistes des Italiens ; l’autre ne l’accepte pas et se révolte. Le réalisateur : « On a besoin de 8 Meuros pour faire un film.
Le réalisateur : « On a besoin de 8 Meuros pour faire un film.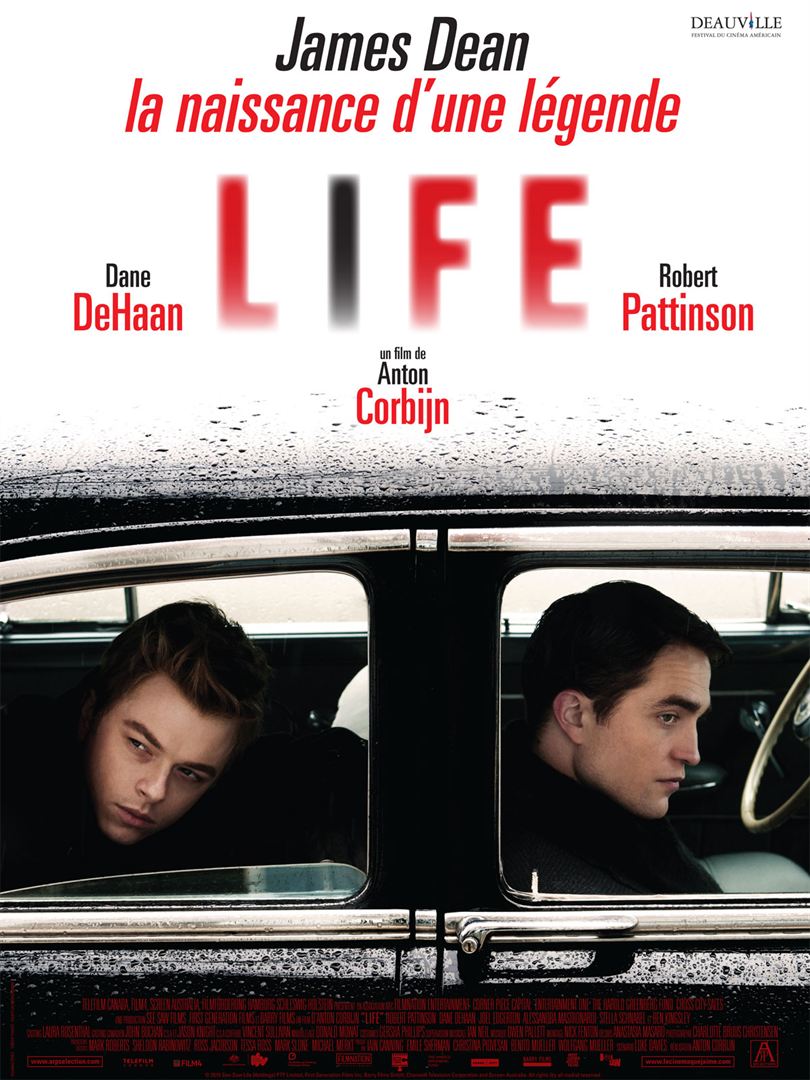 Conçu pour le 60ème anniversaire de la mort de James Dean, « Life » a pour personnage principal… le photographe de Life (oh ! subtile polysémie du titre) et non James Dean (oh ! subtil décentrage du propos). Ledit photographe est joué par Robert Pattinson (oh ! qu’il est subtil de faire jouer le rôle du paparazzi par la star sur-médiatisée de « Twilight »). Et James Dean par un acteur inconnu (oh que le chiasme est subtil ! la star est jouée par un inconnu et l’inconnu est joué par la star).
Conçu pour le 60ème anniversaire de la mort de James Dean, « Life » a pour personnage principal… le photographe de Life (oh ! subtile polysémie du titre) et non James Dean (oh ! subtil décentrage du propos). Ledit photographe est joué par Robert Pattinson (oh ! qu’il est subtil de faire jouer le rôle du paparazzi par la star sur-médiatisée de « Twilight »). Et James Dean par un acteur inconnu (oh que le chiasme est subtil ! la star est jouée par un inconnu et l’inconnu est joué par la star). En 1970, l’homme le plus puissant du monde libre, Richard M. Nixon, reçoit à la Maison-Blanche la star la plus adulée de son temps, Elvis A. Presley. Que se sont-ils dits ? Probablement pas grand’chose. Mais cette rencontre mythique a stimulé l’imagination de Liza Johnson qui en a fait un film.
En 1970, l’homme le plus puissant du monde libre, Richard M. Nixon, reçoit à la Maison-Blanche la star la plus adulée de son temps, Elvis A. Presley. Que se sont-ils dits ? Probablement pas grand’chose. Mais cette rencontre mythique a stimulé l’imagination de Liza Johnson qui en a fait un film. Je place les frères Dardenne au sommet. Au sommet de mon palmarès personnel : « Rosetta », « Le Silence de Lorna », « Le Gamin au vélo » figurent parmi mes films préférés. Au sommet, je crois aussi, de la cinématographie de ce début de siècle. Je prends le pari que, dans un siècle, leurs noms seront cités parmi la dizaine de réalisateurs marquants de notre temps.
Je place les frères Dardenne au sommet. Au sommet de mon palmarès personnel : « Rosetta », « Le Silence de Lorna », « Le Gamin au vélo » figurent parmi mes films préférés. Au sommet, je crois aussi, de la cinématographie de ce début de siècle. Je prends le pari que, dans un siècle, leurs noms seront cités parmi la dizaine de réalisateurs marquants de notre temps.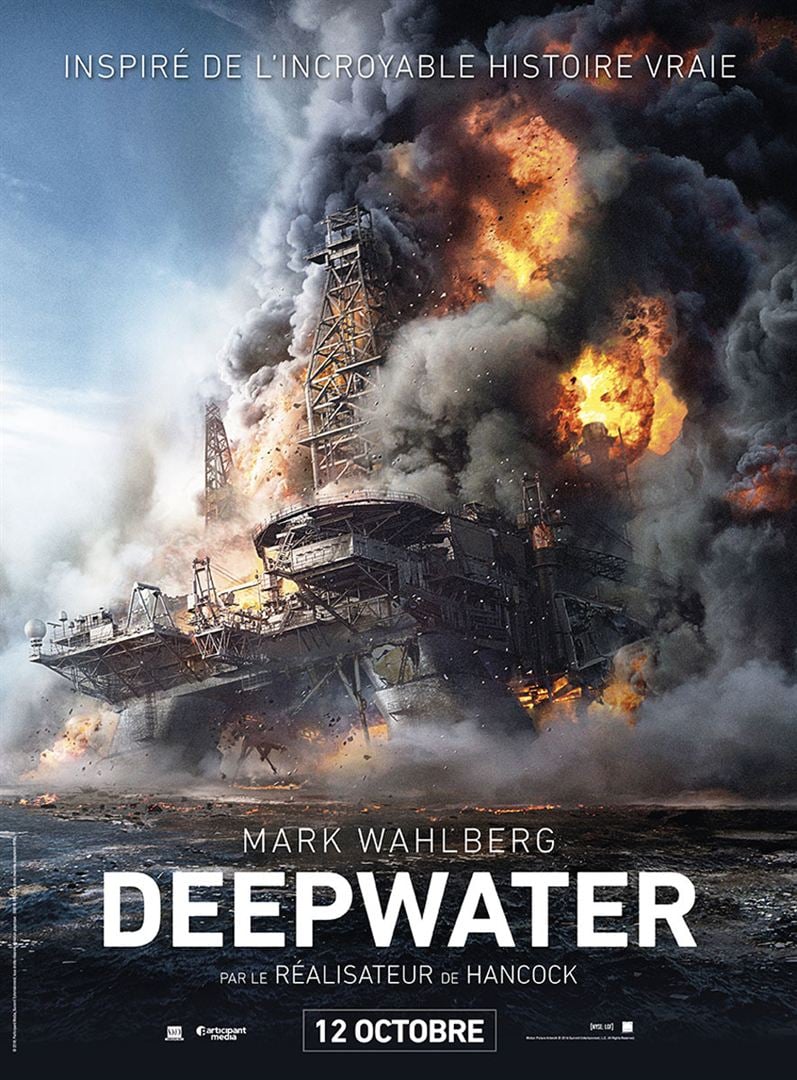
 Une Rosetta bulgare
Une Rosetta bulgare Un dupeur dopé (Libération ! Si tu me lis recrute moi !)
Un dupeur dopé (Libération ! Si tu me lis recrute moi !)