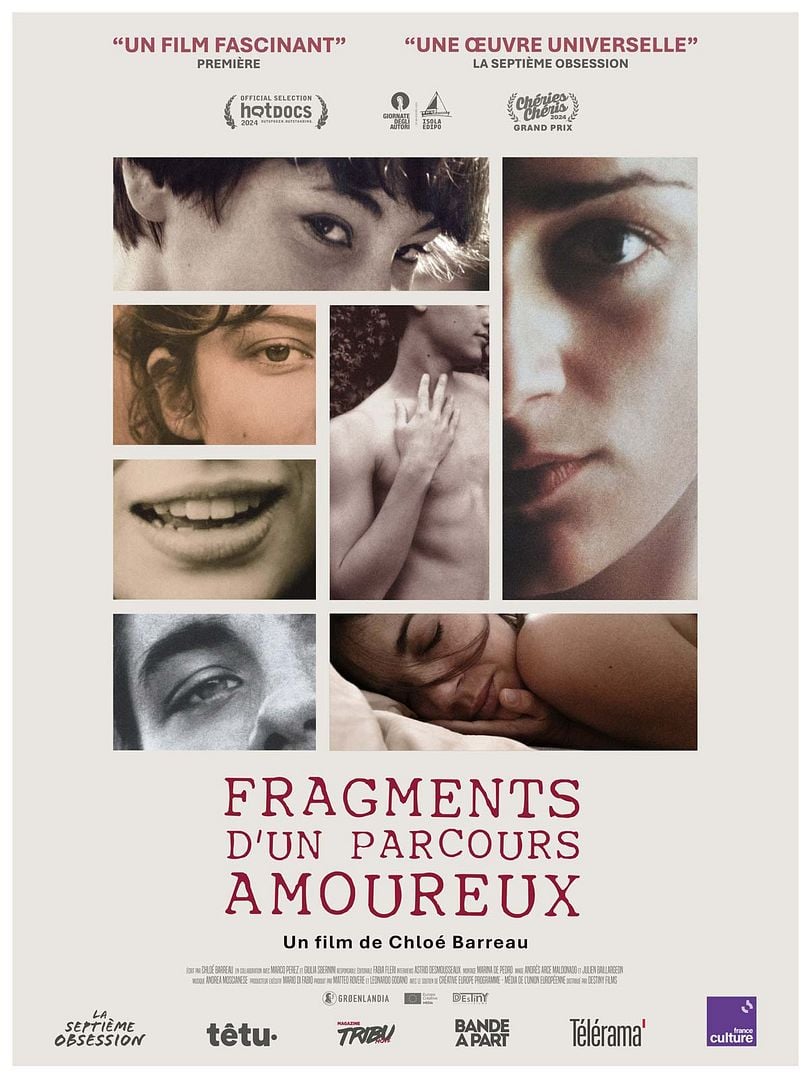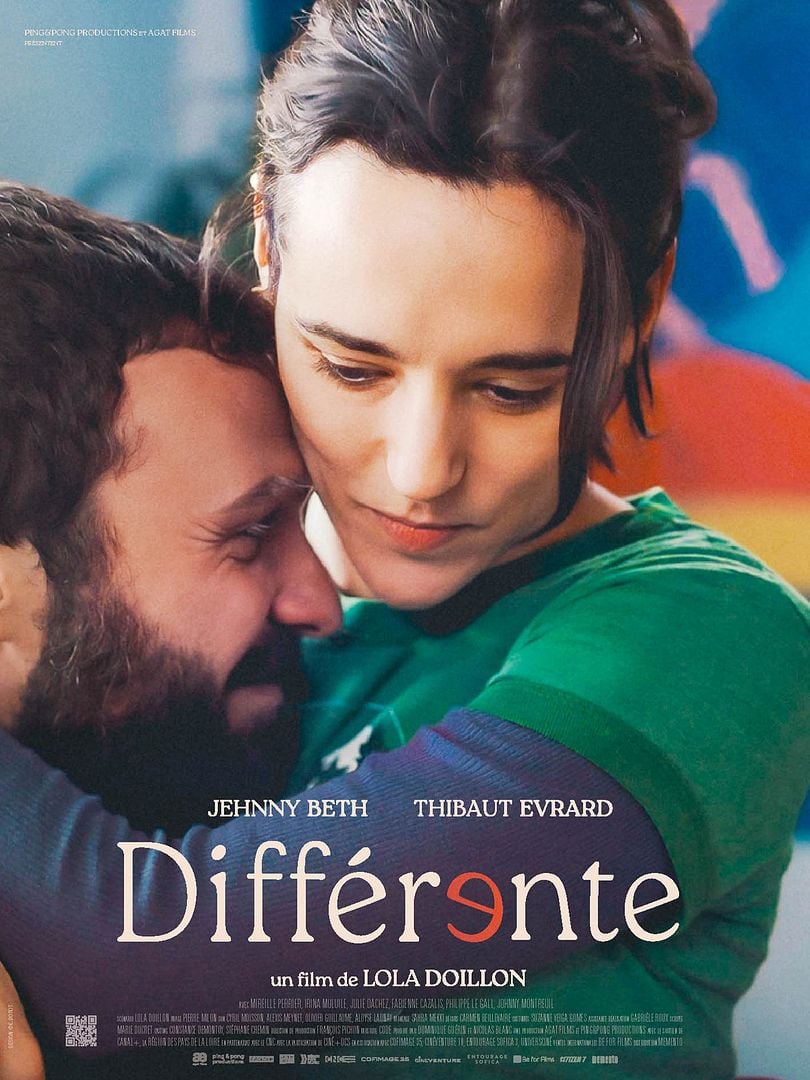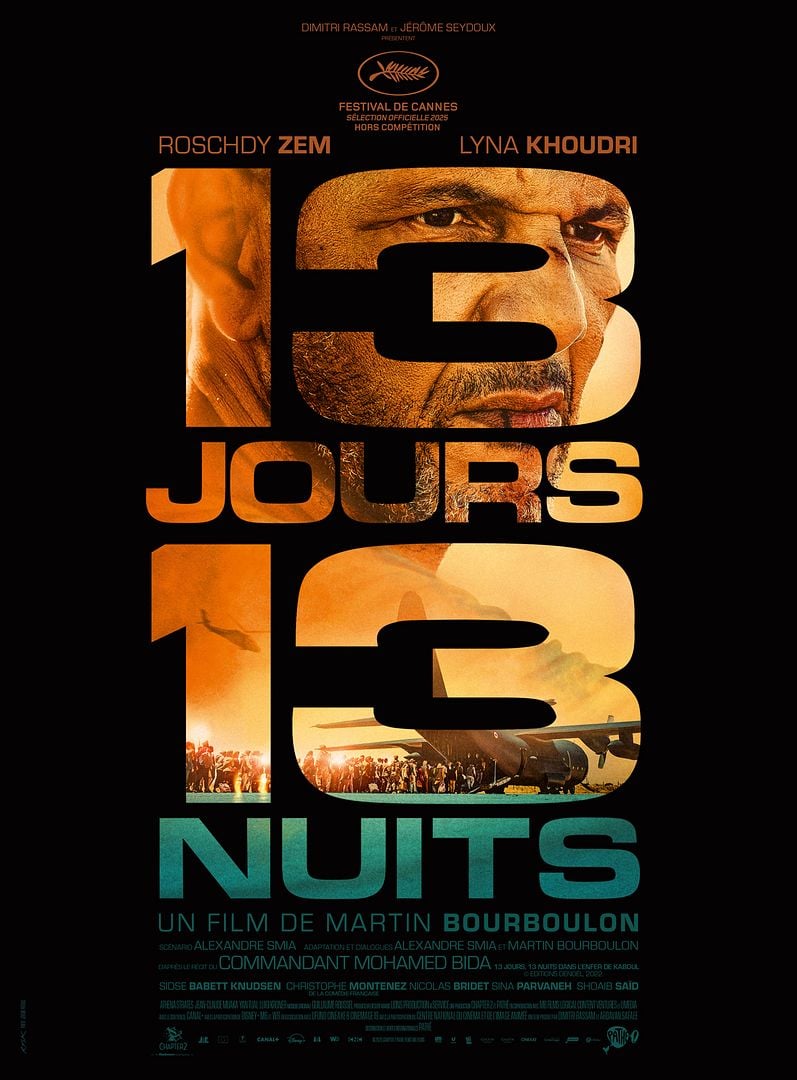Après la guerre de Troie et une longue odyssée, Ulysse (Ralph Fiennes) est enfin de retour à Ithaque, tiraillé par la culpabilité de sa si longue absence. Une foule de prétendants s’y pressent, attirés par la beauté et la richesse de Pénélope (Juliette Binoche) qui repousse la date de son nouveau mariage jusqu’à l’achèvement d’une tapisserie qu’elle coud le jour et découd la nuit tombée. Ils menacent de s’en prendre à Télémaque (Charlie Plummer), le fils de Pénélope et d’Ulysse. Avec la complicité du porcher Eumée (Claudio Santamaria), Ulysse se rend au palais déguisé en mendiant. Son chien le reconnaît, puis sa nourrice, la vieille Euryclée (Angela Molina). Pénélope invente une compétition pour départager ses prétendants.
La rumeur qui entourait ce film était si exécrable que j’ai bien failli ne pas aller le voir. Je l’ai trouvé beaucoup moins mauvais que je ne l’avais craint. Si je n’en avais rien entendu, l’aurais-je pour autant trouvé bon ?
Comme les mauvais vins produits de l’assemblage de cépages de la CEE, The Return est un film cosmopolite. Son réalisateur est italien (il n’a aucun lien de parenté avec Pier Paolo Pasolini mais est le neveu de Luchino Visconti et s’est fait connaître en 2013 avec Une belle fin). Ses deux têtes d’affiche sont anglaise et française. Le reste de la distribution est italienne, espagnole ou néerlandaise. Le film a été tourné en décors naturels en Grèce et en Italie.
Le résultat est très classique. Il n’est pas kitsch pour autant. Le budget de The Return est douze fois moindre que celui du prochain film de Christopher Nolan dont l’adaptation de l’Odyssée est attendue en salles à l’été 2026. Ici, pas d’effets spéciaux renversants mais une mise en scène théâtrale et appliquée, aussi fidèle au texte que possible. Le couple mythique du Patient anglais est reformé près de trente ans plus tard. Il est moins glamour que jadis mais toujours aussi talentueux – même si Juliette Binoche me sort par les yeux.