 En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu.
En 2045, l’humanité se morfond dans des villes surpeuplées et polluées. Pour échapper au quotidien, les habitants se réfugient dans des mondes parallèles. L’Oasis est le plus populaire. L’inventeur de cette réalité virtuelle vient de mourir à la tête d’une immense fortune. Il propose de la céder à qui trouvera « l’œuf de Pâques » qu’il a caché dans un recoin du jeu.
Wade Watts est un jeune orphelin qui, sous les traits de Parzival, joue régulièrement. Avec quelques amis virtuels, Aech, le colosse bricoleur, Art3mis, la jolie motarde, Daito, le samouraï et Sho, le guerrier ninja, il se lance dans la quête de l’œuf de Pâques. Mais Sorrento, le puissant directeur de la multinationale IOS , entend bien mettre la main sur le magot le premier.
Ready Player One a été accueilli par des louanges dithyrambiques. Du Monde à Libération, en passant par Télérama et Les Inrocks, la critique fait preuve d’un unanimisme suspect. Et les spectateurs ont réservé un accueil triomphal à Ready Player One qui a fait près d’un million d’entrées en France durant sa première semaine d’exploitation.
Les critiques ont salué en particulier, dans des articles qui résonnaient parfois comme autant d’éloges funèbres, le génie de Steven Spielberg. Nul doute qu’il mérite ses éloges au regard de son impressionnante filmographie qui accumule les chefs d’œuvre et les succès. Cette filmographie compte deux veines principales. La première, à laquelle Spielberg semblait s’être abonné ces dernières années, sont les grands films sérieux tournés avec un classicisme efficace : Pentagon Papers, Le Pont des Espions, Lincoln, Cheval de guerre, Munich, Il faut sauver le soldat Ryan, La Liste Schindler… La seconde, qu’il semblait au contraire avoir abandonnée, est destinée à un public plus jeune : E.T., Indiana Jones et ses suites, Jurassic Park… Ready Player One marquerait le retour de Spielberg à cette veine.
Et c’est bien là, à mon sens que le bât blesse. Car Ready Player One veut jouer sur les deux tableaux. D’un côté les références nostalgiques aux 80ies, aux jeunes années de Steven Spielberg (né en 1948… et qui n’était donc plus si jeune que cela) qu’on imagine volontiers fasciné par les premiers jeux Atari, par les films de Kubrick et les tubes de Van Halen, les Bee Gees, A-ha, Depeche Mode. De l’autre le film de science fiction, gonflé jusqu’à la gorge d’effets spéciaux et de combats épiques.
Ni l’un ni l’autre ne m’ont séduit. Je hais les années quatre-vingt – quand bien même elles coïncidèrent avec le vert paradis de mes amours enfantines – ses coloris marronnasses, ses musiques pop trop sucrées. Je hais les jeux vidéo d’hier et d’aujourd’hui auquel je n’ai jamais rien compris et auxquels je n’ai pas vraiment joué. J’ai trouvé par exemple la course automobile dont je lis qu’elle est « à couper le souffle » ennuyeuse à mourir, puis les allers-retours incessants entre le monde réel et l’univers virtuel d’Oasis incompréhensibles.
Que dire de l’histoire manichéenne au possible (un méchant très méchant dont on sait par avance que les sinistres machinations seront déjouées par des gentils très gentils) sinon qu’elle est d’une platitude achevée ? Cette chasse au trésor, découpée en trois étapes (trois clés doivent être découvertes pour accéder à l’œuf), fait irrésistiblement penser aux scénarios des jeux vidéo où il faut relever un défi pour accéder au niveau supérieur. Quant à la composition ethniquement équilibrée du « clan » de Wade/Perzival et à la romance téléphonée qui se noue entre le héros et la jolie motarde – dont les traits rappellent ceux des Minimoys de Luc Besson – soupirs…

 Qui était Marie Madeleine ? Ceux qui répondront : le titre d’une chanson de Sandra sorti en 1985 – et dont le clip vaut son pesant de cacahouètes – sont priés de se taire.
Qui était Marie Madeleine ? Ceux qui répondront : le titre d’une chanson de Sandra sorti en 1985 – et dont le clip vaut son pesant de cacahouètes – sont priés de se taire.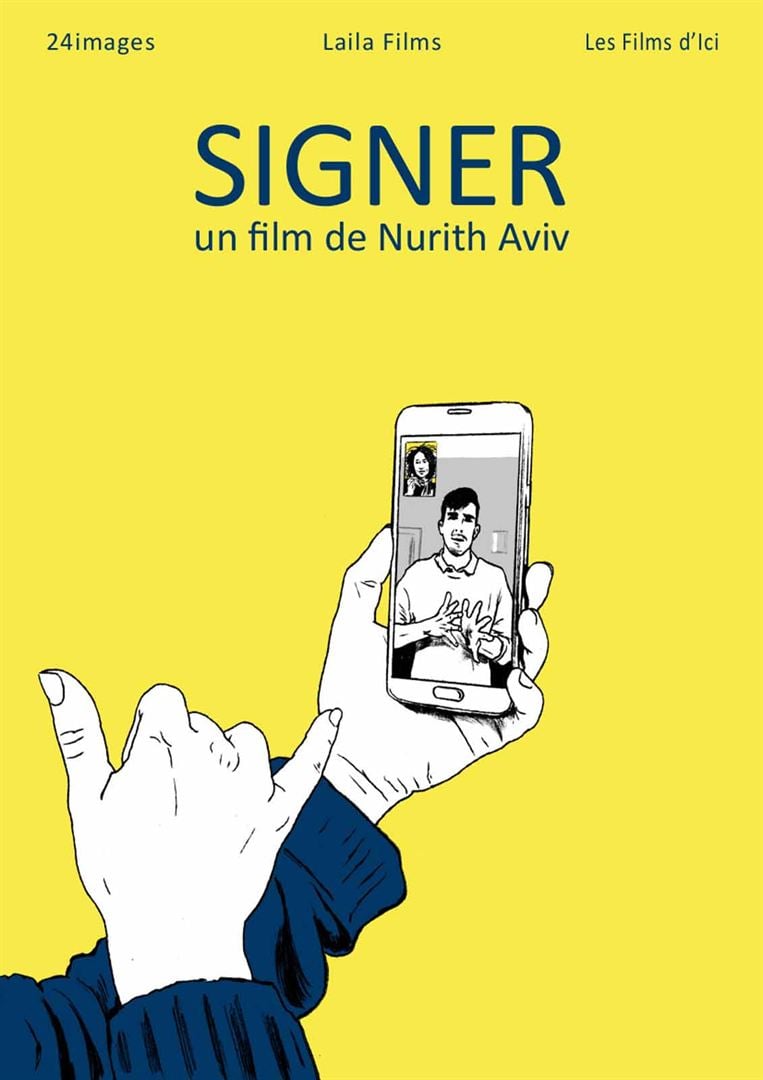 Le verbe signer est le plus souvent transitif : on signe un document, on y appose sa signature. Mais signer peut aussi être intransitif : parler en langue des signes. C’est dans cette seconde acception, plus rare chez les entendants, qu’il faut comprendre le titre du documentaire de Nurith Aviv.
Le verbe signer est le plus souvent transitif : on signe un document, on y appose sa signature. Mais signer peut aussi être intransitif : parler en langue des signes. C’est dans cette seconde acception, plus rare chez les entendants, qu’il faut comprendre le titre du documentaire de Nurith Aviv. Donald Crowhurst était un plaisancier du dimanche, un brin professeur Géo Trouvetou, qui se mit en tête de relever en 1968 le défi lancé par le Sunday Times : le tour du monde à la voile en solitaire sans escale. Il hypothèque sa maison pour construire à ses frais son bateau, un trimaran à une époque où les monocoques étaient de rigueur.
Donald Crowhurst était un plaisancier du dimanche, un brin professeur Géo Trouvetou, qui se mit en tête de relever en 1968 le défi lancé par le Sunday Times : le tour du monde à la voile en solitaire sans escale. Il hypothèque sa maison pour construire à ses frais son bateau, un trimaran à une époque où les monocoques étaient de rigueur. Trois extra-terrestres débarquent sur notre planète et prennent possession de trois corps humains : un homme marié au bord du divorce, une lycéenne et un adolescent espiègle. Leur objectif est sans concession et rappelle les scénarios canoniques de la SF : envahir la planète et annihiler ses habitants. Mais les moyens pour y parvenir sont paradoxalement doux : pour préparer cette invasion, il leur faut apprendre à connaître les humains en leur volant leurs concepts d’une simple pression du doigt sur la temps. Ainsi du concept de « liberté », de « propriété », de « travail », de « subjectivité » et d' »amour ».
Trois extra-terrestres débarquent sur notre planète et prennent possession de trois corps humains : un homme marié au bord du divorce, une lycéenne et un adolescent espiègle. Leur objectif est sans concession et rappelle les scénarios canoniques de la SF : envahir la planète et annihiler ses habitants. Mais les moyens pour y parvenir sont paradoxalement doux : pour préparer cette invasion, il leur faut apprendre à connaître les humains en leur volant leurs concepts d’une simple pression du doigt sur la temps. Ainsi du concept de « liberté », de « propriété », de « travail », de « subjectivité » et d' »amour ».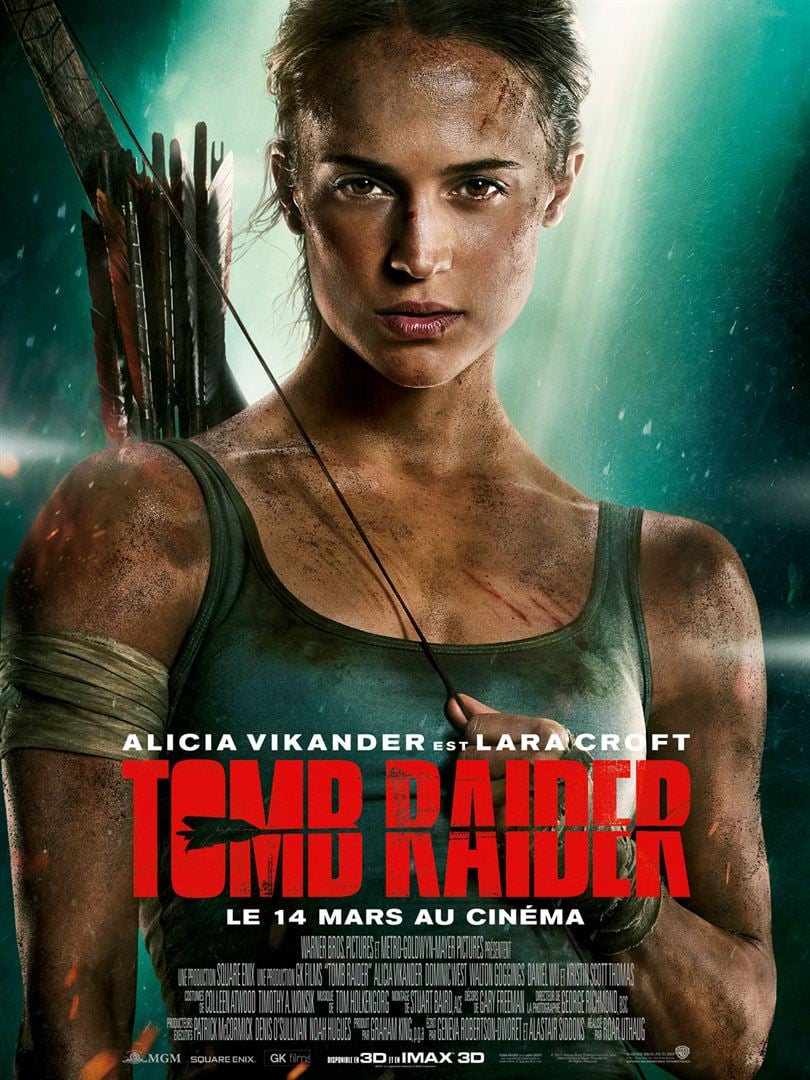 La vingtaine, jolie, sportive, intelligente, Lara Croft n’arrive pas à faire le deuil de son père, disparu dans de mystérieuses circonstances sept ans plus tôt. Il lui a laissé un empire mais elle se refuse à en reprendre la direction tant qu’elle n’aura pas élucidé les causes de son décès. C’est ainsi qu’elle prend la mer à Hong Kong vers une île mystérieuse, au large du Japon, où son père serait allé chercher la tombe d’une impératrice japonaise aux pouvoirs maléfiques.
La vingtaine, jolie, sportive, intelligente, Lara Croft n’arrive pas à faire le deuil de son père, disparu dans de mystérieuses circonstances sept ans plus tôt. Il lui a laissé un empire mais elle se refuse à en reprendre la direction tant qu’elle n’aura pas élucidé les causes de son décès. C’est ainsi qu’elle prend la mer à Hong Kong vers une île mystérieuse, au large du Japon, où son père serait allé chercher la tombe d’une impératrice japonaise aux pouvoirs maléfiques. En 2003 sort The Room, un film écrit, produit et réalisé à grands frais par Tommy Wiseau qui y joue le personnage principal. Le film est un nanar d’anthologie, si mauvais qu’il suscite une hilarité contagieuse et devient vite un film culte.
En 2003 sort The Room, un film écrit, produit et réalisé à grands frais par Tommy Wiseau qui y joue le personnage principal. Le film est un nanar d’anthologie, si mauvais qu’il suscite une hilarité contagieuse et devient vite un film culte. Margaux I (Agathe Bonitzer) a vingt-cinq ans, vit à Paris et ne sait pas trop que faire de sa vie. Margaux II (Sandrine Kiberlain) en a vingt de plus, habite Lyon et monte à Paris enterrer une vieille amie.
Margaux I (Agathe Bonitzer) a vingt-cinq ans, vit à Paris et ne sait pas trop que faire de sa vie. Margaux II (Sandrine Kiberlain) en a vingt de plus, habite Lyon et monte à Paris enterrer une vieille amie.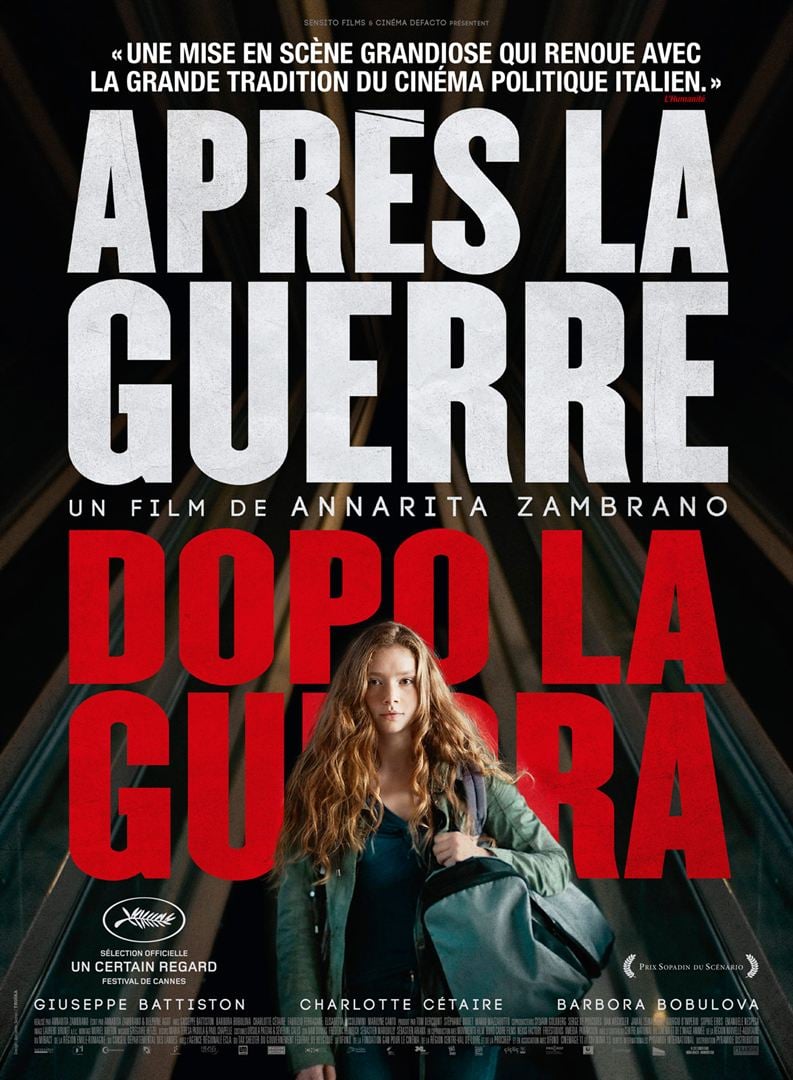 Marco est un militant d’extrême-gauche italien, réfugié en France dans les années quatre-vingts. La « doctrine Mitterrand » l’y protège d’une extradition vers l’Italie. Mais cet usage vacille quand un nouvel assassinat est commis à Bologne en 2002, par un groupuscule qui se réclame de sa mémoire.
Marco est un militant d’extrême-gauche italien, réfugié en France dans les années quatre-vingts. La « doctrine Mitterrand » l’y protège d’une extradition vers l’Italie. Mais cet usage vacille quand un nouvel assassinat est commis à Bologne en 2002, par un groupuscule qui se réclame de sa mémoire. Plus intéressé par le cinéma et la littérature que par ses cours à la faculté de médecine, Amin rentre de Paris passer l’été chez sa mère qui tient en famille un restaurant tunisien à Sète. Il retrouve son cousin Tony, un dragueur invétéré, son oncle Kamel, sa tante Camélia. Il retrouve aussi une amie d’enfance, Ophélie, dont le mariage imminent avec Clément ne l’empêche pas de coucher avec Tony. Sur la plage, Amin et Tony font la connaissance de deux touristes de passage, la blonde Céline et la brune Charlotte.
Plus intéressé par le cinéma et la littérature que par ses cours à la faculté de médecine, Amin rentre de Paris passer l’été chez sa mère qui tient en famille un restaurant tunisien à Sète. Il retrouve son cousin Tony, un dragueur invétéré, son oncle Kamel, sa tante Camélia. Il retrouve aussi une amie d’enfance, Ophélie, dont le mariage imminent avec Clément ne l’empêche pas de coucher avec Tony. Sur la plage, Amin et Tony font la connaissance de deux touristes de passage, la blonde Céline et la brune Charlotte.