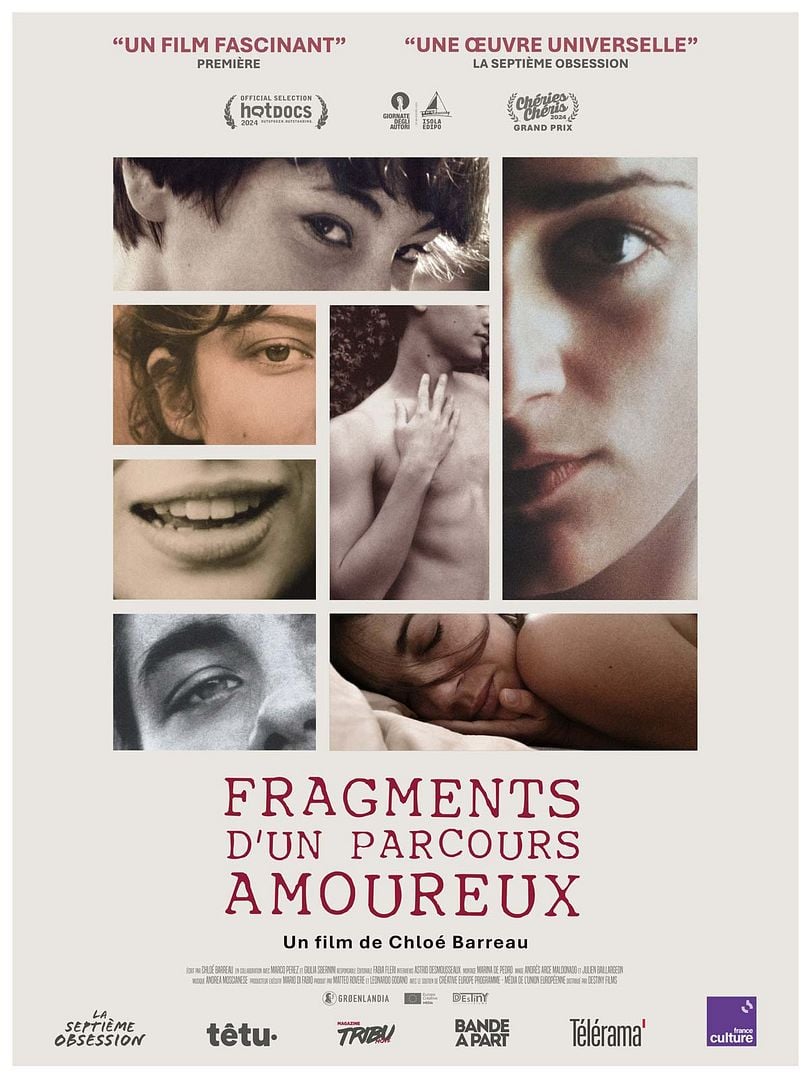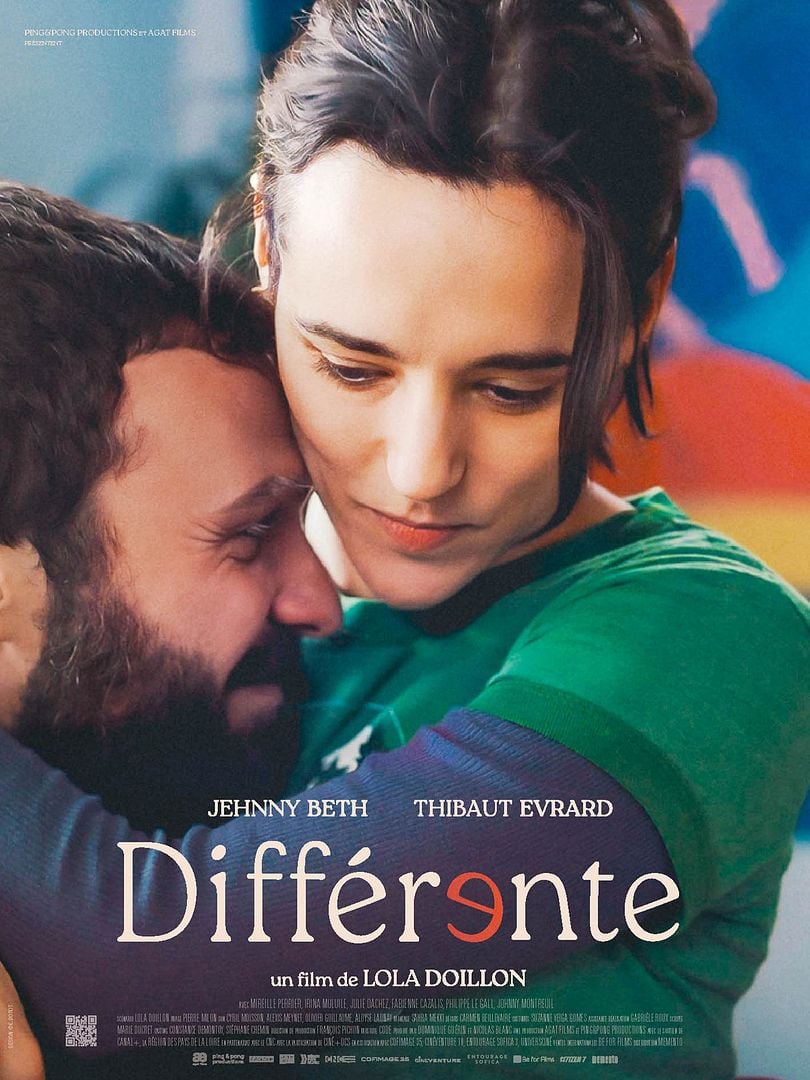Vicente a deux filles. Leur mère a obtenu leur garde et les élève en Californie. Mais chaque été, Violeta et Eva prennent l’avion pour le Nouveau-Mexique et viennent passer quelques semaines de vacances chez leur père.
In the Summers est le premier film, tourné sans stars, d’une réalisatrice américano-colombienne qui a puisé dans ses souvenirs d’enfance. Sa bande-annonce m’avait laissé craindre le pire : l’incontournable rédemption d’un père qui réussira à combattre les démons qui le rongent pour retrouver l’amour de ses filles qu’il aime si fort.
Mais, primé à Deauville et à Sundance, In the Summers est autrement plus subtil que le pathos gluant que je m’étais inventé.
Sur la forme : avec quasiment aucune indication de lieu (même si on parvient à comprendre que l’action se déroule dans une petite ville perdue du Nouveau-Mexique proche de la frontière) ni de temps, In the Summers laisse lentement se deviner son sujet : raconter une relation père-filles à travers quatre étés passés ensemble, sans rien dire des (longues) périodes qui les séparent. Lors du tout premier, Eva et Violeta sont encore des fillettes d’une dizaine d’années à peine. Lors du quatrième, elles sont devenues adultes.
Sur le fond : In the Summers est beaucoup plus ambigu qu’une happy end story. Il doit sa justesse à son personnage principal interprété par René Pérez Joglar alias Residente, rappeur portoricain connu sur la scène musicale, qui se révèle un acteur étonnant. Dès la première scène, au soin maniaque qu’il prend à rapetasser sa maison pour y recevoir ses filles, on perçoit son anxiété, son souci de bien faire, sa peur que ses addictions à l’alcool et à la drogue ne reprennent le dessus. On ne dira rien de plus sur la façon dont sa relation avec ses filles évolue d’un été à l’autre, sachant qu’on en a déjà peut-être trop dit en évoquant l’absence de happy end. Disons simplement que le film réussit à nous surprendre en évitant les rebondissements les plus convenus.
Dépourvu de tout pathos et de toute complaisance, In the summers surprend par l’originalité de sa construction et par la justesse de son ton.