 Ihjãc, un jeune Indien de la tribu des Kahrô, a le pouvoir de dialoguer avec les morts. Son père défunt lui intime d’organiser le Pàrcahàc, la cérémonie marquant la fin de son deuil. Mais Ihjãc ne veut pas devenir un chaman.
Ihjãc, un jeune Indien de la tribu des Kahrô, a le pouvoir de dialoguer avec les morts. Son père défunt lui intime d’organiser le Pàrcahàc, la cérémonie marquant la fin de son deuil. Mais Ihjãc ne veut pas devenir un chaman.
Il s’enfuit à la ville pour échapper à son destin, loin de sa femme et de son fils.
Mi-fiction, mi-documentaire, Le Chant de la forêt est d’abord un témoignage ethnographique comme en filmait Jean Rouch en Afrique occidentale dans les années cinquante. Les deux co-réalisateurs, un Portugais et une Brésilienne en couple à la ville, ont posé leur caméra dans un village indien au cœur du Cerrado. Ils en ont filmé les jours et les heures : les repas, les bains, les jeux et le Pàrcahàc, cette cérémonie censée marquer la fin du deuil et le départ définitif de l’esprit du défunt (comparable à la cérémonie des quarante jours dans l’Islam ou à celle marquant la fin du sheloshim dans le judaïsme).
C’est aussi un témoignage sur le sort que les Blancs réservent aux Indiens. Il ne s’agit pas ici d’opposer des Bons sauvages à des Blancs cruels. Quand Ihjãc va à la ville, il n’est en butte à aucun mauvais traitement. C’est plutôt une molle indifférence qui l’accueille, un refus de comprendre sa culture, une volonté cartésienne de soigner par la médecine le tourment qui l’habite.
Mais, au-delà de ce témoignage ethnographique, Le Chant de la forêt pose de belles questions universelles. La première concerne le travail de deuil : comment l’esprit du père de Ihjãc trouvera–t-il la paix et cessera-t-il de hanter les vivants ? La seconde touche à l’acceptation de son destin : Ihjãc deviendra-t-il chaman comme les esprits – et le vieux chaman qui sent sa fin prochaine et se cherche un remplaçant – l’y poussent.
Sur le papier, ce projet a de quoi séduire. Mais hélas le résultat est moins convainquant. Comme il fallait le redouter, la narration est d’une lenteur hypnotisante. Il ne se passe rien, ou pas grand-chose dans ce Chant de la forêt qui, passé les premières minutes d’un exotisme intriguant, peine à retenir l’intérêt du spectateur.

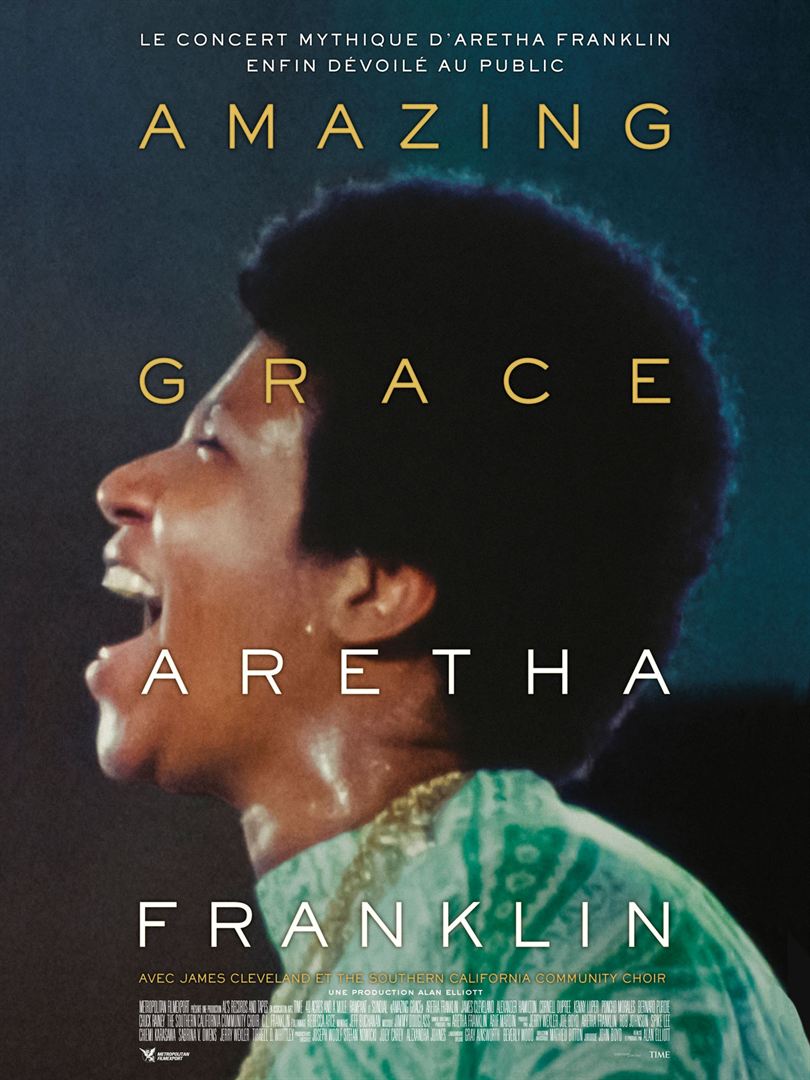
 Jeune couple aimant, Malte et Liv sont en vacances aux Baléares quand ils sont violemment agressés par trois jeunes. Malte prend un coup de couteau et, impuissant, assiste au viol de Liv.
Jeune couple aimant, Malte et Liv sont en vacances aux Baléares quand ils sont violemment agressés par trois jeunes. Malte prend un coup de couteau et, impuissant, assiste au viol de Liv. Salomé revient dans la région des Alpes où elle a grandi. Elle y a trouvé un job d’été dans une déchetterie quasiment tombée à l’abandon. Jess l’y rejoint bientôt qui vient d’être disqualifiée d’une émission de télé réalité.
Salomé revient dans la région des Alpes où elle a grandi. Elle y a trouvé un job d’été dans une déchetterie quasiment tombée à l’abandon. Jess l’y rejoint bientôt qui vient d’être disqualifiée d’une émission de télé réalité. Lee Israel (Melissa McCarthy) a cinquante ans passé. Elle vit seule avec son chat dans un appartement miteux de l’Upper East Side. Auteure de biographies à succès, sa renommée littéraire l’a quittée et, avec elle, sa compagne. Lee a vieilli, a grossi, s’est aigrie. Sans ressources, elle en est réduite à contrefaire des lettres d’écrivains célèbres pour les revendre à des bibliophiles.
Lee Israel (Melissa McCarthy) a cinquante ans passé. Elle vit seule avec son chat dans un appartement miteux de l’Upper East Side. Auteure de biographies à succès, sa renommée littéraire l’a quittée et, avec elle, sa compagne. Lee a vieilli, a grossi, s’est aigrie. Sans ressources, elle en est réduite à contrefaire des lettres d’écrivains célèbres pour les revendre à des bibliophiles. Le capitaine Pierre Perdrix (Swann Arlaud, César 2018, taillé un peu trop large pour lui, du meilleur acteur masculin) dirige, sans toujours se faire respecter, une brigade de gendarmerie perdue au fond des Vosges. Soutien de famille depuis la mort de son père, il vit avec sa mère (Fanny Ardant), son frère (Nicolas Maury) et la fille adolescente de celui-ci.
Le capitaine Pierre Perdrix (Swann Arlaud, César 2018, taillé un peu trop large pour lui, du meilleur acteur masculin) dirige, sans toujours se faire respecter, une brigade de gendarmerie perdue au fond des Vosges. Soutien de famille depuis la mort de son père, il vit avec sa mère (Fanny Ardant), son frère (Nicolas Maury) et la fille adolescente de celui-ci. Hollywood. Février 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a réussi à inscrire son nom en haut de l’affiche d’une série TV. Mais il redoute une gloire éphémère. Sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt) est aussi son chauffeur et son seul ami.
Hollywood. Février 1969. Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a réussi à inscrire son nom en haut de l’affiche d’une série TV. Mais il redoute une gloire éphémère. Sa doublure Cliff Booth (Brad Pitt) est aussi son chauffeur et son seul ami. Iya et Masha ont combattu dans les rangs de l’Armée rouge pendant la Seconde guerre mondiale. Surnommée « la girafe », Iya est une jeune femme sylphide embarrassée par son immense stature, une « longue perche » (Dylda en russe), une « tige de haricot » (Beanpole en anglais). La minuscule et rousse Masha a eu au front un enfant qu’elle a confiée aux bons soins de Iya dont les fréquentes crises de tétanie lui ont valu d’être démobilisée avant elle. Mais quand Masha revient à son tour à Leningrad et retrouve Iya dans l’hôpital militaire où celle-ci est désormais affectée au chevet de soldats lourdement handicapés, la réalité qu’elle découvre l’autorise à exiger de son amie un sacrifice exorbitant.
Iya et Masha ont combattu dans les rangs de l’Armée rouge pendant la Seconde guerre mondiale. Surnommée « la girafe », Iya est une jeune femme sylphide embarrassée par son immense stature, une « longue perche » (Dylda en russe), une « tige de haricot » (Beanpole en anglais). La minuscule et rousse Masha a eu au front un enfant qu’elle a confiée aux bons soins de Iya dont les fréquentes crises de tétanie lui ont valu d’être démobilisée avant elle. Mais quand Masha revient à son tour à Leningrad et retrouve Iya dans l’hôpital militaire où celle-ci est désormais affectée au chevet de soldats lourdement handicapés, la réalité qu’elle découvre l’autorise à exiger de son amie un sacrifice exorbitant. Elle (Linda Caridi brindille gracile) et Lui (Luca Marinelli grands yeux tristes), dont les prénoms ne seront jamais prononcés, se sont rencontrés un soir de fête sur une île méditerranéenne. Le coup de foudre fut immédiat. Les deux amoureux s’installent dans l’appartement où Lui a passé une enfance douloureuse.
Elle (Linda Caridi brindille gracile) et Lui (Luca Marinelli grands yeux tristes), dont les prénoms ne seront jamais prononcés, se sont rencontrés un soir de fête sur une île méditerranéenne. Le coup de foudre fut immédiat. Les deux amoureux s’installent dans l’appartement où Lui a passé une enfance douloureuse. 1849. Patrick Tate (Emile Hirsch), sa femme Audrey (Déborah François) et leurs deux enfants se sont arrêtés sur le chemin de la Californie dans une petite bourgade sous la coupe d’un predicateur anglican. Patrick y est devenu charpentier et croque-mort. Audrey attend un troisième enfant. La famille vivrait en paix si le sinistre Dutch Albert (John Cusack), flanqué de ses deux acolytes, le Sicilien et le Muet, n’avait pas décidé de s’installer en ville et d’y ouvrir un saloon au grand dam du pasteur et du shérif.
1849. Patrick Tate (Emile Hirsch), sa femme Audrey (Déborah François) et leurs deux enfants se sont arrêtés sur le chemin de la Californie dans une petite bourgade sous la coupe d’un predicateur anglican. Patrick y est devenu charpentier et croque-mort. Audrey attend un troisième enfant. La famille vivrait en paix si le sinistre Dutch Albert (John Cusack), flanqué de ses deux acolytes, le Sicilien et le Muet, n’avait pas décidé de s’installer en ville et d’y ouvrir un saloon au grand dam du pasteur et du shérif.